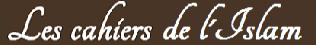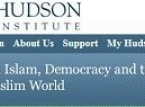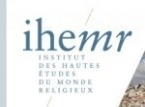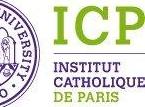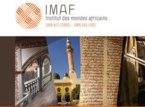Organismes de recherche, Universités, Instituts, Think tank
Groupe d'Études Orientales, Slaves et Néo-helléniques. Le GEO est un regroupement d'enseignants chercheurs de plusieurs départements de l'Université de Strasbourg couvrant les aires linguistiques et culturelles suivantes : arabe, hébreu, persan, slave, grec moderne, japonais, chinois.
Les activités de recherche : les membres du GEO couvrent un éventail large des aires littéraires et culturelles de ses composantes, ouvertes les unes sur les autres. Elles sont reconnues au sein de l'Université pour leurs recherches transversales et interculturelles leurs domaines littéraires et culturels respectifs.
Les activités de recherche : les membres du GEO couvrent un éventail large des aires littéraires et culturelles de ses composantes, ouvertes les unes sur les autres. Elles sont reconnues au sein de l'Université pour leurs recherches transversales et interculturelles leurs domaines littéraires et culturels respectifs.
Mission : Favoriser l’émergence d’une nouvelle conscience féminine musulmane capable d’être actrice de son propre changement et de participer à la réflexion sur la religion, le sens et les valeurs de la société dans laquelle elle vit.
-Améliorer la participation des femmes dans la réflexion intellectuelle, théologique et juridique autour de l’islam.
-Augmenter l’apprentissage de l’autonomie intellectuelle des femmes pour réinterpréter leur propre rôle au sein de leur culture selon les valeurs spirituelles.
-Revendiquer le droit des femmes à l’interprétation des textes...
-Améliorer la participation des femmes dans la réflexion intellectuelle, théologique et juridique autour de l’islam.
-Augmenter l’apprentissage de l’autonomie intellectuelle des femmes pour réinterpréter leur propre rôle au sein de leur culture selon les valeurs spirituelles.
-Revendiquer le droit des femmes à l’interprétation des textes...
Le portail du Groupement d'intérêt scientifique « Moyen-Orient et mondes musulmans » valorise la production scientifique et éditoriale des études sur le Moyen-Orient et les Mondes musulmans.
Today, countries of the Middle East and the Islamic world are powerful, active actors on the international stage. Since 2009, the Middle East and Muslim North Africa have undergone unexpected and dramatic changes with varying consequences. These multidimensional changes are ongoing, placing the Middle East and the Muslim world in a new, urgent, and international context.
The goal of our five programs focused on the Middle East and Islamic World is to train well-grounded, well-versed, and well-informed international citizens. Students learn to understand and analyze the region’s long complex past and rapidly changing present. Our programs seek to rise above stereotypes, remain unimpeded by political correctness (or incorrectness), and offer in-depth knowledge from a variety of perspectives.
The goal of our five programs focused on the Middle East and Islamic World is to train well-grounded, well-versed, and well-informed international citizens. Students learn to understand and analyze the region’s long complex past and rapidly changing present. Our programs seek to rise above stereotypes, remain unimpeded by political correctness (or incorrectness), and offer in-depth knowledge from a variety of perspectives.
Les travaux du GREDO, traditionnellement axés sur la recherche œcuménique, se sont étendus à d’autres domaines.
Ils abordent dorénavant aussi des questions d’ordre éthique. Dans cette perspective, le groupe entend tout d’abord prolonger les recherches menées dans le cadre de l’ancien CSRES. La pratique du spiritual care ainsi que les réflexions sur l’opportunité du human enhancement continuent de faire l’objet de travaux. Une réflexion de nature éthique sur les questions de vérité, de véracité et de sincérité a par ailleurs été initiée. Est notamment prévue, en lien avec le GRESOPP, la tenue en 2019 d’un colloque portant sur les phénomènes du doute et de la perte de foi pensés comme autant de modalités d’une quête de véracité.
Le GREDO compte également élargir son champ de recherche dans le domaine de la théologie dogmatique, et plus particulièrement dans celui de la théologie comparée des religions. Il travaille dans ce cadre à la création, à Strasbourg, d’un "Forum européen des Religions" conçu sur le modèle du Forum européen de Bioéthique.
En matière de théologie œcuménique, le GREDO entend poursuivre la publication et l’analyse, sur le plan de la méthodologie notamment, des dialogues entre Églises. Ces travaux continuent d’être menés en lien étroit avec le Centre d’études œcuméniques de Strasbourg. Ils sont centrés sur l’évolution de l’identité des Églises au fil du dialogue œcuménique et sur la question des expressions diverses d’une même identité chrétienne.
Ils abordent dorénavant aussi des questions d’ordre éthique. Dans cette perspective, le groupe entend tout d’abord prolonger les recherches menées dans le cadre de l’ancien CSRES. La pratique du spiritual care ainsi que les réflexions sur l’opportunité du human enhancement continuent de faire l’objet de travaux. Une réflexion de nature éthique sur les questions de vérité, de véracité et de sincérité a par ailleurs été initiée. Est notamment prévue, en lien avec le GRESOPP, la tenue en 2019 d’un colloque portant sur les phénomènes du doute et de la perte de foi pensés comme autant de modalités d’une quête de véracité.
Le GREDO compte également élargir son champ de recherche dans le domaine de la théologie dogmatique, et plus particulièrement dans celui de la théologie comparée des religions. Il travaille dans ce cadre à la création, à Strasbourg, d’un "Forum européen des Religions" conçu sur le modèle du Forum européen de Bioéthique.
En matière de théologie œcuménique, le GREDO entend poursuivre la publication et l’analyse, sur le plan de la méthodologie notamment, des dialogues entre Églises. Ces travaux continuent d’être menés en lien étroit avec le Centre d’études œcuméniques de Strasbourg. Ils sont centrés sur l’évolution de l’identité des Églises au fil du dialogue œcuménique et sur la question des expressions diverses d’une même identité chrétienne.
Le Groupe d'études d'islamologie d'Alsace (GEDIIDA) est un groupe d'étudiants, de chercheurs, d’auteurs, d’enseignants (d’institutions multiples et de la recherche), d’autodidactes et de professionnels de divers disciplines et domaines qui étudient les questions d'islamologie et de théologie, les sciences religieuses, les apports des sciences humaines sur le fait religieux, la philosophie, le droit, la littérature, la civilisation et l’histoire des religions.
Le GRIS, Groupe de Recherche sur l'Islam en Suisse, a été créé en 2002. Sur la base de recherche et d'analyses, le GRIS veut proposer des instruments de réflexion et de compréhension aux acteurs socio-politiques et académiques qui sont confrontés ou interpellés sur l'islam et les musulmans en Suisse.
Le centre GRAMATA, autrement dit « groupe de recherches antiquité, moyen-âge, transmission arabe » localisé à l’Université Paris1-Panthéon-Sorbonne développe l’étude de la double tradition platonicienne et aristotélicienne de ses origines à sa réception médiévale, arabe et latine. Il s’agit à la fois d’expliciter l’originalité de chacune de ces traditions ainsi que les superpositions, échanges et croisements, effectués en fonction des moments selon une logique d’opposition ou d’accord. En outre, chacune de ces traditions est mise en rapport avec les autres courants de philosophie qui lui sont affines (affinités entre platoniciens et stoïciens, par exemple) et avec la constitution des traditions doxographiques où le Lycée joue un rôle de premier plan.
Le Groupe de Recherches et d'Etudes sur la Méditerranée et le Moyen Orient (GREMMO) est une unité mixte CNRS – Université Lyon 2 spécialisée sur les mondes arabe, turc et iranien contemporains à travers une approche pluridisciplinaire.
Outre notre programme sur les sociétés urbaines, les membres du GREMMO effectuent des recherches sur les thèmes suivants :
- Recherche et professionnel de l'humanitaire au Moyen-Orient.
- Les traites dans le monde arabe du XVème au XXème siècle.
- La mondialisation et le religieux (en collaboration avec l'Institut supérieur des études du religieux et de la laïcité)
- Les pratiques culturelles arabes
- Le Golfe Abbasside
Outre notre programme sur les sociétés urbaines, les membres du GREMMO effectuent des recherches sur les thèmes suivants :
- Recherche et professionnel de l'humanitaire au Moyen-Orient.
- Les traites dans le monde arabe du XVème au XXème siècle.
- La mondialisation et le religieux (en collaboration avec l'Institut supérieur des études du religieux et de la laïcité)
- Les pratiques culturelles arabes
- Le Golfe Abbasside
Les sciences sociales des religions sont aujourd’hui confrontées à une forte demande sociale d’informations et d’analyses portant sur les mutations religieuses actuelles, les caractéristiques et évolutions de tel ou tel monde religieux, les questions et polémiques relatives à l’expression des identités religieuses dans la vie sociale, ou les laïcités et les défis qu’elles rencontrent. Que ce soit à travers la participation à des manifestations scientifiques ou à travers l’engagement dans des débats nationaux et internationaux, il s’agit toujours pour les membres du GSRL de situer leur apport proprement scientifique dans des débats où les acteurs eux-mêmes sont demandeurs d’analyses objectivant les situations et les interprétations diverses qu’elles suscitent.
Le GSRL se réunit en un séminaire interne mensuel et lors de journées d’études ; de plus, il organise régulièrement de grands colloques internationaux.
Les membres du GSRL enseignent dans diverses institutions, en particulier à l’École Pratique des Hautes Études. Outre les ouvrages collectifs et individuels, le GSRL participe à la publication de la revue Archives de Sciences Sociales des Religions.
Le GSRL se réunit en un séminaire interne mensuel et lors de journées d’études ; de plus, il organise régulièrement de grands colloques internationaux.
Les membres du GSRL enseignent dans diverses institutions, en particulier à l’École Pratique des Hautes Études. Outre les ouvrages collectifs et individuels, le GSRL participe à la publication de la revue Archives de Sciences Sociales des Religions.
Are you interested in the history, languages, and cultures of the Middle East? Stretching from Libya to Turkey and southward down the Arabian Peninsula, the Middle East comprises Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Palestine (including West Bank and Gaza Strip), Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Turkey, the United Arab Emirates, and Yemen.
The Hamilton Lugar School's Department of Middle Eastern Languages & Cultures offers a major in the discipline, which includes the study of languages such as Arabic, Egyptian, Hebrew, or Persian, as well as minors in Arabic, Persian, and Islamic Studies. We also offer MA and PhD degrees in Arabic and and support additional languages such as Hebrew, Turkish, Persian, Kurdish, and Ancient (Hieroglyphic) Egyptian.
The signature strengths of the department remain in the classical and medieval periods of Islam—in classical Arabic literature and language, Islamic studies, philosophical and religious thought, and intellectual history. The thriving Arabic language program with its focus on modern standard Arabic and courses offered in the department on the history and politics of the modern Middle East add a vital and critical modern dimension to the traditional departmental areas of strength.
The Hamilton Lugar School's Department of Middle Eastern Languages & Cultures offers a major in the discipline, which includes the study of languages such as Arabic, Egyptian, Hebrew, or Persian, as well as minors in Arabic, Persian, and Islamic Studies. We also offer MA and PhD degrees in Arabic and and support additional languages such as Hebrew, Turkish, Persian, Kurdish, and Ancient (Hieroglyphic) Egyptian.
The signature strengths of the department remain in the classical and medieval periods of Islam—in classical Arabic literature and language, Islamic studies, philosophical and religious thought, and intellectual history. The thriving Arabic language program with its focus on modern standard Arabic and courses offered in the department on the history and politics of the modern Middle East add a vital and critical modern dimension to the traditional departmental areas of strength.
Présentation du LabEx HaStec
InvestissementsAvenirWeb Le LabEx HaStec est financé par le Programme « Investissements d’Avenir ».
Le LabEx HaStec étudie, de façon pluridisciplinaire, l’entrelacs historique des Savoirs, des Techniques et des Croyances – élément structurant des cultures et des sociétés humaines – selon un arc chronologique qui s’étend de l’Antiquité au XXIe siècle. Chacun de ces trois termes est entendu selon une polysémie réglée, qui dépasse les limites de l’histoire des sciences et des techniques, ou de l’histoire des religions, et intègre la pluralité des savoirs, les divers modes de croyance (y compris dans le domaine économique), et déploie les sens du mot « technique » selon un spectre vaste qui comprend aussi bien la rhétorique que les techniques intellectuelles (argumentatives, exégétiques) et spirituelles. Une attention particulière est portée aux Humanités numériques.
InvestissementsAvenirWeb Le LabEx HaStec est financé par le Programme « Investissements d’Avenir ».
Le LabEx HaStec étudie, de façon pluridisciplinaire, l’entrelacs historique des Savoirs, des Techniques et des Croyances – élément structurant des cultures et des sociétés humaines – selon un arc chronologique qui s’étend de l’Antiquité au XXIe siècle. Chacun de ces trois termes est entendu selon une polysémie réglée, qui dépasse les limites de l’histoire des sciences et des techniques, ou de l’histoire des religions, et intègre la pluralité des savoirs, les divers modes de croyance (y compris dans le domaine économique), et déploie les sens du mot « technique » selon un spectre vaste qui comprend aussi bien la rhétorique que les techniques intellectuelles (argumentatives, exégétiques) et spirituelles. Une attention particulière est portée aux Humanités numériques.
The Heisenberg Professorship of Religious Studies with a focus on Religious Media Practices in the Department of Religious Studies systematically examines – in both research and teaching - the interplay of religion and media. Specifically, we focus on historical and contemporary processes of convergence between religious and media practices in Islamic intellectual history and Muslim religiosity. Texts, images, and videos of contemporary Muslim actors on social media platforms and their reception are currently a particular focus.
As part of the Department of Religious Studies, we apply socio-cultural approaches to better understand how religious knowledge is produced, mediated, and negotiated through speech, text, and image, scrutinize performative aspects of religious practices, examine lived religion in local and global interrelationships, investigate processes of communitarisation and social identity formation, and examine religious authority.
As part of the Department of Religious Studies, we apply socio-cultural approaches to better understand how religious knowledge is produced, mediated, and negotiated through speech, text, and image, scrutinize performative aspects of religious practices, examine lived religion in local and global interrelationships, investigate processes of communitarisation and social identity formation, and examine religious authority.
Depuis sa création en 1994, le laboratoire a l'ambition de constituer l'un des principaux foyers de recherche historique, archéologique et littéraire sur le Moyen-Âge chrétien et musulman. Il regroupe des spécialistes de l'époque médiévale (Ve-XVe siècle) dont les travaux sont plus particulièrement centrés sur la région Rhône-Alpes, la France méridionale, l'Italie, l'Espagne, le Maghreb et le Proche-Orient. Les recherches s'insèrent dans un vaste réseau de collaborations internationales et interdisciplinaires, et s'intéressent aux multiples aspects des sociétés méditerranéennes. 6 équipes encadrent les thématiques de recherche en parallèle des 2 programmes transversaux.
The mission of Hudson Institute's Center on Islam, Democracy and the Future of the Muslim World is four-fold:
1.To research and analyze political, religious, social and other developments within Islamic countries and Muslim minority populations around the world.
2.To analyze the ideological dynamic of Islam around the world and to examine how the political and theological debate within Islam impacts both Islamist radicalism as well as the Islamic search for moderate and democratic alternatives.
3.To encourage and support the growth of moderate and democratic alternatives to Islamist radicalism within the Muslim world.
4.To contribute to the development of American policy options and public diplomacy efforts within the Muslim world and to strategies to prosecute and to win the war against radical Islam.
1.To research and analyze political, religious, social and other developments within Islamic countries and Muslim minority populations around the world.
2.To analyze the ideological dynamic of Islam around the world and to examine how the political and theological debate within Islam impacts both Islamist radicalism as well as the Islamic search for moderate and democratic alternatives.
3.To encourage and support the growth of moderate and democratic alternatives to Islamist radicalism within the Muslim world.
4.To contribute to the development of American policy options and public diplomacy efforts within the Muslim world and to strategies to prosecute and to win the war against radical Islam.
Les décideurs comme les acteurs se retrouvent régulièrement en position d’inconfort et désarmés face à des problématiques tout à fait nouvelles liées plus ou moins directement au religieux. L'IHEMR est l'espace dédié à la formation des responsables sur ces nouveaux enjeux. L’ambition de l’IHEMR, comme lieu de découverte, de formation, de dialogue et de réflexion, est d’éclairer ses auditeurs dans l’exercice de leurs responsabilités, en leur donnant les clés de compréhension des problématiques éthiques et religieuses.
L’Institut d'étude des religions et de la laïcité (IREL) - jusqu'en 2021 nommé Institut européen en sciences des religions (IESR) - a été créé en 2002 en tant que « centre de formation et de recherche fondamentale et appliquée » (voir arrêté du ministre de l'Éducation) au sein de l’École Pratique des Hautes Études (EPHE).
Organisme public de formation adossé au monde de la recherche, il constitue un lieu laïque d’expertise et de conseil sur l’histoire et l’actualité de la laïcité et des questions religieuses. Suivant les recommandations du rapport de Régis Debray sur L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque (2002), sa première mission est de participer à la mise en œuvre de l’enseignement des faits religieux à l’école, notamment à travers l’organisation de stages de formation initiale et continue pour les personnels de l’Éducation nationale. L’IREL s’adresse également à tous les professionnels et propose des programmes adaptés aux différents secteurs d’activité (service public, associations, entreprises…).
L’IREL est également impliqué dans le parcours Religions et laïcité dans la vie professionnelle et associative du Master Science des religions et société (SRS) de l'université PSL co-accrédité par l'EPHE et l'EHESS, ainsi que dans le DE Études islamiques, diplôme propre à l'EPHE et dans le DE Mondes religieux, laïcité, sociétés, diplôme propre à l'EPHE, en partenariat avec Sciences Po Lille.
L’IREL mène des activités de recherche finalisée dans le domaine des faits religieux et de la laïcité : à travers plusieurs groupes de travail, il analyse la mise en œuvre de l’enseignement des faits religieux en France et en Europe, ainsi que les pratiques de la laïcité dans les différentes fonctions publiques.
Organisme public de formation adossé au monde de la recherche, il constitue un lieu laïque d’expertise et de conseil sur l’histoire et l’actualité de la laïcité et des questions religieuses. Suivant les recommandations du rapport de Régis Debray sur L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque (2002), sa première mission est de participer à la mise en œuvre de l’enseignement des faits religieux à l’école, notamment à travers l’organisation de stages de formation initiale et continue pour les personnels de l’Éducation nationale. L’IREL s’adresse également à tous les professionnels et propose des programmes adaptés aux différents secteurs d’activité (service public, associations, entreprises…).
L’IREL est également impliqué dans le parcours Religions et laïcité dans la vie professionnelle et associative du Master Science des religions et société (SRS) de l'université PSL co-accrédité par l'EPHE et l'EHESS, ainsi que dans le DE Études islamiques, diplôme propre à l'EPHE et dans le DE Mondes religieux, laïcité, sociétés, diplôme propre à l'EPHE, en partenariat avec Sciences Po Lille.
L’IREL mène des activités de recherche finalisée dans le domaine des faits religieux et de la laïcité : à travers plusieurs groupes de travail, il analyse la mise en œuvre de l’enseignement des faits religieux en France et en Europe, ainsi que les pratiques de la laïcité dans les différentes fonctions publiques.
Les cours sont accessibles à tous, gratuitement, sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles. Ils commencent au mois d’octobre de chaque année par un colloque interdisciplinaire. Le programme des cours est disponible à l’accueil ou consultable sur le site internet.
Le Collège de France est un établissement public d’enseignement supérieur, institution unique en France, sans équivalent à l’étranger. Depuis le XVIe siècle, le Collège de France répond à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. Voué à la recherche fondamentale, en partenariat avec le Cnrs, l’Inserm et plusieurs autres grandes institutions, le Collège de France possède cette caractéristique singulière : il enseigne « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ».
Le collège de France comprends un Institut d'études arabes, turques et islamiques.
Le Collège de France est un établissement public d’enseignement supérieur, institution unique en France, sans équivalent à l’étranger. Depuis le XVIe siècle, le Collège de France répond à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. Voué à la recherche fondamentale, en partenariat avec le Cnrs, l’Inserm et plusieurs autres grandes institutions, le Collège de France possède cette caractéristique singulière : il enseigne « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ».
Le collège de France comprends un Institut d'études arabes, turques et islamiques.
Créé en 1999 par le Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au sein de l'École des hautes études en sciences sociales, l'Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman – IISMM – met en œuvre trois missions :
- ouvrir un espace de collaborations et d'échanges entre chercheurs spécialisés dans l'étude du monde musulman (axes de recherche, séminaires de recherche, manifestations scientifiques);
- diffuser un enseignement et proposer un soutien aux jeunes chercheurs;
- contribuer à la diffusion des savoirs scientifiques sur l'islam et le monde musulman, par ses publications, une veille éditoriale, des cycles de conférences ouverts à un large public, des actions de formation à destination de professionnels dans les administrations publiques et les entreprises.
- ouvrir un espace de collaborations et d'échanges entre chercheurs spécialisés dans l'étude du monde musulman (axes de recherche, séminaires de recherche, manifestations scientifiques);
- diffuser un enseignement et proposer un soutien aux jeunes chercheurs;
- contribuer à la diffusion des savoirs scientifiques sur l'islam et le monde musulman, par ses publications, une veille éditoriale, des cycles de conférences ouverts à un large public, des actions de formation à destination de professionnels dans les administrations publiques et les entreprises.
L’IFER aide les professeurs à enseigner le fait religieux :
pour que le fait religieux et la laïcité soit pris en compte à tous les niveaux, dans toutes les disciplines, d’une manière neutre et informée, comme les autres faits de culture ;
par une approche scientifique et universitaire ;
sans éluder les questions de sens, d’éthique et de spiritualité ;
selon des critères de discernement fondés sur les droits de l’homme et le respect de la personne humaine ;
par l’ouverture aux dimensions symbolique, esthétique et anthropologique.
L’Institut de Formation pour l’Étude et l’Enseignement des Religions propose des sessions nationales d’une semaine, des formations diplomantes : Diplôme universitaire « Fait religieux et laïcité » ainsi que des interventions ponctuelles dans les établissements.
pour que le fait religieux et la laïcité soit pris en compte à tous les niveaux, dans toutes les disciplines, d’une manière neutre et informée, comme les autres faits de culture ;
par une approche scientifique et universitaire ;
sans éluder les questions de sens, d’éthique et de spiritualité ;
selon des critères de discernement fondés sur les droits de l’homme et le respect de la personne humaine ;
par l’ouverture aux dimensions symbolique, esthétique et anthropologique.
L’Institut de Formation pour l’Étude et l’Enseignement des Religions propose des sessions nationales d’une semaine, des formations diplomantes : Diplôme universitaire « Fait religieux et laïcité » ainsi que des interventions ponctuelles dans les établissements.
L’iReMMO est une association loi 1901 sans but lucratif.
Cet Institut entend contribuer à l’analyse critique des grandes questions politiques du Bassin méditerranéen. Si ces réflexions se veulent rigoureuses, elles se doivent d’être engagées car on ne peut rester neutre devant des problèmes qui concernent autant nos sociétés, qu’il s’agisse des rapports Occident-Islam, de l’islamisme, de l’immigration, des conflits au Proche-Orient, de la sécurité en Méditerranée, de l’environnement, du développement durable, de l’agriculture et de quelques autres....L’institut est un « laboratoire d’idées » indépendant, qui entend déconstruire les idées reçues et s’opposer à la doxa dominante sur ces sujets. Il devra aussi explorer les dynamiques émergentes de la Méditerranée et du Moyen-Orient, tout en faisant découvrir la région sous un angle historique, artistique et culturel. L’iReMMO veut créer une véritable dynamique susceptible de peser dans le débat public : sur la jeunesse, l’opinion, les décideurs et les partis politiques. L’iReMMO partage ses locaux avec une librairie de l’Harmattan qui comprend près de dix huit mille volumes consacrés à la Méditerranée et au Moyen-Orient.
Cet Institut entend contribuer à l’analyse critique des grandes questions politiques du Bassin méditerranéen. Si ces réflexions se veulent rigoureuses, elles se doivent d’être engagées car on ne peut rester neutre devant des problèmes qui concernent autant nos sociétés, qu’il s’agisse des rapports Occident-Islam, de l’islamisme, de l’immigration, des conflits au Proche-Orient, de la sécurité en Méditerranée, de l’environnement, du développement durable, de l’agriculture et de quelques autres....L’institut est un « laboratoire d’idées » indépendant, qui entend déconstruire les idées reçues et s’opposer à la doxa dominante sur ces sujets. Il devra aussi explorer les dynamiques émergentes de la Méditerranée et du Moyen-Orient, tout en faisant découvrir la région sous un angle historique, artistique et culturel. L’iReMMO veut créer une véritable dynamique susceptible de peser dans le débat public : sur la jeunesse, l’opinion, les décideurs et les partis politiques. L’iReMMO partage ses locaux avec une librairie de l’Harmattan qui comprend près de dix huit mille volumes consacrés à la Méditerranée et au Moyen-Orient.
L'Institut de recherche et d’histoire des textes est une unité propre de recherche du CNRS (Institut des sciences humaines et sociales). L’IRHT a pour objet la recherche fondamentale sur le manuscrit médiéval et la transmission des textes de l’Antiquité à la Renaissance.
L’Institut de recherche pour le développement (IRD) est un organisme français de recherche, original et unique dans le paysage européen de la recherche pour le développement.
Privilégiant l’interdisciplinarité, l’IRD centre ses recherches, depuis plus de 65 ans, sur les relations entre l’homme et son environnement en Afrique, Méditerranée, Amérique latine, Asie et dans l’Outre-Mer tropical français.
Ses activités de recherche, de formation et d’innovation ont pour objectif de contribuer au développement social, économique et culturel des pays du Sud.
Privilégiant l’interdisciplinarité, l’IRD centre ses recherches, depuis plus de 65 ans, sur les relations entre l’homme et son environnement en Afrique, Méditerranée, Amérique latine, Asie et dans l’Outre-Mer tropical français.
Ses activités de recherche, de formation et d’innovation ont pour objectif de contribuer au développement social, économique et culturel des pays du Sud.
L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) est un centre de recherche en sciences humaines et sociales, à vocation régionale, dont le siège est à Tunis. Il est l’un des 27 instituts français de recherche à l’étranger (IFRE), répartis sur les cinq continents, avec une forte présence en Méditerranée et au Proche et Moyen-Orient en y incluant l’Asie mineure et centrale (Maroc, Tunisie, Égypte, Liban, Syrie, Jordanie, Turquie, Iran, Ouzbékistan, Yémen).
Fondé en 1986, l’Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM) est l’héritier de plusieurs centres plus anciens qui, dès 1958, ancrent à Aix-en-Provence un pôle pluridisciplinaire de recherche sur la rive sud de la Méditerranée. Sa création entérine l’élargissement à l’ensemble du monde musulman méditerranéen de travaux initialement centrés sur l’Afrique du Nord et la place croissante prise par les disciplines des sciences sociales dans la connaissance des sociétés contemporaines. Son ancienneté et la richesse de ses fonds documentaires en ont fait un des plus gros centres de recherche français sur cette partie du monde
L’IRIS s’intéresse tout particulièrement aux questions relatives à la politique étrangère, la stratégie, la sécurité et la défense. Centre indépendant d’expertise, son équipe d’experts, ses réseaux et la qualité de ses analyses en font un partenaire privilégié pour le développement international des entreprises et un interlocuteur crédible pour les institutions publiques. Par ses nombreux échanges avec des centres de recherche étrangers et avec les milieux économiques, politiques et diplomatiques, l’IRIS a su constituer un réseau de spécialistes à travers le monde, lui permettant d’élargir et d’approfondir ses champs d’activité et son audience, contribuant ainsi à faire de l’Institut un véritable think tank.
L’ISTR forme les personnes désireuses de s’investir dans le dialogue entre les religions ou dans la compréhension du pluralisme religieux, dans une connaissance objective des singularités des religions par une réflexion théologique sur les questions du dialogue et de la mission.
L'Institut de sciences sociales des religions contemporaines (ISSRC) est un institut universitaire non-confessionel, interdisciplinaire et pluriméthodologique dirigé par la professeure Monika Salzbrunn. L'objectif de l'institut est d'analyser les phénomènes religieux selon trois axes de recherche : la psychologie de la religion (Prof. Pierre-Yves Brandt), les sciences sociales des migrations (Prof. Monika Salzbrunn) et la sociologie des religions (Prof. Jörg Stolz). Ensemble, ces trois axes construisent la cohérence d'un institut de recherche mettant un accent fort sur le comparatisme.
L'ISSRC vise plus concrètement à :
-mettre en place des projets de recherche
-animer un réseaux de chercheurs
-organiser des colloques, des conférences et des ateliers de recherche
-entretenir un centre de documentation sur les religions en Suisse
-rendre accessible des analyses sur les transformations du paysage religieux en Suisse.
L'ISSRC vise plus concrètement à :
-mettre en place des projets de recherche
-animer un réseaux de chercheurs
-organiser des colloques, des conférences et des ateliers de recherche
-entretenir un centre de documentation sur les religions en Suisse
-rendre accessible des analyses sur les transformations du paysage religieux en Suisse.
L’Institut des mondes africains (IMAF), est créé au 1er janvier 2014 par la fusion de trois laboratoires : le Centre d’études des mondes africains (CEMAf), le Centre d’études africaines (CEAf) et le Centre d’histoire sociale de l’islam méditerranéen (CHSIM).
L’IMAF est placé sous l’autorité de six tutelles : le Centre national de la recherche scientifique (CNRS - UMR 8171), l’Institut de recherche pour le développement (IRD - UMR 243), l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), l’École pratique des hautes études (EPHE), l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Université d’Aix-Marseille (AMU).
L’IMAF est placé sous l’autorité de six tutelles : le Centre national de la recherche scientifique (CNRS - UMR 8171), l’Institut de recherche pour le développement (IRD - UMR 243), l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), l’École pratique des hautes études (EPHE), l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Université d’Aix-Marseille (AMU).
L'IEMEP, Institut Euro-Maghrébin d'Etudes et de Prospectives est une association régie par la loi 1901 dont le siège social est situé au 72 Bd de Sébastopol 75003 PARIS.
Cette association se donne pour objet :
- d'organiser des conférences, colloques et des séminaires sur des thèmes d’intérêt général pour tout public ;
- de réaliser des études sur des thèmes ou des pays pour une large diffusion publique ou à la demande à titre gracieux ;
- de réaliser des études à la demande d’institutions, d’entreprises publiques ou privées et des Etats sous forme de prestations rémunérées ;
- de publier des journaux électroniques ou sur papier ;
- d'organiser des forums, symposiums, salons et expositions ;
- d'organiser des sessions de formations en faveur de personnes physiques ou morales ;
- de participer à des forums, symposiums, salons en France et à l’étranger ;
- de publier, éditer, co-éditer des livres et magasines ;
- de participer à des travaux d’études, de recherches et de prospectives organisés par des Universités et grandes écoles françaises et étrangères ;
- de coordonner des programmes de recherches et d’enseignement en France et à l’étranger ;
- d'apporter conseil et appui aux entreprises publiques et privées ainsi qu’à des organismes publics et privés ;
Cette association se donne pour objet :
- d'organiser des conférences, colloques et des séminaires sur des thèmes d’intérêt général pour tout public ;
- de réaliser des études sur des thèmes ou des pays pour une large diffusion publique ou à la demande à titre gracieux ;
- de réaliser des études à la demande d’institutions, d’entreprises publiques ou privées et des Etats sous forme de prestations rémunérées ;
- de publier des journaux électroniques ou sur papier ;
- d'organiser des forums, symposiums, salons et expositions ;
- d'organiser des sessions de formations en faveur de personnes physiques ou morales ;
- de participer à des forums, symposiums, salons en France et à l’étranger ;
- de publier, éditer, co-éditer des livres et magasines ;
- de participer à des travaux d’études, de recherches et de prospectives organisés par des Universités et grandes écoles françaises et étrangères ;
- de coordonner des programmes de recherches et d’enseignement en France et à l’étranger ;
- d'apporter conseil et appui aux entreprises publiques et privées ainsi qu’à des organismes publics et privés ;
L’Institut MEDEA est un centre européen de recherche dont la vocation première est de tisser des liens de confiance, de collaboration, et de compréhension mutuelle entre les pays de l’Union européenne et leurs voisins des régions méditerranéenne et arabe. Son action s’appuie sur le développement d’un réseau continu de dialogue entre acteurs politiques, économiques et académiques, et par la mise à disposition du grand public, d’informations relatives aux relations que l’Europe entretient avec ses voisins du Sud. En pratique, quatre types d’activités font la spécificité du travail de l’Institut : Evenments, Information, Consultance, Activités comme membre de la Fondation Anna Lindh.
L’Institut français d’archéologie orientale du Caire est une grande école française à l'étranger. C'est une institution de recherche dépendant du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Sa mission est d’étudier les civilisations qui se sont succédé en Égypte depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque moderne. Les disciplines concernées sont l’archéologie, l’histoire et les études linguistiques. Les chantiers de l’IFAO concernent toutes les périodes (Préhistoire, Égypte pharaonique, Antiquité, période islamique) et des sites sont fouillés sur tout le territoire égyptien (vallée du Nil, Delta, Oasis, déserts oriental et occidental, Sinaï, mer Rouge).
Sa mission est d’étudier les civilisations qui se sont succédé en Égypte depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque moderne. Les disciplines concernées sont l’archéologie, l’histoire et les études linguistiques. Les chantiers de l’IFAO concernent toutes les périodes (Préhistoire, Égypte pharaonique, Antiquité, période islamique) et des sites sont fouillés sur tout le territoire égyptien (vallée du Nil, Delta, Oasis, déserts oriental et occidental, Sinaï, mer Rouge).
Créé le 2 février 2022, l’Institut français d’islamologie (IFI) a pour mission de développer une islamologie française de haut niveau et de promouvoir à l’échelle nationale l’étude scientifique des systèmes de croyances, de savoirs et de pratiques propres aux différentes branches qui composent la religion musulmane.
Outre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, il regroupe huit partenaires : Aix-Marseille université ; l’École normale supérieure de Lyon ; l’École pratique des hautes études ; l’École des hautes études en sciences sociales ; l’Institut national des langues et civilisations orientales ; l’université Lumière-Lyon 2 ; l’université Jean Moulin-Lyon 3 ; l’université de Strasbourg.
Outre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, il regroupe huit partenaires : Aix-Marseille université ; l’École normale supérieure de Lyon ; l’École pratique des hautes études ; l’École des hautes études en sciences sociales ; l’Institut national des langues et civilisations orientales ; l’université Lumière-Lyon 2 ; l’université Jean Moulin-Lyon 3 ; l’université de Strasbourg.
L’Institut Français d’Études Anatoliennes est un établissement qui relève du Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International ainsi que du CNRS depuis 2007 (USR 3131). Il a pour vocation de nourrir (par ses ressources nombreuses et variées), de faciliter (aux niveaux logistique et administratif), d’impulser et de diriger des recherches en sciences humaines et sociales, en sciences de l’Antiquité. Ces recherches ont pour objet les territoires de la Turquie et de l’Empire ottoman.
Installé dans les locaux du drogmanat du Palais de France (ancienne Ambassade de France auprès de la Sublime Porte), l'Institut français d'études anatoliennes "Georges Dumézil" a succédé en 1975 à l'Institut français d'archéologie d'Istanbul fondé en 1930. À l'origine dévolu à l'histoire ancienne, à l’histoire médiévale et à l'archéologie, il a ensuite étendu ses activités à la turcologie (linguistique et histoire ottomane en particulier). Il a commencé à s'ouvrir aux études contemporaines à la fin des années 1980, notamment avec la mise en place d'un Observatoire Urbain d'Istanbul (OUI) qui s’intéresse désormais à l’ensemble des territoires métropolisés de Turquie. En 1994, l'IFEA a créé un centre d'études caucasiennes. En 2003, ce centre s'est délocalisé à Bakou où l'IFEA possède une antenne, installée au sein de l'Ambassade de France en Azerbaïdjan. En 2005 a été mis sur pied un Observatoire de la vie politique turque (OVIPOT). Les études développées concernent un vaste territoire, qui s'étend des confins orientaux de l'Europe aux abords de l'Asie Centrale. Elles s'inscrivent dans une chronologie longue, allant de la préhistoire aux grands empires, et de la naissance des États-nations aux redéfinitions identitaires d'aujourd'hui.
Installé dans les locaux du drogmanat du Palais de France (ancienne Ambassade de France auprès de la Sublime Porte), l'Institut français d'études anatoliennes "Georges Dumézil" a succédé en 1975 à l'Institut français d'archéologie d'Istanbul fondé en 1930. À l'origine dévolu à l'histoire ancienne, à l’histoire médiévale et à l'archéologie, il a ensuite étendu ses activités à la turcologie (linguistique et histoire ottomane en particulier). Il a commencé à s'ouvrir aux études contemporaines à la fin des années 1980, notamment avec la mise en place d'un Observatoire Urbain d'Istanbul (OUI) qui s’intéresse désormais à l’ensemble des territoires métropolisés de Turquie. En 1994, l'IFEA a créé un centre d'études caucasiennes. En 2003, ce centre s'est délocalisé à Bakou où l'IFEA possède une antenne, installée au sein de l'Ambassade de France en Azerbaïdjan. En 2005 a été mis sur pied un Observatoire de la vie politique turque (OVIPOT). Les études développées concernent un vaste territoire, qui s'étend des confins orientaux de l'Europe aux abords de l'Asie Centrale. Elles s'inscrivent dans une chronologie longue, allant de la préhistoire aux grands empires, et de la naissance des États-nations aux redéfinitions identitaires d'aujourd'hui.
L’Institut Français de Tunisie est un des principaux instruments de mise en œuvre de la politique de coopération de la France en Tunisie, conformément à l’esprit de partenariat qui préside aux relations entre les deux pays. À ce titre, l'Institut Français de Tunisie finance, initie, conduit et appuie un ensemble d’actions et de projets portant sur de nombreux domaines : coopération universitaire, scientifique, linguistique, éducative, technique ou institutionnelle, et action culturelle.
|
Les Cahiers de l'Islam © 2012-2023. Tous droits réservés.
ISSN 2269-1995 Contact : redaction (at) lescahiersdelislam.fr |