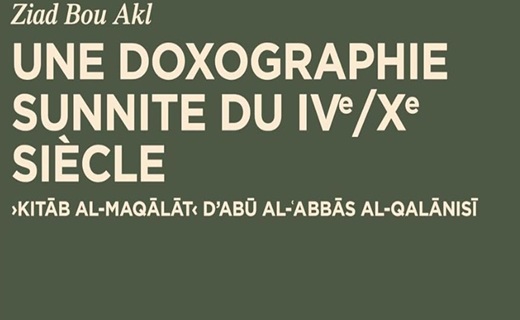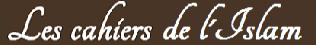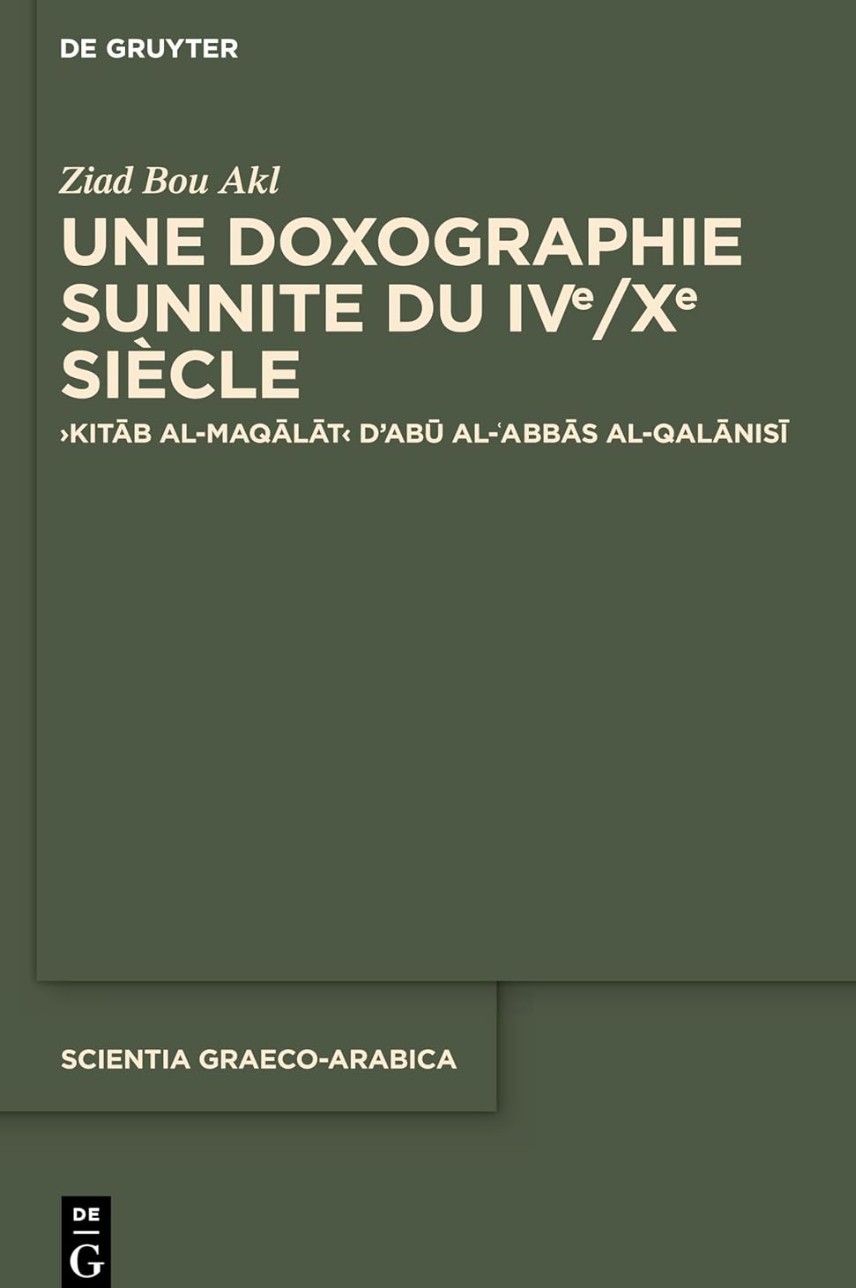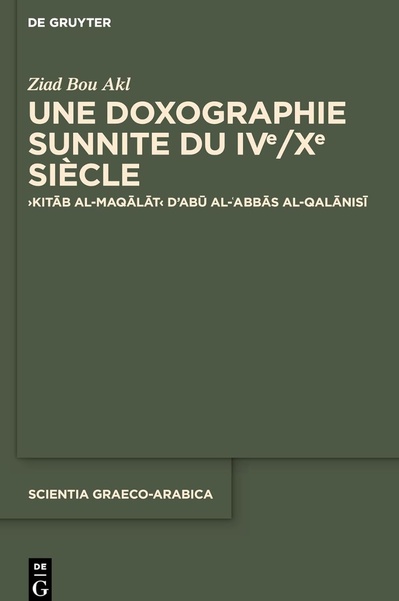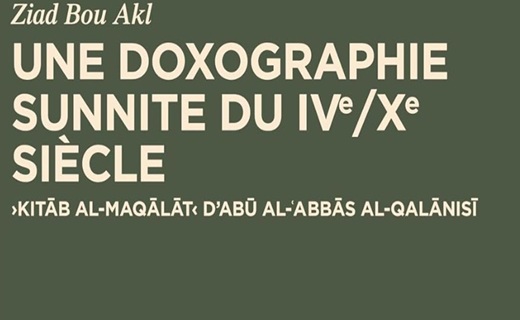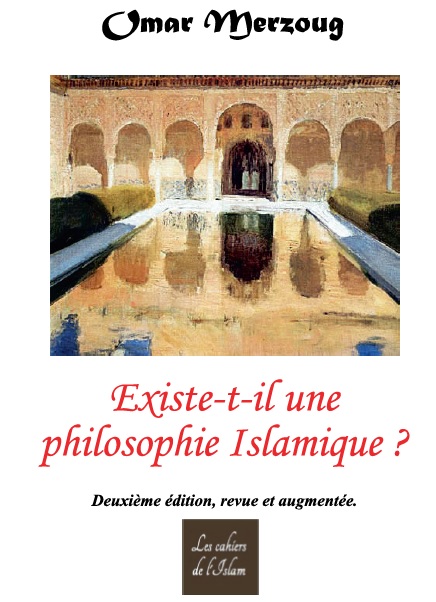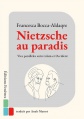Outre la longue présentation qui reconstitue ces débuts du kalām sunnite, et la traduction faisant face à l’édition, l’A. offre un commentaire linéaire de chaque fragment permettant d’en éclairer les moindres détails à la fois historiques et de doctrine. Il offre ainsi un outil complet et précieux aux historiens du kalām,...Guillaume de Vaulx d’Arcy
Cette recension a déjà fait l'objet d'une publication dans la Revue MIDEO [En ligne] , 32|2017 sous licence Creative Commons (BY NC ND).
Broché: 174 pages
Editeur : De Gruyter (10 mai 2021)
Collection : Scientia Graeco-Arabica
Langue : Français
ISBN-13: 978-3110737424
Editeur : De Gruyter (10 mai 2021)
Collection : Scientia Graeco-Arabica
Langue : Français
ISBN-13: 978-3110737424
Quatrième de couverture
Ce livre présente l'édition et la traduction annotée de fragments issus d'un traité de maqālāt d'Abū al-ʿAbbās al-Qalānisī. À la différence d'al-Balḫī et d'al-Asʿarī, les deux grands auteurs de maqālāt de cette époque, notre auteur n'est ni muʿtazilite ni formé chez les muʿtazilites, mais un « théologien traditionniste » de l'école d'Ibn Kullāb. Seuls fragments restants de ce grand théologien, ces maqālāt reflètent sa volonté d'intégrer les milieux sunnites dans les débats théologiques du iii e/ixe s. L'histoire qu'il nous livre des premiers siècles du kalām prend ainsi le contrepied aussi bien de celle des muʿtazilites que de celle des ḥanbalites, pour qui les métiers de théologiens et traditionnistes s'excluent mutuellement. Ainsi, al-Qalānisī participe avec al-Ashʿarī de ce grand mouvement de synthèse qui caractérise le ive/xe s tout en se démarquant fondamentalement de son célèbre contemporain. L'étude qui précède l'édition apporte un nouvel éclairage sur ce dernier représentant du kullābisme qu'était al-Qalānisī - permettant par là d'expliquer les raisons du succès d'al-Asʿarī, dont l'école reléguera aux marges de l'orthodoxie cette première efflorescence du kalām sunnite.
Ziad Bou Akl est membre du groupe « Livres sacrés : canons et hétérodoxies » du Laboratoire d'études sur les monothéismes (LEM-UMR 8584) et Directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où il occupe la chaire de philosophie islamique. Ses travaux portent sur les liens entre la philosophie arabe (falsafa), la théologie rationnelle (kalām) et la théorie juridique (uṣūl al-fiqh) pendant la période classique. Il s'intéresse également aux manuscrits philosophiques en arabe.
Ziad Bou Akl est membre du groupe « Livres sacrés : canons et hétérodoxies » du Laboratoire d'études sur les monothéismes (LEM-UMR 8584) et Directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où il occupe la chaire de philosophie islamique. Ses travaux portent sur les liens entre la philosophie arabe (falsafa), la théologie rationnelle (kalām) et la théorie juridique (uṣūl al-fiqh) pendant la période classique. Il s'intéresse également aux manuscrits philosophiques en arabe.
Recension
Par Guillaume de Vaulx d’Arcy
Ziad Bou Akl avait offert au public, avec son ouvrage Le philosophe et la loi, édition, traduction et commentaire de l’abrégé par Averroès du traité de fiqh d’al-Ġazālī, al-Muṣṭafā fī ʿilm al-uṣūl, un texte inédit et précieux, celui qui manifestait la position juridique du commentateur d’Aristote. Avec Une doxographie sunnite du IVe/Xe siècle, c’est un nouvel inédit qu’il met à notre disposition, le Kitāb al-maqālāt d’al-Qalānisī, auteur inclut par al-Baġdādī « parmi les mutaqaddimūn min mutakallimī ahl al-ḥadīṯ » (p. xxiii). Remontant l’histoire de deux siècles, c’est cette fois-ci au champ des débuts de la théologie rationnelle que l’A. vient désormais apporter sa contribution. En réalité, ce n’est pas l’ouvrage entier que l’A. édite, traduit et commente, mais de courts fragments pouvant tenir dans une quinzaine de pages. S’arrêter là serait pourtant nier la valeur tant éditoriale qu’herméneutique du travail accompli par l’A.
Au niveau éditorial, ce sont des marges, celles d’un manuscrit d’al-Iqtiṣād fī al-iʿtiqād d’al-Ġazālī, que l’auteur a déchiffrées pour y identifier et en prélever le texte, jusqu’alors inconnu, d’al-Qalānisī. Si le lecteur curieux peut regretter l’absence d’un folio facsimilé d’un manuscrit régulièrement décrit comme indéchiffrable (p. xxxviii, li, lii), la performance technique doit être saluée et n’est pas sans évoquer celle de Marc Geoffroy et de Colette Sirat concernant le Grand commentaire d’Averroès au De anima, dont le travail consista également dans le déchiffrage des notes de cours en caractères hébraïques déposées par une quinzaine d’étudiants en marges du Commentaire moyen du maître de Cordoue [1]. Les deux travaux sur les marges arrivent à publication au même moment. Le rapprochement n’est pas anodin, puisque chez ces deux spécialistes d’Averroès, une véritable attente intellectuelle est projetée sur ces marges : c’est là que le paléographe doit chercher le lieu de survivance de doctrines dont on avait perdu tout espoir de retrouver les formes achevées. Et c’est bien ici le cas, puisque les fragments publiés par l’A. apportent les éléments de la plus ancienne doxographie des doctrines théologiques écrite par un théologien traditionniste, soit un ouvrage comparable au Maqālāt al-islāmiyyīn d’al-Ašʿarī, mais le précédant peut-être d’une petite génération (p. xxvii-i) et apportant des éléments sur les opinions non seulement des muʿtazilites, mais également des théologiens traditionnistes..
Au niveau herméneutique, le travail de l’A. a alors consisté à reconstituer l’émergence de ce kalām sunnite, celui des « mutakallimū ahl al-ḥadīṯ » (ex. p. 6), et à comprendre le passage du traditionnisme anti-théologique d’Ibn al-Ḥanbal à la grande synthèse ašʿarite de la tradition et du kalām. Son travail se situe dans le cadre des études sur les débuts du kalām, études en plein développement grâce en particulier à la parution récente du Kitāb al-maqālāt d’Abū l-Qāsim al-Balḫī, large doxographie muʿtazilite et ouvrage d’épistémologie du kalām qui a constitué un événement éditorial [2]. L’A., dont la maîtrise du matériel existant est entière, peut alors écrire sa propre page de l’histoire. Il met ainsi en évidence la figure d’Ibn Kullāb, « qui se présente comme l’autorité théologique centrale du texte » (p. lxiii), figure controversée dont le respect par al-Qalānisī participera de son oubli au profit du seul al-Ašʿarī dont la prudence « à ne revendiquer aucune tradition […] aurait contribué à sa réussite, contrairement à al-Qalānisī qui se serait attiré très rapidement les foudres des ḥanbalites de son temps, hostiles à toute forme de kullābisme » (p. lxiv). Al-Qalānisī est donc un théologien repoussé dans les marges de l’histoire. Le travail éditorial de l’A. se trouve par là-même justifié : « Cette marginalité n’est en effet qu’une reproduction codicologique d’une position objective dans le champ religieux de l’époque » (p. lxv).
Outre la longue présentation qui reconstitue ces débuts du kalām sunnite, et la traduction faisant face à l’édition, l’A. offre un commentaire linéaire de chaque fragment permettant d’en éclairer les moindres détails à la fois historiques et de doctrine. Il offre ainsi un outil complet et précieux aux historiens du kalām, et il l’offre effectivement, puisque le livre est téléchargeable gratuitement depuis le site de l’éditeur.
Au niveau éditorial, ce sont des marges, celles d’un manuscrit d’al-Iqtiṣād fī al-iʿtiqād d’al-Ġazālī, que l’auteur a déchiffrées pour y identifier et en prélever le texte, jusqu’alors inconnu, d’al-Qalānisī. Si le lecteur curieux peut regretter l’absence d’un folio facsimilé d’un manuscrit régulièrement décrit comme indéchiffrable (p. xxxviii, li, lii), la performance technique doit être saluée et n’est pas sans évoquer celle de Marc Geoffroy et de Colette Sirat concernant le Grand commentaire d’Averroès au De anima, dont le travail consista également dans le déchiffrage des notes de cours en caractères hébraïques déposées par une quinzaine d’étudiants en marges du Commentaire moyen du maître de Cordoue [1]. Les deux travaux sur les marges arrivent à publication au même moment. Le rapprochement n’est pas anodin, puisque chez ces deux spécialistes d’Averroès, une véritable attente intellectuelle est projetée sur ces marges : c’est là que le paléographe doit chercher le lieu de survivance de doctrines dont on avait perdu tout espoir de retrouver les formes achevées. Et c’est bien ici le cas, puisque les fragments publiés par l’A. apportent les éléments de la plus ancienne doxographie des doctrines théologiques écrite par un théologien traditionniste, soit un ouvrage comparable au Maqālāt al-islāmiyyīn d’al-Ašʿarī, mais le précédant peut-être d’une petite génération (p. xxvii-i) et apportant des éléments sur les opinions non seulement des muʿtazilites, mais également des théologiens traditionnistes..
Au niveau herméneutique, le travail de l’A. a alors consisté à reconstituer l’émergence de ce kalām sunnite, celui des « mutakallimū ahl al-ḥadīṯ » (ex. p. 6), et à comprendre le passage du traditionnisme anti-théologique d’Ibn al-Ḥanbal à la grande synthèse ašʿarite de la tradition et du kalām. Son travail se situe dans le cadre des études sur les débuts du kalām, études en plein développement grâce en particulier à la parution récente du Kitāb al-maqālāt d’Abū l-Qāsim al-Balḫī, large doxographie muʿtazilite et ouvrage d’épistémologie du kalām qui a constitué un événement éditorial [2]. L’A., dont la maîtrise du matériel existant est entière, peut alors écrire sa propre page de l’histoire. Il met ainsi en évidence la figure d’Ibn Kullāb, « qui se présente comme l’autorité théologique centrale du texte » (p. lxiii), figure controversée dont le respect par al-Qalānisī participera de son oubli au profit du seul al-Ašʿarī dont la prudence « à ne revendiquer aucune tradition […] aurait contribué à sa réussite, contrairement à al-Qalānisī qui se serait attiré très rapidement les foudres des ḥanbalites de son temps, hostiles à toute forme de kullābisme » (p. lxiv). Al-Qalānisī est donc un théologien repoussé dans les marges de l’histoire. Le travail éditorial de l’A. se trouve par là-même justifié : « Cette marginalité n’est en effet qu’une reproduction codicologique d’une position objective dans le champ religieux de l’époque » (p. lxv).
Outre la longue présentation qui reconstitue ces débuts du kalām sunnite, et la traduction faisant face à l’édition, l’A. offre un commentaire linéaire de chaque fragment permettant d’en éclairer les moindres détails à la fois historiques et de doctrine. Il offre ainsi un outil complet et précieux aux historiens du kalām, et il l’offre effectivement, puisque le livre est téléchargeable gratuitement depuis le site de l’éditeur.
Références
_____________________
[1] Geoffroy, Marc & Sirat, Colette, De la faculté rationnelle : l’original arabe du Grand Commentaire (Šarḥ) d’Averroès au De anima d’Aristote (III, 4-5, 429a10-432a14), Canterano, Aracne Editrice, 2021.
[2] Al-Balḫī, Abū al-Qāsim, Kitāb al-maqālāt, Ḥusayn Ḫānṣū, Rāǧiḥ Kurdī & ʿAbd al-Ḥāmid Kurdī (éd.), ʿAmmān, Dār al-Fatḥ li-l-Dirāsāt wa-l-Našr ; Isṭanbūl, Kuramer, 2018.
[1] Geoffroy, Marc & Sirat, Colette, De la faculté rationnelle : l’original arabe du Grand Commentaire (Šarḥ) d’Averroès au De anima d’Aristote (III, 4-5, 429a10-432a14), Canterano, Aracne Editrice, 2021.
[2] Al-Balḫī, Abū al-Qāsim, Kitāb al-maqālāt, Ḥusayn Ḫānṣū, Rāǧiḥ Kurdī & ʿAbd al-Ḥāmid Kurdī (éd.), ʿAmmān, Dār al-Fatḥ li-l-Dirāsāt wa-l-Našr ; Isṭanbūl, Kuramer, 2018.