Introduction
Par Francesco Piraino
Étudier et décrire le soufisme pose plusieurs défis intellectuels. Tout d’abord, il s’agit d’un phénomène protéiforme : mysticisme, ésotérisme, spiritualité, métaphysique, religion populaire, occultisme, philosophie, théologie, ascétisme, nous avons besoin de tous ces mots pour parler du soufisme. Ensuite, il ne s’agit pas d’un phénomène strictement distinct de l’islam. Une définition substantielle et définitive risquerait d’être non seulement futile, mais aussi trompeuse.
Cette protéiformité est due à la nature paradoxale du soufisme, qui consiste en une connaissance mystique fondée sur l’expérience directe de Dieu : ineffable et incommunicable, elle a toutefois été communiquée, transmise et construite en tant que tradition, au travers de mouvements religieux avec leurs doctrines, pratiques et structures organisationnelles. Le soufisme a été capable, grâce à ses maîtres charismatiques et à ses structures organisationnelles souples, de se diffuser dans tout le monde islamique, mais aussi au-delà. Cette diffusion a impliqué le plus souvent la conversion à l’islam-soufisme de nouveaux disciples et, dans de rares cas, la création de formes syncrétiques d’un soufisme sans islam.
La double définition du soufisme que j’utiliserai dans ce livre correspond à la tension entre les termes arabes taṣawwuf et ṭarīqa. Taṣawwuf exprime une dimension dynamique, « le parcours de purification de l’âme » ou « la connaissance de Dieu » ; en fait, la science du taṣawwuf est, selon Ibn ʿArabī, al-ʿilm al-ummi, une « science illettrée » [1] ou « sur-lettrée »[2]. À l’inverse, ṭarīqa (« la voie ») désigne l’organisation religieuse, la confrérie qui a été, depuis plusieurs siècles et encore aujourd’hui, l’outil de transmission et de diffusion de la tradition soufie[3]
Cette double dimension du soufisme, en tant que tradition religieuse et connaissance-expérience mystique, a donné lieu à deux approches épistémologiques et méthodologiques différentes[4]. Certains chercheurs (généralement les philologues et les historiens) se sont focalisés sur les doctrines soufies, en laissant à l’arrière-plan les pratiques et la vie quotidienne des soufis, ou même en considérant les dimensions sociales comme une forme de décadence des idées nobles. D’autres (généralement les sociologues et les anthropologues) ont renversé cette perspective en considérant les idées comme d’importance secondaire. Ces deux approches antinomiques comportent des avantages et des inconvénients. Ceux qui se concentrent sur les discours et les idées risquent d’idéaliser et, parfois, de romancer le soufisme, en occultant la nature sociale du phénomène ; et les autres, d’accréditer une vision présentiste, c’est-à-dire l’incapacité à situer le soufisme contemporain dans son cours historique, considérant tous les phénomènes comme l’effet des influences sociales contemporaines. Dans cette étude, je chercherai à garder cette double perspective en essayant de lier ces deux approches.
Imaginons la relation complexe entre islam et soufisme comme deux cercles qui se croisent et changent de position au cours de l’histoire. Ils coïncident parfois parfaitement tandis que, dans d’autres contextes historiques et/ou géographiques, des différences importantes apparaissent. Nous ne devons pas concevoir ces orthodoxies comme séparées et monolithiques, car les premières critiques envers certaines pratiques et doctrines soufies ont été formulées par les soufis eux-mêmes[5]. Si les orthodoxies soufies et islamiques ont changé au cours des siècles, sous l’influence de plusieurs facteurs, les sujets qui ont suscité des polémiques sont souvent les mêmes : le rôle extraordinaire des maître soufis, appelés, comme les saints, les « amis de Dieu », les pratiques extatiques, l’exégèse allégorique-ésotérique, les pratiques liées aux tombeaux des saints, l’utilisation des rituels de guérison spirituelle-médicale et une certaine porosité avec les langages et les pratiques exogènes.
La séparation idéale entre islam et soufisme est une invention relativement récente, promue tout d’abord par le salafisme et le wahhabisme[6], dans une quête de pureté et de retour aux origines. Celle-ci a donné lieu à une véritable guerre contre le soufisme, dont on peut voir les conséquences dans les attentats terroristes en Égypte, au Pakistan et en Tunisie à partir des années 2010. Les wahhabites ont trouvé des alliés inattendus parmi certains intellectuels européens des XIXe et XXe siècles, qui cherchaient dans le soufisme des origines aryennes en opposition à un islam sémitique[7] ; certains voulaient démontrer l’origine chrétienne du soufisme[8], pendant que d’autres encore étaient en quête d’une religion universelle[9]. Tous cherchaient à minimiser l’islamité du soufisme. Aujourd’hui, elle ne fait plus débat dans le monde académique, ce qui n’empêche pas de saisir les influences exogènes passées et présentes qui ont contribué à former le soufisme.
Parmi les influences les plus importantes dans le soufisme contemporain, l’on trouve ce que l’on pourrait appeler l’« universalisation du soufisme »[10]. En effet, nous verrons dans ce livre que, dans différents domaines (académique, ésotérique et new age), des théories sur une religion universelle ont été formalisées et ont profondément influencé le soufisme contemporain. Parmi ces « apôtres de l’universalisme », l’on compte les chercheurs qui ont participé aux rencontres d’Eranos, en se focalisant sur les mythes, symboles et archétypes universels, comme Carl Gustav Jung, Henry Corbin, Louis Massignon, Gershom Scholem et Mircea Eliade[11]. L’ésotériste René Guénon, malgré lui, a initié le courant traditionaliste[12] axé sur le concept de « Tradition primordiale » et sur la critique de la modernité. Enfin, dans le milieu ésotérique ou new age de la société théosophique naît l’idée d’un culte universel, capable d’accueillir en même temps toutes les formes religieuses[13].
En dépit d’une certaine continuité entre ces différentes formes d’universalismes, ces courants ont donné lieu à des mouvements indépendants et souvent en opposition, présentant des différences doctrinales, éthiques et politiques. Enfin, nous ne devons pas oublier que la dialectique entre l’universel et le particulier fait partie de l’histoire du soufisme et de l’islam : il peut donc exister des universalismes tout à fait islamiques, avec des spécificités doctrinales, éthiques et politiques. Nous ne devons pas commettre l’erreur de penser qu’il n’existerait qu’une seule forme d’universalisme, ni que tous les universalismes seraient made in Europe.
Le processus d’universalisation ainsi qu’une certaine porosité du soufisme ont conduit à la formation de plusieurs stéréotypes dans l’opinion commune et le monde académique. Par exemple, certains considèrent que le soufisme incarne le « bon islam », par opposition à l’islamisme et au salafisme ; comme revers de la médaille, il s’agirait dès lors d’un islam domestiqué, soumis à la modernité occidentale. En se pliant à ces stéréotypes, ce soufisme serait une forme d’islam light, non lié à la charia. Il s’agirait d’un islam libéral et allié naturel de l’Occident.
Or, rien n’est plus faux que cette vision dichotomique. En effet, il existe plusieurs exemples de soufis islamistes et salafistes dans les sociétés contemporaines[14]. Nous verrons par ailleurs que, contrairement à ce que l’on peut imaginer, les musulmans les plus attachés à la charia sont souvent les plus progressistes, et qu’au sein des confréries soufies très influencées par la culture new age, l’on peut entendre des récits violemment antimodernistes et anti-démocratiques. Enfin, il est aussi vrai que certains soufis tirent profit de la recherche, dans l’opinion publique, du « bon musulman » et de la peur du salafisme pour imposer leur vision de l’islam, en occupant avec habileté le champ religieux islamique. Cela dit, ce soufisme engagé n’est pas forcément libéral ; nous avons constaté qu’il est, au contraire, plutôt conservateur.
Comme l’a souligné Michel de Certeau, la mystique hante l’épistémologie occidentale, car elle est un sujet souterrain, à la fois oublié et au cœur des sciences humaines[15]. Nous pourrions dire la même chose, mutatis mutandis, du soufisme dans l’histoire de l’islam, à la fois discours incontournable et présence inconfortable. Cette tension nous pousse à questionner et à réélaborer nos catégories heuristiques, non pas pour bâtir une nouvelle théorie totalisante, mais au contraire pour penser l’islam dans sa « contradiction cohérente »[16].
Cette protéiformité est due à la nature paradoxale du soufisme, qui consiste en une connaissance mystique fondée sur l’expérience directe de Dieu : ineffable et incommunicable, elle a toutefois été communiquée, transmise et construite en tant que tradition, au travers de mouvements religieux avec leurs doctrines, pratiques et structures organisationnelles. Le soufisme a été capable, grâce à ses maîtres charismatiques et à ses structures organisationnelles souples, de se diffuser dans tout le monde islamique, mais aussi au-delà. Cette diffusion a impliqué le plus souvent la conversion à l’islam-soufisme de nouveaux disciples et, dans de rares cas, la création de formes syncrétiques d’un soufisme sans islam.
La double définition du soufisme que j’utiliserai dans ce livre correspond à la tension entre les termes arabes taṣawwuf et ṭarīqa. Taṣawwuf exprime une dimension dynamique, « le parcours de purification de l’âme » ou « la connaissance de Dieu » ; en fait, la science du taṣawwuf est, selon Ibn ʿArabī, al-ʿilm al-ummi, une « science illettrée » [1] ou « sur-lettrée »[2]. À l’inverse, ṭarīqa (« la voie ») désigne l’organisation religieuse, la confrérie qui a été, depuis plusieurs siècles et encore aujourd’hui, l’outil de transmission et de diffusion de la tradition soufie[3]
Cette double dimension du soufisme, en tant que tradition religieuse et connaissance-expérience mystique, a donné lieu à deux approches épistémologiques et méthodologiques différentes[4]. Certains chercheurs (généralement les philologues et les historiens) se sont focalisés sur les doctrines soufies, en laissant à l’arrière-plan les pratiques et la vie quotidienne des soufis, ou même en considérant les dimensions sociales comme une forme de décadence des idées nobles. D’autres (généralement les sociologues et les anthropologues) ont renversé cette perspective en considérant les idées comme d’importance secondaire. Ces deux approches antinomiques comportent des avantages et des inconvénients. Ceux qui se concentrent sur les discours et les idées risquent d’idéaliser et, parfois, de romancer le soufisme, en occultant la nature sociale du phénomène ; et les autres, d’accréditer une vision présentiste, c’est-à-dire l’incapacité à situer le soufisme contemporain dans son cours historique, considérant tous les phénomènes comme l’effet des influences sociales contemporaines. Dans cette étude, je chercherai à garder cette double perspective en essayant de lier ces deux approches.
Imaginons la relation complexe entre islam et soufisme comme deux cercles qui se croisent et changent de position au cours de l’histoire. Ils coïncident parfois parfaitement tandis que, dans d’autres contextes historiques et/ou géographiques, des différences importantes apparaissent. Nous ne devons pas concevoir ces orthodoxies comme séparées et monolithiques, car les premières critiques envers certaines pratiques et doctrines soufies ont été formulées par les soufis eux-mêmes[5]. Si les orthodoxies soufies et islamiques ont changé au cours des siècles, sous l’influence de plusieurs facteurs, les sujets qui ont suscité des polémiques sont souvent les mêmes : le rôle extraordinaire des maître soufis, appelés, comme les saints, les « amis de Dieu », les pratiques extatiques, l’exégèse allégorique-ésotérique, les pratiques liées aux tombeaux des saints, l’utilisation des rituels de guérison spirituelle-médicale et une certaine porosité avec les langages et les pratiques exogènes.
La séparation idéale entre islam et soufisme est une invention relativement récente, promue tout d’abord par le salafisme et le wahhabisme[6], dans une quête de pureté et de retour aux origines. Celle-ci a donné lieu à une véritable guerre contre le soufisme, dont on peut voir les conséquences dans les attentats terroristes en Égypte, au Pakistan et en Tunisie à partir des années 2010. Les wahhabites ont trouvé des alliés inattendus parmi certains intellectuels européens des XIXe et XXe siècles, qui cherchaient dans le soufisme des origines aryennes en opposition à un islam sémitique[7] ; certains voulaient démontrer l’origine chrétienne du soufisme[8], pendant que d’autres encore étaient en quête d’une religion universelle[9]. Tous cherchaient à minimiser l’islamité du soufisme. Aujourd’hui, elle ne fait plus débat dans le monde académique, ce qui n’empêche pas de saisir les influences exogènes passées et présentes qui ont contribué à former le soufisme.
Parmi les influences les plus importantes dans le soufisme contemporain, l’on trouve ce que l’on pourrait appeler l’« universalisation du soufisme »[10]. En effet, nous verrons dans ce livre que, dans différents domaines (académique, ésotérique et new age), des théories sur une religion universelle ont été formalisées et ont profondément influencé le soufisme contemporain. Parmi ces « apôtres de l’universalisme », l’on compte les chercheurs qui ont participé aux rencontres d’Eranos, en se focalisant sur les mythes, symboles et archétypes universels, comme Carl Gustav Jung, Henry Corbin, Louis Massignon, Gershom Scholem et Mircea Eliade[11]. L’ésotériste René Guénon, malgré lui, a initié le courant traditionaliste[12] axé sur le concept de « Tradition primordiale » et sur la critique de la modernité. Enfin, dans le milieu ésotérique ou new age de la société théosophique naît l’idée d’un culte universel, capable d’accueillir en même temps toutes les formes religieuses[13].
En dépit d’une certaine continuité entre ces différentes formes d’universalismes, ces courants ont donné lieu à des mouvements indépendants et souvent en opposition, présentant des différences doctrinales, éthiques et politiques. Enfin, nous ne devons pas oublier que la dialectique entre l’universel et le particulier fait partie de l’histoire du soufisme et de l’islam : il peut donc exister des universalismes tout à fait islamiques, avec des spécificités doctrinales, éthiques et politiques. Nous ne devons pas commettre l’erreur de penser qu’il n’existerait qu’une seule forme d’universalisme, ni que tous les universalismes seraient made in Europe.
Le processus d’universalisation ainsi qu’une certaine porosité du soufisme ont conduit à la formation de plusieurs stéréotypes dans l’opinion commune et le monde académique. Par exemple, certains considèrent que le soufisme incarne le « bon islam », par opposition à l’islamisme et au salafisme ; comme revers de la médaille, il s’agirait dès lors d’un islam domestiqué, soumis à la modernité occidentale. En se pliant à ces stéréotypes, ce soufisme serait une forme d’islam light, non lié à la charia. Il s’agirait d’un islam libéral et allié naturel de l’Occident.
Or, rien n’est plus faux que cette vision dichotomique. En effet, il existe plusieurs exemples de soufis islamistes et salafistes dans les sociétés contemporaines[14]. Nous verrons par ailleurs que, contrairement à ce que l’on peut imaginer, les musulmans les plus attachés à la charia sont souvent les plus progressistes, et qu’au sein des confréries soufies très influencées par la culture new age, l’on peut entendre des récits violemment antimodernistes et anti-démocratiques. Enfin, il est aussi vrai que certains soufis tirent profit de la recherche, dans l’opinion publique, du « bon musulman » et de la peur du salafisme pour imposer leur vision de l’islam, en occupant avec habileté le champ religieux islamique. Cela dit, ce soufisme engagé n’est pas forcément libéral ; nous avons constaté qu’il est, au contraire, plutôt conservateur.
Comme l’a souligné Michel de Certeau, la mystique hante l’épistémologie occidentale, car elle est un sujet souterrain, à la fois oublié et au cœur des sciences humaines[15]. Nous pourrions dire la même chose, mutatis mutandis, du soufisme dans l’histoire de l’islam, à la fois discours incontournable et présence inconfortable. Cette tension nous pousse à questionner et à réélaborer nos catégories heuristiques, non pas pour bâtir une nouvelle théorie totalisante, mais au contraire pour penser l’islam dans sa « contradiction cohérente »[16].
La diffusion du soufisme en Europe occidentale
La diffusion du soufisme en Europe occidentale contemporaine[17] et aux États-Unis a des causes multiples. L’une d’entre elles s’explique par un fort attrait artistique et esthétique : les poésies de Jalāl al-Dīn Rūmī (1207-1273), de Ḥāfeẓ (1315-1390) et de Farīd al-Dīn ʿAṭṭār (1145-1221) ont été traduites dans différentes langues européennes et ont eu un succès éditorial important. Aux États-Unis, Rūmī est ainsi devenu l’un des poètes les plus connus, dont les ouvrages deviennent des best-sellers et dont les poésies sont chantées par la pop star Madonna[18]. La littérature soufie n’est pas reléguée à l’époque du Moyen Âge. L’écrivaine turque Elif Shafak[19] en constitue un bon exemple : ses romans, traduits dans plusieurs langues, ont fait connaître le soufisme à un large public.
Ce processus d’« artification »[20] du soufisme concerne aussi la musique, tant au niveau de la diffusion de la musique « traditionnelle » (on pourrait citer les noms de Kudsi Ergüner, l’ensemble Rābiʿa, Abida Parveen, Nusrat Fateh Ali Khan, etc.) que dans sa réélaboration moderne influencée par les musiques occidentales : Allah-Rakha Rahman, Youssou N’Dour, Abd Al Malik, Franco Battiato ou encore Radiodervish. La musique soufie est aussi diffusée et connue à travers la bande sonore de films grand public, à l’instar de la musique soufie indienne dite qawwālī qui rythme les films Dead Man Walking et La dernière tentation du Christ[21].
Le soufisme est aussi un thème traité au cinéma, que ce soit dans des documentaires (notamment ceux d’Arnaud Desjardins22) ou dans des films, comme Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (2003), Rumi Returning. The Triumph of Divine Passion (2007) ou encore Mimosas, la voie de l’Atlas (2016). Le soufisme est aussi devenu un phénomène touristique. À ce titre, le samāʿ, musique-danse sacrée des « derviches tourneurs » de la confrérie Mevleviyya, fait l'objet de représentations destinées aux touristes à Istanbul et à Konya, et de tels spectacles ont été exportés dans les principales villes d’Europe. Ces nouvelles formes de marchandisation, désignées par Éric Geoffroy comme un « soufi business »[23], sont flagrantes sur les sites web comme Tripadvisor, où les rituels sont évalués comme des performances.
La diffusion du soufisme en Europe n’est pas limitée à ses aspects culturels ou à ses nouvelles formes, elle est surtout due aux musulmans d’origine maghrébine, pakistanaise, turque et subsaharienne, qui étaient des migrants et sont devenus peu à peu des citoyens européens. Ils ont d’abord « transplanté »[24] leurs confréries soufies et ont, par la suite, donné vie à un soufisme hybride en Europe. À son tour, ce soufisme a été influencé par le contexte social et culturel européen et par les convertis qui, au fur et à mesure, ont commencé à participer aux activités des confréries. Ces confréries transnationales et hybrides connaissent aujourd’hui un accroissement de leur nombre d’adhérents, car elles transmettent une tradition millénaire tout en faisant découvrir un autre islam aux musulmans, et une nouvelle religion aux non-musulmans. L’importance du soufisme en Europe se situe non seulement dans les domaines de l’art et de la culture, mais également dans les sciences et dans la politique. Le soufisme façonne désormais l’islam d’Europe, comme en retour l’islam européen influence l’islam global. La diffusion du soufisme en Europe pose d'ailleurs la question du processus d’hybridation qui fonctionne dans les deux sens. Le soufisme est un vecteur d’islamisation dans de nouvelles zones géographiques et, en retour, il absorbe certains éléments locaux. Nous devons donc oublier la question de « l’authenticité » pour nous concentrer sur les différentes conséquences du processus d’hybridation qu'impliquent toujours la transmission de la tradition et sa transformation.
Ma lecture s’écarte du biais du présentisme : cette époque est « exceptionnelle » comme toutes les autres, et par conséquent ce soufisme est « ordinaire » comme les autres. L’utilisation de catégories telles que new age, secte et ésotérisme, n’a pas de signification péjorative ; elle ne fustige pas non plus une non-conformité à l’idéal soufi-islamique traditionnel orthodoxe. Je m'attacherai au contraire à montrer que les nouvelles formes, comme le soufisme new age, sont contiguës aux anciennes et ont été rendues possibles grâce aux résonances importantes avec le soufisme historique.
Ce processus d’« artification »[20] du soufisme concerne aussi la musique, tant au niveau de la diffusion de la musique « traditionnelle » (on pourrait citer les noms de Kudsi Ergüner, l’ensemble Rābiʿa, Abida Parveen, Nusrat Fateh Ali Khan, etc.) que dans sa réélaboration moderne influencée par les musiques occidentales : Allah-Rakha Rahman, Youssou N’Dour, Abd Al Malik, Franco Battiato ou encore Radiodervish. La musique soufie est aussi diffusée et connue à travers la bande sonore de films grand public, à l’instar de la musique soufie indienne dite qawwālī qui rythme les films Dead Man Walking et La dernière tentation du Christ[21].
Le soufisme est aussi un thème traité au cinéma, que ce soit dans des documentaires (notamment ceux d’Arnaud Desjardins22) ou dans des films, comme Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (2003), Rumi Returning. The Triumph of Divine Passion (2007) ou encore Mimosas, la voie de l’Atlas (2016). Le soufisme est aussi devenu un phénomène touristique. À ce titre, le samāʿ, musique-danse sacrée des « derviches tourneurs » de la confrérie Mevleviyya, fait l'objet de représentations destinées aux touristes à Istanbul et à Konya, et de tels spectacles ont été exportés dans les principales villes d’Europe. Ces nouvelles formes de marchandisation, désignées par Éric Geoffroy comme un « soufi business »[23], sont flagrantes sur les sites web comme Tripadvisor, où les rituels sont évalués comme des performances.
La diffusion du soufisme en Europe n’est pas limitée à ses aspects culturels ou à ses nouvelles formes, elle est surtout due aux musulmans d’origine maghrébine, pakistanaise, turque et subsaharienne, qui étaient des migrants et sont devenus peu à peu des citoyens européens. Ils ont d’abord « transplanté »[24] leurs confréries soufies et ont, par la suite, donné vie à un soufisme hybride en Europe. À son tour, ce soufisme a été influencé par le contexte social et culturel européen et par les convertis qui, au fur et à mesure, ont commencé à participer aux activités des confréries. Ces confréries transnationales et hybrides connaissent aujourd’hui un accroissement de leur nombre d’adhérents, car elles transmettent une tradition millénaire tout en faisant découvrir un autre islam aux musulmans, et une nouvelle religion aux non-musulmans. L’importance du soufisme en Europe se situe non seulement dans les domaines de l’art et de la culture, mais également dans les sciences et dans la politique. Le soufisme façonne désormais l’islam d’Europe, comme en retour l’islam européen influence l’islam global. La diffusion du soufisme en Europe pose d'ailleurs la question du processus d’hybridation qui fonctionne dans les deux sens. Le soufisme est un vecteur d’islamisation dans de nouvelles zones géographiques et, en retour, il absorbe certains éléments locaux. Nous devons donc oublier la question de « l’authenticité » pour nous concentrer sur les différentes conséquences du processus d’hybridation qu'impliquent toujours la transmission de la tradition et sa transformation.
Ma lecture s’écarte du biais du présentisme : cette époque est « exceptionnelle » comme toutes les autres, et par conséquent ce soufisme est « ordinaire » comme les autres. L’utilisation de catégories telles que new age, secte et ésotérisme, n’a pas de signification péjorative ; elle ne fustige pas non plus une non-conformité à l’idéal soufi-islamique traditionnel orthodoxe. Je m'attacherai au contraire à montrer que les nouvelles formes, comme le soufisme new age, sont contiguës aux anciennes et ont été rendues possibles grâce aux résonances importantes avec le soufisme historique.
Terrains et méthodes
J’ai mené des enquêtes de terrain prolongées à Paris et à Milan entre 2013 et 2014, au sein des quatre confréries soufies transnationales : la Qādiriyya Būdshīshiyya des cheikhs Hamza al-Qādirī al-Būdshīshī et Jamāl al-Qādirī al-Būdshīshī, basée au Maroc et étudiée en France et en Italie ; la ʿAlāwiyya Darqāwiyya Shādhiliyya du cheikh Khaled Bentounes, basée en Algérie et étudiée en France ; la Naqshbandiyya-Ḥaqqāniyya des cheikhs Nāzim ʿAdil al-Qubrusī et Mehmet ʿAdil al-Ḥaqqāni, basée à Chypre et étudiée en France et en Italie ; enfin, l’Aḥmadiyya-Idrīsiyya Shādhiliyya des cheikhs Abd al-Wahid Pallavicini et Yahya Pallavicini, basée et étudiée en France et en Italie.
Ces enquêtes se sont déroulées sur une période de six à huit mois pour chaque confrérie. Cette immersion a impliqué de participer aux rencontres de prière hebdomadaires, aux fêtes religieuses et aux retraites spirituelles, aux événements non strictement religieux comme les conférences et les réunions et, enfin, de prendre part à des pèlerinages avec des disciples français et italiens dans les pays d’origine de ces confréries, au Maroc, en Algérie, à Chypre et en Turquie. Un peu avant la fin de chaque terrain, j’ai choisi entre huit et douze disciples pour recueillir des récits de vie. L’échantillonnage, dans la mesure du possible, a été conçu pour représenter au mieux l’hétérogénéité des participants, au regard des critères de l’âge, du genre, de l’appartenance à l’islam (conversion ou personne élevée dans la religion islamique) et du niveau d’éducation. Ce travail de terrain entrepris lors de mon doctorat25 a été enrichi lors de mes recherches post-doctorales en Belgique (KU Leuven, 2017-2019) et en Italie (Université de Venise, 2020-2022), où j'ai poursuivi mes recherches sur le soufisme entre l'Europe et l’Afrique du Nord.
Les rituels occupent une place centrale : ils forment une appartenance, permettent la création et re-création des liens entre les disciples, établissent des limites et, surtout, incarnent l’expression active de la théologie26. Essayer de comprendre comment les rituels changent et sont adaptés au contexte européen est fondamental ; cependant, je ne me suis pas penché uniquement sur la norme des rituels religieux. En suivant tant les théories de Goffman27 que celles de l’anthropologie contemporaine28, il faut aussi comprendre les rituels de la vie quotidienne : la construction de la parole du maître, les salutations entre les disciples et les interactions en jeu dans les « coulisses », en relation avec la partie visible et externe du procès, par exemple dans le but de comprendre comment l’on devient disciple et quelles sont les règles écrites et non-écrites. Les détails peuvent avoir leur importance dans le travail ethnographique. Un exemple éloquent est celui de la cigarette, qui m’a touché en tant que fumeur à cette époque : comment l’acte de fumer est-il perçu par les disciples ? Fument-ils ? Où le font-ils ? Nous verrons à ce propos qu’un détail en apparence marginal peut se révéler porteur de sens.
Ces enquêtes se sont déroulées sur une période de six à huit mois pour chaque confrérie. Cette immersion a impliqué de participer aux rencontres de prière hebdomadaires, aux fêtes religieuses et aux retraites spirituelles, aux événements non strictement religieux comme les conférences et les réunions et, enfin, de prendre part à des pèlerinages avec des disciples français et italiens dans les pays d’origine de ces confréries, au Maroc, en Algérie, à Chypre et en Turquie. Un peu avant la fin de chaque terrain, j’ai choisi entre huit et douze disciples pour recueillir des récits de vie. L’échantillonnage, dans la mesure du possible, a été conçu pour représenter au mieux l’hétérogénéité des participants, au regard des critères de l’âge, du genre, de l’appartenance à l’islam (conversion ou personne élevée dans la religion islamique) et du niveau d’éducation. Ce travail de terrain entrepris lors de mon doctorat25 a été enrichi lors de mes recherches post-doctorales en Belgique (KU Leuven, 2017-2019) et en Italie (Université de Venise, 2020-2022), où j'ai poursuivi mes recherches sur le soufisme entre l'Europe et l’Afrique du Nord.
Les rituels occupent une place centrale : ils forment une appartenance, permettent la création et re-création des liens entre les disciples, établissent des limites et, surtout, incarnent l’expression active de la théologie26. Essayer de comprendre comment les rituels changent et sont adaptés au contexte européen est fondamental ; cependant, je ne me suis pas penché uniquement sur la norme des rituels religieux. En suivant tant les théories de Goffman27 que celles de l’anthropologie contemporaine28, il faut aussi comprendre les rituels de la vie quotidienne : la construction de la parole du maître, les salutations entre les disciples et les interactions en jeu dans les « coulisses », en relation avec la partie visible et externe du procès, par exemple dans le but de comprendre comment l’on devient disciple et quelles sont les règles écrites et non-écrites. Les détails peuvent avoir leur importance dans le travail ethnographique. Un exemple éloquent est celui de la cigarette, qui m’a touché en tant que fumeur à cette époque : comment l’acte de fumer est-il perçu par les disciples ? Fument-ils ? Où le font-ils ? Nous verrons à ce propos qu’un détail en apparence marginal peut se révéler porteur de sens.
Limites de la recherche
Le choix de ces pays, France et Italie, a pour but de pallier une lacune : à la différence de l’Angleterre où le soufisme a été largement étudié[29], le soufisme français, bien qu’il soit parmi les plus importants en Europe[30], souffre d’un manque d’études socio-anthropologiques systématiques. Certains décrivent des aspects particuliers comme les rituels[31], ou se focalisent sur quelques confréries spécifiques[32], ou encore s’intéressent à une forme particulière de soufisme, comme le courant traditionaliste-guénonien[33]. Mais aucune vue d’ensemble n’est disponible. Concernant l’Italie, les articles de Speziale[34], Guolo[35], Abenante[36], Marchi[37], ainsi que le livre de Schmidt di Friedberg[38], constituent presque l’ensemble de la production universitaire italienne sur le sujet.
De plus, ce choix a été limité par des raisons logistiques de fait : l’approche ethnographique permet certes une analyse approfondie incomparable, mais elle exige des ressources notables. Envisager une comparaison plus large aurait été plus difficile. Au demeurant, les différences importantes entre la France et l’Italie, au niveau de l’histoire des migrations, des modèles d’intégration et des modèles de laïcité, nous offrent des confrontations analytiques enrichissantes.
Bien que les terrains aient été menés en France et en Italie, je propose d’étendre mes analyses à l’Europe pour les raisons suivantes : d’une part, la majorité des confréries soufies abordées sont également présentes dans d’autres pays européens, et les formes agrégatives ainsi que les tendances théologiques semblent a priori ne pas être très différentes. Les influences structurelles sur le soufisme, comme le new age et les milieux ésotéristes, sont similaires dans toute l’Europe. Pendant mon enquête, en particulier lors de mes voyages dans les pays d’origine, j’ai rencontré des disciples belges, allemands, anglais, espagnols, etc. Sans avoir étudié le soufisme dans toute l’Europe, il est possible, à mon sens, de décrire les tendances principales du phénomène européen à partir des cas français et italien.
Pour autant, cette étiquette de « soufisme européen » ne prétend pas décrire avec exhaustivité tous les phénomènes soufis présents sur le continent. Chaque confrérie a ses particularités : inclure ou exclure une confrérie soufie revient à ajouter ou perdre une variante du phénomène. Or, cette recherche s’est concentrée sur les processus d’hybridation du soufisme européen. Je n’ai donc pas étudié les confréries provenant d’Afrique subsaharienne ou du subcontinent indien, qui sont souvent des confréries « transplantées », formées exclusivement de migrants de première et de seconde générations, et caractérisées par un groupe ethnique homogène. Ces confréries reproduisent les doctrines, les rituels et les structures des pays d’origine, et fonctionnent souvent comme réseaux et « chambres d’acclimatation » pour les nouveaux migrants arrivés en Europe[39]. Enfin, il existe d’autres formes de soufisme qui ne seront pas traitées dans ce livre, comme l’utilisation des récits soufis hors du cadre confrérique par des mouvements qui se définissent comme progressistes[40], ou encore le soufisme dés-islamisé comme celui des « Danses de la Paix Universelle »[41].
Ce livre se compose de huit chapitres. Les deux premiers développeront le cadre général du soufisme en tant que connaissance mystique et en tant que tradition discursive. Dans le troisième seront décrits les pionniers du soufisme en Europe, qui ont contribué à construire et à imaginer le soufisme d’aujourd’hui ; ce sera alors l’occasion de clarifier l’emploi des catégories de l’ésotérisme et du new age. Les chapitres 4 à 7 seront chacun dédiés à une confrérie. Enfin, dans le chapitre de conclusion seront évoquées la présence du soufisme européen dans la sphère publique, la relation complexe qu’il entretient avec la modernité et sa place dans l’islam européen et méditerranéen.
De plus, ce choix a été limité par des raisons logistiques de fait : l’approche ethnographique permet certes une analyse approfondie incomparable, mais elle exige des ressources notables. Envisager une comparaison plus large aurait été plus difficile. Au demeurant, les différences importantes entre la France et l’Italie, au niveau de l’histoire des migrations, des modèles d’intégration et des modèles de laïcité, nous offrent des confrontations analytiques enrichissantes.
Bien que les terrains aient été menés en France et en Italie, je propose d’étendre mes analyses à l’Europe pour les raisons suivantes : d’une part, la majorité des confréries soufies abordées sont également présentes dans d’autres pays européens, et les formes agrégatives ainsi que les tendances théologiques semblent a priori ne pas être très différentes. Les influences structurelles sur le soufisme, comme le new age et les milieux ésotéristes, sont similaires dans toute l’Europe. Pendant mon enquête, en particulier lors de mes voyages dans les pays d’origine, j’ai rencontré des disciples belges, allemands, anglais, espagnols, etc. Sans avoir étudié le soufisme dans toute l’Europe, il est possible, à mon sens, de décrire les tendances principales du phénomène européen à partir des cas français et italien.
Pour autant, cette étiquette de « soufisme européen » ne prétend pas décrire avec exhaustivité tous les phénomènes soufis présents sur le continent. Chaque confrérie a ses particularités : inclure ou exclure une confrérie soufie revient à ajouter ou perdre une variante du phénomène. Or, cette recherche s’est concentrée sur les processus d’hybridation du soufisme européen. Je n’ai donc pas étudié les confréries provenant d’Afrique subsaharienne ou du subcontinent indien, qui sont souvent des confréries « transplantées », formées exclusivement de migrants de première et de seconde générations, et caractérisées par un groupe ethnique homogène. Ces confréries reproduisent les doctrines, les rituels et les structures des pays d’origine, et fonctionnent souvent comme réseaux et « chambres d’acclimatation » pour les nouveaux migrants arrivés en Europe[39]. Enfin, il existe d’autres formes de soufisme qui ne seront pas traitées dans ce livre, comme l’utilisation des récits soufis hors du cadre confrérique par des mouvements qui se définissent comme progressistes[40], ou encore le soufisme dés-islamisé comme celui des « Danses de la Paix Universelle »[41].
Ce livre se compose de huit chapitres. Les deux premiers développeront le cadre général du soufisme en tant que connaissance mystique et en tant que tradition discursive. Dans le troisième seront décrits les pionniers du soufisme en Europe, qui ont contribué à construire et à imaginer le soufisme d’aujourd’hui ; ce sera alors l’occasion de clarifier l’emploi des catégories de l’ésotérisme et du new age. Les chapitres 4 à 7 seront chacun dédiés à une confrérie. Enfin, dans le chapitre de conclusion seront évoquées la présence du soufisme européen dans la sphère publique, la relation complexe qu’il entretient avec la modernité et sa place dans l’islam européen et méditerranéen.
Qui suis-je ? Le statut et le positionnement de l’ethnologue en question
Une note éthique et méthodologique importante concerne mon statut et l’objet de ma recherche, qui ont toujours été clairement exposés aux disciples et maîtres soufis que j’ai côtoyés durant des années. J’ai systématiquement demandé l’autorisation au responsable local de suivre la confrérie, ce qui s’est souvent traduit par une bénédiction de sa part. Ma présence a été à la fois invisible et visible. Invisible d’abord, parce que j’ai essayé de me faire discret : je n’ai pas pris de notes pendant les terrains, et j’ai rarement enregistré les discours, pris des photos ou enregistré des vidéos. Visible aussi car, lorsque l’on me posait des questions sur mes recherches ou sur ma religiosité, j’ai répondu franchement, parfois même au risque de heurter quelques sensibilités. Cette sincérité m’a beaucoup aidé, tant pour créer des liens de confiance qu’au niveau heuristique, dans la mesure où les discussions m’ont aidé à dépasser certains aspects convenus.
Sur le terrain, j’ai pratiqué tous les rituels musulmans et soufis, comme la prière, le dhikr et la ḥaḍra. J’ai embrassé la main du maître soufi quand l’étiquette le demandait, c’est-à-dire que j’ai adopté le « bon comportement » au sein de la confrérie. Parfois, j’ai été invité à pratiquer les rituels malgré ma non-appartenance religieuse, peut-être dans l’espoir de me convertir ; mais la plupart du temps, les disciples n’ont pas prêté attention à ma présence parmi eux. Une seule confrérie a fait exception, celle dont les disciples m’ont fait comprendre qu’il aurait été inopportun de pratiquer des rituels sans être officiellement converti.
La religiosité de l’anthropologue ou du sociologue est souvent un argument tabou dans les débats scientifiques, mais aussi un secret de Polichinelle : tout le monde en parle, mais cela fait rarement l’objet d’une production écrite. Je doute que l’appartenance ou non à un mouvement religieux puisse donner plus de profondeur à une analyse ou, au contraire, la rendre moins efficace, car la capacité à élaborer le langage socio-anthropologique n’a rien à voir avec les pratiques religieuses du chercheur. Cela dit, je préfère clarifier ma position, par honnêteté intellectuelle : mon intérêt pour le soufisme et la mystique en général remonte à mes premières années d’études universitaires en philosophie. À l’époque comme aujourd’hui, je trouvais plus audacieuses et fascinantes les pensées de maître Eckhart et d’Ibn ʿArabī que la philosophie de Martin Heidegger ou celle d’Emmanuele Severino qui dominaient la plupart des débats, du moins à la faculté de philosophie de l’Université Ca’ Foscari de Venise. Cet attrait intellectuel m’a conduit à devenir chercheur, et à consacrer plusieurs années de ma vie à ce sujet ; mais il n’a abouti ni à une pratique ni à une croyance religieuse spécifiques. J’ai observé ce principe dans mes interactions avec les disciples durant l’enquête. En effet, interrogé sur ma foi, je répondais que je « ne savais pas », que je menais « une quête », que j’étais un « agnostique curieux », ou que je me sentais proche du monothéisme. Dans certains contextes plutôt conservateurs et traditionalistes, ma non-appartenance religieuse a déplu, parce que mes interlocuteurs préféraient établir des frontières religieuses claires, frontières que la suspension agnostique du jugement ne permet pas. Enfin, dans d’autres contextes, ma présence a été interprétée comme une disposition possible à la conversion. Toutes ces différences entre les confréries m’ont aidé à mieux comprendre les différentes approches du soufisme, comme les techniques variées de prosélytisme.
Mais malgré cette volonté de transparence, plusieurs disciples soufis ont vu en moi des qualités spirituelles et un travail progressif de purification. D’autres ont interprété ma recherche comme un signe providentiel. Un cheikh dira même : « Dieu nous a envoyé un sociologue » (cf. infra, chapitre 7). Plusieurs m’ont considéré comme un « frère ». Bien évidemment, je ne pouvais accepter ni rejeter cette forme d’inclusion sur les plans ésotérique et invisible. J’ai donc dû m’accommoder de cette ambivalence entre mon rôle de chercheur et le sens métaphysique que certains disciples attribuaient à ma présence parmi eux. Cette ambivalence n’est pas une nouveauté dans les recherches au sein de mouvements religieux42. En effet, comme le souligne William Shaffir, lors d’une enquête de terrain et malgré une approche ouverte et transparente, nous ne contrôlons pas pleinement la façon dont nous sommes perçus, et il reste toujours une certaine forme de « tromperie »[43] à l’égard des participants.
Mon approche ontologique des phénomènes religieux est proche de l’« agnosticisme méthodologique »44 qui demande au chercheur de suspendre les grandes questions métaphysiques, laissant possible l’existence d’un au-delà, à la différence de l’« athéisme méthodologique »[45] qui postule que tous les faits religieux sont le résultat d’une construction sociale. Cette approche possibiliste m’a permis d’affronter des sujets délicats comme l’extase et les miracles, sans interroger la véridicité de l’expérience religieuse, mais plutôt en me focalisant sur la façon dont cette expérience est vécue, pratiquée, décrite et transmise. Si l’agnosticisme méthodologique est désormais devenu un cadre dominant en sciences sociales, plusieurs chercheurs questionnent sa validité depuis quelques années. Par exemple, l’anthropologue Joel Kahn[46] propose une épistémologie syncrétique entre gnosticisme et sciences humaines et sociales, qui permettrait de dépasser certains réductionnismes de l’anthropologie en rapprochant différentes ontologies. Parmi les figures-clés de cette nouvelle perspective épistémologique, l’on retrouve René Guénon, ésotériste converti au soufisme, et l’un des protagonistes de ce livre.
Je considère que cette anthropologie gnostique pose plus de problèmes qu’elle n’en résout, surtout en ce qui concerne ses applications concrètes et la division nette qu’elle opère entre séculier et religieux, à laquelle je n’adhère pas. Néanmoins, la « provocation épistémologique » de Kahn nous invite à poser d’autres questions pertinentes pour cette étude. Tout d’abord, Kahn propose de remettre au centre la question des universels, abandonnés après les « abus » du XXe siècle mais qui, nous le verrons, sont encore d’actualité. Deuxièmement, il nous demande implicitement ce qu’un anthropologue peut apprendre des religions et des gnostiques en particulier. Autrement dit, dans notre cas, qu’est-ce qu’un anthropologue peut apprendre des soufis ? Cette question m’a été posée plusieurs fois, tant dans le monde académique que par mes amis et connaissances.
Mais dans mon expérience personnelle, les échanges que j’ai eus durant plusieurs années de terrain de recherche avec les disciples et confréries soufis n’ont pas seulement abordé la sphère de l’ontologie, comme Kahn l’aurait souhaité. Cela ne signifie pas que je n’aie rien appris ou que je sois resté insensible aux expériences et enseignements soufis. Mais, plutôt que de se livrer à de grands discours métaphysiques et épistémologiques, nous avons parlé de la vie quotidienne. Avec les soufis protagonistes de cette recherche, j’ai fait l’expérience de valeurs que je considérais comme miennes – comme l’hospitalité, le respect, la modestie, la compassion, l’honnêteté, la justice – mais qui étaient articulées et vécues de façons différentes. Avec les disciples soufis, j’ai eu la chance de réfléchir à la question de l’ego et à la manière dont il affecte notre vie privée et professionnelle ; ego qui est souvent sanctifié dans le monde professionnel, y compris académique. Ces différences et continuités m’ont poussé à questionner mes présupposés épistémologiques, éthiques, politiques et moraux.
Une telle expérience de l’altérité, qu’elle prenne place en banlieue parisienne ou milanaise, ou dans le désert algérien, ainsi que ce questionnement personnel et scientifique, m’ont conduit dans la direction opposée à celle de Kahn. Au lieu de penser la mystique comme irréductible à la pensée moderne et séculière, j’ai perçu avec plus d’acuité les chevauchements entre les différentes cultures, religions et pensées. J’ai aussi perçu d’autres chevauchements, comme une certaine continuité entre la douce mélancolie de certaines chansons soufies et la musique blues-jazz-rock avec laquelle j’ai grandi. Peut-être s’agit-il d’effets de résonance dus à l’influence islamique exercée sur les premières formes de blues (bien reconnue par les historiens et musicologues[47]) ; ou peut-être ai-je alors ressenti une forme de réminiscence, pour reprendre le langage platonicien[48], ou une blue melody, pour citer la chanson de Tim Buckley[49]. Comme l’a décrit Thomas Tweed, je me suis retrouvé au seuil de mondes différents[50]. À mon sens, cette altérité radicale n’est pas un animal sauvage à domestiquer avec nos catégories, elle est plutôt une possibilité non encore réalisée ; ce que Joel Robbins décrit comme le fondement de l’espoir d’un présent encore inconnu[51].
Sur le terrain, j’ai pratiqué tous les rituels musulmans et soufis, comme la prière, le dhikr et la ḥaḍra. J’ai embrassé la main du maître soufi quand l’étiquette le demandait, c’est-à-dire que j’ai adopté le « bon comportement » au sein de la confrérie. Parfois, j’ai été invité à pratiquer les rituels malgré ma non-appartenance religieuse, peut-être dans l’espoir de me convertir ; mais la plupart du temps, les disciples n’ont pas prêté attention à ma présence parmi eux. Une seule confrérie a fait exception, celle dont les disciples m’ont fait comprendre qu’il aurait été inopportun de pratiquer des rituels sans être officiellement converti.
La religiosité de l’anthropologue ou du sociologue est souvent un argument tabou dans les débats scientifiques, mais aussi un secret de Polichinelle : tout le monde en parle, mais cela fait rarement l’objet d’une production écrite. Je doute que l’appartenance ou non à un mouvement religieux puisse donner plus de profondeur à une analyse ou, au contraire, la rendre moins efficace, car la capacité à élaborer le langage socio-anthropologique n’a rien à voir avec les pratiques religieuses du chercheur. Cela dit, je préfère clarifier ma position, par honnêteté intellectuelle : mon intérêt pour le soufisme et la mystique en général remonte à mes premières années d’études universitaires en philosophie. À l’époque comme aujourd’hui, je trouvais plus audacieuses et fascinantes les pensées de maître Eckhart et d’Ibn ʿArabī que la philosophie de Martin Heidegger ou celle d’Emmanuele Severino qui dominaient la plupart des débats, du moins à la faculté de philosophie de l’Université Ca’ Foscari de Venise. Cet attrait intellectuel m’a conduit à devenir chercheur, et à consacrer plusieurs années de ma vie à ce sujet ; mais il n’a abouti ni à une pratique ni à une croyance religieuse spécifiques. J’ai observé ce principe dans mes interactions avec les disciples durant l’enquête. En effet, interrogé sur ma foi, je répondais que je « ne savais pas », que je menais « une quête », que j’étais un « agnostique curieux », ou que je me sentais proche du monothéisme. Dans certains contextes plutôt conservateurs et traditionalistes, ma non-appartenance religieuse a déplu, parce que mes interlocuteurs préféraient établir des frontières religieuses claires, frontières que la suspension agnostique du jugement ne permet pas. Enfin, dans d’autres contextes, ma présence a été interprétée comme une disposition possible à la conversion. Toutes ces différences entre les confréries m’ont aidé à mieux comprendre les différentes approches du soufisme, comme les techniques variées de prosélytisme.
Mais malgré cette volonté de transparence, plusieurs disciples soufis ont vu en moi des qualités spirituelles et un travail progressif de purification. D’autres ont interprété ma recherche comme un signe providentiel. Un cheikh dira même : « Dieu nous a envoyé un sociologue » (cf. infra, chapitre 7). Plusieurs m’ont considéré comme un « frère ». Bien évidemment, je ne pouvais accepter ni rejeter cette forme d’inclusion sur les plans ésotérique et invisible. J’ai donc dû m’accommoder de cette ambivalence entre mon rôle de chercheur et le sens métaphysique que certains disciples attribuaient à ma présence parmi eux. Cette ambivalence n’est pas une nouveauté dans les recherches au sein de mouvements religieux42. En effet, comme le souligne William Shaffir, lors d’une enquête de terrain et malgré une approche ouverte et transparente, nous ne contrôlons pas pleinement la façon dont nous sommes perçus, et il reste toujours une certaine forme de « tromperie »[43] à l’égard des participants.
Mon approche ontologique des phénomènes religieux est proche de l’« agnosticisme méthodologique »44 qui demande au chercheur de suspendre les grandes questions métaphysiques, laissant possible l’existence d’un au-delà, à la différence de l’« athéisme méthodologique »[45] qui postule que tous les faits religieux sont le résultat d’une construction sociale. Cette approche possibiliste m’a permis d’affronter des sujets délicats comme l’extase et les miracles, sans interroger la véridicité de l’expérience religieuse, mais plutôt en me focalisant sur la façon dont cette expérience est vécue, pratiquée, décrite et transmise. Si l’agnosticisme méthodologique est désormais devenu un cadre dominant en sciences sociales, plusieurs chercheurs questionnent sa validité depuis quelques années. Par exemple, l’anthropologue Joel Kahn[46] propose une épistémologie syncrétique entre gnosticisme et sciences humaines et sociales, qui permettrait de dépasser certains réductionnismes de l’anthropologie en rapprochant différentes ontologies. Parmi les figures-clés de cette nouvelle perspective épistémologique, l’on retrouve René Guénon, ésotériste converti au soufisme, et l’un des protagonistes de ce livre.
Je considère que cette anthropologie gnostique pose plus de problèmes qu’elle n’en résout, surtout en ce qui concerne ses applications concrètes et la division nette qu’elle opère entre séculier et religieux, à laquelle je n’adhère pas. Néanmoins, la « provocation épistémologique » de Kahn nous invite à poser d’autres questions pertinentes pour cette étude. Tout d’abord, Kahn propose de remettre au centre la question des universels, abandonnés après les « abus » du XXe siècle mais qui, nous le verrons, sont encore d’actualité. Deuxièmement, il nous demande implicitement ce qu’un anthropologue peut apprendre des religions et des gnostiques en particulier. Autrement dit, dans notre cas, qu’est-ce qu’un anthropologue peut apprendre des soufis ? Cette question m’a été posée plusieurs fois, tant dans le monde académique que par mes amis et connaissances.
Mais dans mon expérience personnelle, les échanges que j’ai eus durant plusieurs années de terrain de recherche avec les disciples et confréries soufis n’ont pas seulement abordé la sphère de l’ontologie, comme Kahn l’aurait souhaité. Cela ne signifie pas que je n’aie rien appris ou que je sois resté insensible aux expériences et enseignements soufis. Mais, plutôt que de se livrer à de grands discours métaphysiques et épistémologiques, nous avons parlé de la vie quotidienne. Avec les soufis protagonistes de cette recherche, j’ai fait l’expérience de valeurs que je considérais comme miennes – comme l’hospitalité, le respect, la modestie, la compassion, l’honnêteté, la justice – mais qui étaient articulées et vécues de façons différentes. Avec les disciples soufis, j’ai eu la chance de réfléchir à la question de l’ego et à la manière dont il affecte notre vie privée et professionnelle ; ego qui est souvent sanctifié dans le monde professionnel, y compris académique. Ces différences et continuités m’ont poussé à questionner mes présupposés épistémologiques, éthiques, politiques et moraux.
Une telle expérience de l’altérité, qu’elle prenne place en banlieue parisienne ou milanaise, ou dans le désert algérien, ainsi que ce questionnement personnel et scientifique, m’ont conduit dans la direction opposée à celle de Kahn. Au lieu de penser la mystique comme irréductible à la pensée moderne et séculière, j’ai perçu avec plus d’acuité les chevauchements entre les différentes cultures, religions et pensées. J’ai aussi perçu d’autres chevauchements, comme une certaine continuité entre la douce mélancolie de certaines chansons soufies et la musique blues-jazz-rock avec laquelle j’ai grandi. Peut-être s’agit-il d’effets de résonance dus à l’influence islamique exercée sur les premières formes de blues (bien reconnue par les historiens et musicologues[47]) ; ou peut-être ai-je alors ressenti une forme de réminiscence, pour reprendre le langage platonicien[48], ou une blue melody, pour citer la chanson de Tim Buckley[49]. Comme l’a décrit Thomas Tweed, je me suis retrouvé au seuil de mondes différents[50]. À mon sens, cette altérité radicale n’est pas un animal sauvage à domestiquer avec nos catégories, elle est plutôt une possibilité non encore réalisée ; ce que Joel Robbins décrit comme le fondement de l’espoir d’un présent encore inconnu[51].
Références
_____________________
[1] Gril Denis, 1996, « Les débuts du soufisme », in A. Popovic, G. Veinstein (dir.), Les Voies d’Allah. Les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, Paris, Fayard, 137.
[2] Expression utilisée par Éric Geoffroy lors d’un séminaire à Paris le 8 mars 2020 au Forum 104.
[3] Popovic Alexandre, Veinstein Gilles (dir.), 1996, op. cit.
[4] Knysh Alexander, 2017, Sufism: A New History of Islamic Mysticism, Princeton, Princeton University Press.
[5] Pensons par exemple à Aḥmad al-Fārūqī al-Sirhindī (1564-1624) et à sa critique d’Ibn ʿArabī (1165-1240). Cf. Green Nile, 2012, Sufism: a global history, Malden, Wiley-Blackwell.
[6] Ce mouvement politico-religieux naît en Arabie au XVIIIe siècle.
[7] Renan Ernest, 1867, Averroès et l’averroïsme, Paris, Michel Lévy frères ; Palmer Edward H., 2013, Oriental Mysticism: A Treatise on Sufistic and Unitarian Theosophy of the Persians, Londres, Routledge.
[8]Palacios Miguel A., 1919, La escatología musulmana en la Divina Comedia, Madrid, E. Maestre.
[9] Pfleiderer Otto, 1907, Religion and Historic Faiths, Londres, Fisher Unwin.
[10] Ce processus a fait l’objet d’un séminaire organisé à l’École des Hautes études en sciences sociales (EHESS) en 2019-2020 à l’initiative de Nadège Chabloz, puis en 2020-2021 par Nadège Chabloz et moi-même.
[11] Wasserstrom Steven M., 2001, Religion after Religion: Gershom Scholem, Mircea Eliade, and Henry Corbin at Eranos, Princeton, Princeton University Press ; Hanegraaff Wouter J., 2012, Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture, Cambridge, Cambridge University Press ; Hakl Hans T., 2012, Eranos: An Alternative Intellectual History of the Twentieth Century, Montréal, McGill-Queen’s University Press.
[12] Sedgwick Mark, 2004, op. cit.
[13] Godwin Joscelyn, 2013, “Blavatsky and the First Generation of Theosophy”, in O. Hammer, M. Rothstein (eds), Handbook of the Theosophical Current, Leyde, Brill, 13-31.
[14] Howell Julia D., 2010, “Indonesia’s Salafist Sufis”, Modern Asian Studies, vol. 44, n° 5, 1029-1051 ; Philippon Alix, 2015, « "Bons soufis" et "mauvais islamistes". La sociologie à l’épreuve de l’idéologie », Social Compass, vol. 62, n° 2, 187-198.
[15] Certeau Michel (de), 1982, La fable mystique : XVIe-XVIIe siècles, Paris, Gallimard.
[16] Ahmed Shahab, 2015, What is Islam? The Importance of Being Islamic, Princeton, Princeton University Press, 405.
[17] Il faut souligner que le soufisme s’est diffusé dans les Balkans à partir du XIIIe siècle (cf. Popovic Alexandre, 2006, « Les turuq balkaniques à l’épreuve de la modernité », Archives de sciences sociales des religions, vol. 135, 141-163) et que des confréries soufies étaient présentes en Andalousie et en Sicile au Moyen-Âge (cf. Barone Francesco, 2003, « Islām in Sicilia nel XIIe/XIIIe secolo: ortoprassi, scienze religiose e tasawwuf », Incontri mediterranei. Rivista semestrale di storia e cultura, vol. 6, n° 2, 104-115 ; Arkoun Mohammed, 2006, Histoire de l’islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours, Paris, Albin Michel ; Ebstein Steven M., 2014, Mysticism and Philosophy in al-Andalus: Ibn Masarra, Ibn al-ʿArabi and the Ismaʿili Tradition, Leyde-Boston, Brill).
[18] Irwin Robert, 2019, “Global Rumi”, in F. Piraino, M. Sedgwick (eds), Global Sufism. Boundaries, Structures, and Politics, Londres, Hurst, 15-34 ; Haviland Charles, 2007, “The roar of Rumi - 800 years on”, BBC News.
[19] Shafak Elif, 2010, Soufi, mon amour, Paris, Phébus ; 2007, The Bastard of Istanbul, New York, Viking.
[20] Shapiro Roberta, 2019, “Artification as Process”, Cultural Sociology, vol. 13, n° 3, 265-275.
[21] Hermansen Marcia K., 2000, “Hybrid Identity Formations in Muslim America”, Muslim World, vol. 90, n° 1, 158-198
[22] Desjardins Arnaud, 1974, « Documentaires soufis d’Afghanistan : maître et disciple », Dailymotion, En ligne : [https://www.dailymotion.com/video/x5tmob ].
[23] Geoffroy Éric, 2009b, Le soufisme. Voie intérieure de l’Islam, Paris, Points, 307.
[24] Hermansen Marcia K., 2004, “What’s American about American Sufi Movements?”, in D. Westerlund (ed.), Sufism in Europe and North America, Londres-New York, Routledge-Curzon, 40-63.
[25] Doctorat mené à la Scuola Normale Superiore et à l’EHESS entre 2011 et 2016.
[26] Goffman Erving, 1956, The Presentation of Self in Everyday Life, Édimbourg, University of Edinburgh ; Collins Randall, 2014, Interaction ritual chains, Princeton, Princeton University Press.
[27] Goffman Erving, 1956, op. cit.
[28] Schielke Samuli, 2010, “Second thoughts about the anthropology of Islam, or how to make sense of grand schemes in everyday life”, Zentrum Moderner Orient Working Papers, n° 2, 1-27 ; McGuire Meredith B., 2008, Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life, Oxford-New York, Oxford University Press.
[29] Notamment par Geaves Ron, 2000, The Sufis of Britain: An Exploration of Muslim Identity, Cardiff, Cardiff Academic Press ; Werbner Pnina, 2003, Pilgrims of Love: The Anthropology of A Global Sufi Cult, Bloomington, Indiana University Press ; 2013, Sufism in Britain, New York, Bloomsbury Academic ; Stjernholm Simon, 2010, “Sufi politics in Britain: the Sufi Muslim Council and the ‘silent majority’ of Muslims”, Journal of Islamic Law and Culture, vol. 12, n° 3, 215-226.
[30] Westerlund David (ed.), 2004, op. cit.
[31] Nabti Mehdi, 2007, « Des soufis en banlieue parisienne. Mise en scène d’une spiritualité musulmane », Archives de sciences sociales des religions, vol. 140, 49-68.
[32] Voix Raphaël, 2004, « Implantation d’une confrérie marocaine en France : mécanismes, méthodes, et acteurs », Ateliers d’anthropologie, revue éditée par le Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, vol. 28, 1-54 ; Cottin Sylvie, 2007, « La Tijâniyya lyonnaise. Une voie dans son temps », Archives de sciences sociales des religions, vol. 140, 69-89.
[33] Zarcone Thierry, Vale Juliet, 1999, “Rereadings and Transformations of Sufism in the West”, Diogène, vol. 47, n° 187, 110-121 ; Bisson David, 2007, « Soufisme et Tradition. L’influence de René Guénon sur l’islam soufi européen », Archives de sciences sociales des religions, vol. 140, 29-47 ; Le Pape Loïc, 2007, « Engagement religieux, engagements politiques. Conversions dans une confrérie musulmane », Archives de sciences sociales des religions, vol. 140, 9-27.
[34] Speziale Fabrizio, 2005, “Adapting Mystic Identity to Italian Mainstream Islam: The Case of a Muslim Rom Community in Florence”, Balkanologie. Revue d’études pluridisciplinaires, vol. 9, n° 1-2, 195-211.
[35] Guolo Renzo, 2001, « L’islam nascosto. Adattamento e trasformazione della religiosità nella confraternita senegalese muride in Italia », Sociologia urbana e rurale, vol. 64, 265-274.
[36] Abenante Paola, 2016, “Essentializing Difference: Text, Knowledge, and Ritual Performance in a Sufi Brotherhood in Italy”, in I. Weinrich (ed.), Performing Religion: Actors, Contexts, and Texts. Case studies on Islam, Beyrouth, Ergon-Verlag, 219-234 ; Abenante Paola, 2004, « La tariqa Burhaniyya, una via del ’Islam in Italia », Afriche e Orienti, vol. 3, 163-171.
[37] Marchi Alessandra, 2009, « Il sufismo in Italia: molteplici vie per vivere l’Islam », Religioni e Società, vol. 65, 53-60.
[38] Schmidt di Friedberg Ottavia, 2006, Islam, solidarietà e lavoro: i muridi senegalesi in Italia, Turin, Fondation Giovanni Agnelli.
[39] Bava Sophie, 2000, « Reconversions et nouveaux mondes commerciaux des mourides à Marseille », Hommes & Migrations, vol. 1224, 46-55.
[40] Bidar Abdennour, 2016, Self islam : histoire d’un islam personnel, Paris, Seuil ; 2004, Un islam pour notre temps, Paris, Points ; voir également le site web de l’association Voix d’un Islam éclairé (VIE) : http://www. voix–islam–eclaire.fr.
[41] Sedgwick Mark, 2016, op. cit
[42] Sutcliffe Steven, 2003, Children of the New Age: A History of Spiritual Practices, Londres, Routledge.
[43] Shaffir William B., 1991, “Managing a Convincing Self-Presentation: Some Personal Reflections on Entering the Field”, in R. Stebbins, W. B. Shaffir (eds), Experiencing Fieldwork: An Inside View of Qualitative Research, Thousand Oaks, SAGE Publications, 77.
[44] Porpora Douglas V., 2006, “Methodological Atheism, Methodological Agnosticism and Religious Experience”, Journal for the Theory of Social Behaviour, vol. 36, n° 1, 57-75.
[45] Berger Peter L., 1967, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, Garden City, Doubleday.
[46] Kahn Joel, 2016, Asia, Modernity and the Pursuit of the Sacred, Londres, Palgrave Macmillan.
[47] El-Shibli Fatima, 2007, “Islam and the Blues”, Souls, vol. 9, n° 2, 162-170.
[48] Platon, v. 360 av. J.-C., Phédon, Paris, Ellipses, 72e-77b.
[49] Buckley Tim, 1969, “Blue Melody”, dans l’album Blue Afternoon, Los Angeles, Straight Records.
[50] Tweed Thomas A., 2002, “On Moving Across: Translocative Religion and the Interpreter’s Position”, Journal of the American Academy of Religion, vol. 70, n° 2, 253-277.
[51] Robbins Joel, 2006, “Anthropology and Theology: An Awkward Relationship?”, Anthropological Quarterly, vol. 79, n° 2, 285-294.
[1] Gril Denis, 1996, « Les débuts du soufisme », in A. Popovic, G. Veinstein (dir.), Les Voies d’Allah. Les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, Paris, Fayard, 137.
[2] Expression utilisée par Éric Geoffroy lors d’un séminaire à Paris le 8 mars 2020 au Forum 104.
[3] Popovic Alexandre, Veinstein Gilles (dir.), 1996, op. cit.
[4] Knysh Alexander, 2017, Sufism: A New History of Islamic Mysticism, Princeton, Princeton University Press.
[5] Pensons par exemple à Aḥmad al-Fārūqī al-Sirhindī (1564-1624) et à sa critique d’Ibn ʿArabī (1165-1240). Cf. Green Nile, 2012, Sufism: a global history, Malden, Wiley-Blackwell.
[6] Ce mouvement politico-religieux naît en Arabie au XVIIIe siècle.
[7] Renan Ernest, 1867, Averroès et l’averroïsme, Paris, Michel Lévy frères ; Palmer Edward H., 2013, Oriental Mysticism: A Treatise on Sufistic and Unitarian Theosophy of the Persians, Londres, Routledge.
[8]Palacios Miguel A., 1919, La escatología musulmana en la Divina Comedia, Madrid, E. Maestre.
[9] Pfleiderer Otto, 1907, Religion and Historic Faiths, Londres, Fisher Unwin.
[10] Ce processus a fait l’objet d’un séminaire organisé à l’École des Hautes études en sciences sociales (EHESS) en 2019-2020 à l’initiative de Nadège Chabloz, puis en 2020-2021 par Nadège Chabloz et moi-même.
[11] Wasserstrom Steven M., 2001, Religion after Religion: Gershom Scholem, Mircea Eliade, and Henry Corbin at Eranos, Princeton, Princeton University Press ; Hanegraaff Wouter J., 2012, Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture, Cambridge, Cambridge University Press ; Hakl Hans T., 2012, Eranos: An Alternative Intellectual History of the Twentieth Century, Montréal, McGill-Queen’s University Press.
[12] Sedgwick Mark, 2004, op. cit.
[13] Godwin Joscelyn, 2013, “Blavatsky and the First Generation of Theosophy”, in O. Hammer, M. Rothstein (eds), Handbook of the Theosophical Current, Leyde, Brill, 13-31.
[14] Howell Julia D., 2010, “Indonesia’s Salafist Sufis”, Modern Asian Studies, vol. 44, n° 5, 1029-1051 ; Philippon Alix, 2015, « "Bons soufis" et "mauvais islamistes". La sociologie à l’épreuve de l’idéologie », Social Compass, vol. 62, n° 2, 187-198.
[15] Certeau Michel (de), 1982, La fable mystique : XVIe-XVIIe siècles, Paris, Gallimard.
[16] Ahmed Shahab, 2015, What is Islam? The Importance of Being Islamic, Princeton, Princeton University Press, 405.
[17] Il faut souligner que le soufisme s’est diffusé dans les Balkans à partir du XIIIe siècle (cf. Popovic Alexandre, 2006, « Les turuq balkaniques à l’épreuve de la modernité », Archives de sciences sociales des religions, vol. 135, 141-163) et que des confréries soufies étaient présentes en Andalousie et en Sicile au Moyen-Âge (cf. Barone Francesco, 2003, « Islām in Sicilia nel XIIe/XIIIe secolo: ortoprassi, scienze religiose e tasawwuf », Incontri mediterranei. Rivista semestrale di storia e cultura, vol. 6, n° 2, 104-115 ; Arkoun Mohammed, 2006, Histoire de l’islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours, Paris, Albin Michel ; Ebstein Steven M., 2014, Mysticism and Philosophy in al-Andalus: Ibn Masarra, Ibn al-ʿArabi and the Ismaʿili Tradition, Leyde-Boston, Brill).
[18] Irwin Robert, 2019, “Global Rumi”, in F. Piraino, M. Sedgwick (eds), Global Sufism. Boundaries, Structures, and Politics, Londres, Hurst, 15-34 ; Haviland Charles, 2007, “The roar of Rumi - 800 years on”, BBC News.
[19] Shafak Elif, 2010, Soufi, mon amour, Paris, Phébus ; 2007, The Bastard of Istanbul, New York, Viking.
[20] Shapiro Roberta, 2019, “Artification as Process”, Cultural Sociology, vol. 13, n° 3, 265-275.
[21] Hermansen Marcia K., 2000, “Hybrid Identity Formations in Muslim America”, Muslim World, vol. 90, n° 1, 158-198
[22] Desjardins Arnaud, 1974, « Documentaires soufis d’Afghanistan : maître et disciple », Dailymotion, En ligne : [https://www.dailymotion.com/video/x5tmob ].
[23] Geoffroy Éric, 2009b, Le soufisme. Voie intérieure de l’Islam, Paris, Points, 307.
[24] Hermansen Marcia K., 2004, “What’s American about American Sufi Movements?”, in D. Westerlund (ed.), Sufism in Europe and North America, Londres-New York, Routledge-Curzon, 40-63.
[25] Doctorat mené à la Scuola Normale Superiore et à l’EHESS entre 2011 et 2016.
[26] Goffman Erving, 1956, The Presentation of Self in Everyday Life, Édimbourg, University of Edinburgh ; Collins Randall, 2014, Interaction ritual chains, Princeton, Princeton University Press.
[27] Goffman Erving, 1956, op. cit.
[28] Schielke Samuli, 2010, “Second thoughts about the anthropology of Islam, or how to make sense of grand schemes in everyday life”, Zentrum Moderner Orient Working Papers, n° 2, 1-27 ; McGuire Meredith B., 2008, Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life, Oxford-New York, Oxford University Press.
[29] Notamment par Geaves Ron, 2000, The Sufis of Britain: An Exploration of Muslim Identity, Cardiff, Cardiff Academic Press ; Werbner Pnina, 2003, Pilgrims of Love: The Anthropology of A Global Sufi Cult, Bloomington, Indiana University Press ; 2013, Sufism in Britain, New York, Bloomsbury Academic ; Stjernholm Simon, 2010, “Sufi politics in Britain: the Sufi Muslim Council and the ‘silent majority’ of Muslims”, Journal of Islamic Law and Culture, vol. 12, n° 3, 215-226.
[30] Westerlund David (ed.), 2004, op. cit.
[31] Nabti Mehdi, 2007, « Des soufis en banlieue parisienne. Mise en scène d’une spiritualité musulmane », Archives de sciences sociales des religions, vol. 140, 49-68.
[32] Voix Raphaël, 2004, « Implantation d’une confrérie marocaine en France : mécanismes, méthodes, et acteurs », Ateliers d’anthropologie, revue éditée par le Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, vol. 28, 1-54 ; Cottin Sylvie, 2007, « La Tijâniyya lyonnaise. Une voie dans son temps », Archives de sciences sociales des religions, vol. 140, 69-89.
[33] Zarcone Thierry, Vale Juliet, 1999, “Rereadings and Transformations of Sufism in the West”, Diogène, vol. 47, n° 187, 110-121 ; Bisson David, 2007, « Soufisme et Tradition. L’influence de René Guénon sur l’islam soufi européen », Archives de sciences sociales des religions, vol. 140, 29-47 ; Le Pape Loïc, 2007, « Engagement religieux, engagements politiques. Conversions dans une confrérie musulmane », Archives de sciences sociales des religions, vol. 140, 9-27.
[34] Speziale Fabrizio, 2005, “Adapting Mystic Identity to Italian Mainstream Islam: The Case of a Muslim Rom Community in Florence”, Balkanologie. Revue d’études pluridisciplinaires, vol. 9, n° 1-2, 195-211.
[35] Guolo Renzo, 2001, « L’islam nascosto. Adattamento e trasformazione della religiosità nella confraternita senegalese muride in Italia », Sociologia urbana e rurale, vol. 64, 265-274.
[36] Abenante Paola, 2016, “Essentializing Difference: Text, Knowledge, and Ritual Performance in a Sufi Brotherhood in Italy”, in I. Weinrich (ed.), Performing Religion: Actors, Contexts, and Texts. Case studies on Islam, Beyrouth, Ergon-Verlag, 219-234 ; Abenante Paola, 2004, « La tariqa Burhaniyya, una via del ’Islam in Italia », Afriche e Orienti, vol. 3, 163-171.
[37] Marchi Alessandra, 2009, « Il sufismo in Italia: molteplici vie per vivere l’Islam », Religioni e Società, vol. 65, 53-60.
[38] Schmidt di Friedberg Ottavia, 2006, Islam, solidarietà e lavoro: i muridi senegalesi in Italia, Turin, Fondation Giovanni Agnelli.
[39] Bava Sophie, 2000, « Reconversions et nouveaux mondes commerciaux des mourides à Marseille », Hommes & Migrations, vol. 1224, 46-55.
[40] Bidar Abdennour, 2016, Self islam : histoire d’un islam personnel, Paris, Seuil ; 2004, Un islam pour notre temps, Paris, Points ; voir également le site web de l’association Voix d’un Islam éclairé (VIE) : http://www. voix–islam–eclaire.fr.
[41] Sedgwick Mark, 2016, op. cit
[42] Sutcliffe Steven, 2003, Children of the New Age: A History of Spiritual Practices, Londres, Routledge.
[43] Shaffir William B., 1991, “Managing a Convincing Self-Presentation: Some Personal Reflections on Entering the Field”, in R. Stebbins, W. B. Shaffir (eds), Experiencing Fieldwork: An Inside View of Qualitative Research, Thousand Oaks, SAGE Publications, 77.
[44] Porpora Douglas V., 2006, “Methodological Atheism, Methodological Agnosticism and Religious Experience”, Journal for the Theory of Social Behaviour, vol. 36, n° 1, 57-75.
[45] Berger Peter L., 1967, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, Garden City, Doubleday.
[46] Kahn Joel, 2016, Asia, Modernity and the Pursuit of the Sacred, Londres, Palgrave Macmillan.
[47] El-Shibli Fatima, 2007, “Islam and the Blues”, Souls, vol. 9, n° 2, 162-170.
[48] Platon, v. 360 av. J.-C., Phédon, Paris, Ellipses, 72e-77b.
[49] Buckley Tim, 1969, “Blue Melody”, dans l’album Blue Afternoon, Los Angeles, Straight Records.
[50] Tweed Thomas A., 2002, “On Moving Across: Translocative Religion and the Interpreter’s Position”, Journal of the American Academy of Religion, vol. 70, n° 2, 253-277.
[51] Robbins Joel, 2006, “Anthropology and Theology: An Awkward Relationship?”, Anthropological Quarterly, vol. 79, n° 2, 285-294.

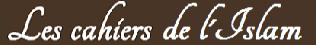











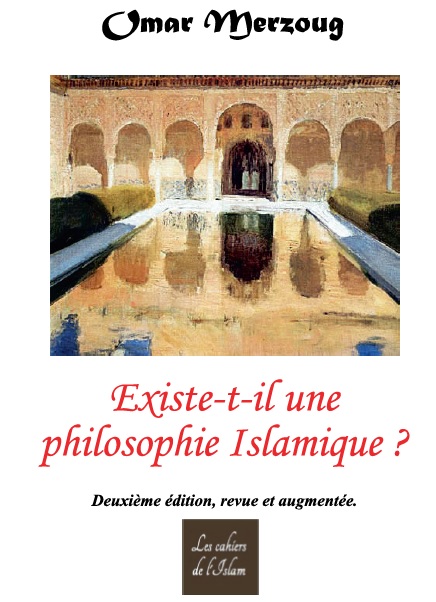



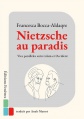








![La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane [Extrait] La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane [Extrait]](https://www.lescahiersdelislam.fr/photo/art/imagette_16_9/87789924-62224472.jpg?v=1746139916)









