"Le soufisme en Europe. Islam, New Age et ésotérisme", [...], constitue un jalon important des recherches contemporaines sur le soufisme en Europe de l’Ouest en proposant une observation systématisée des différentes confréries françaises et italiennes – Būdshīshiyya, ʿAlāwiyya, Naqshabandiyya Haqqaniyya et Aḥmadiyya-Idrīsiyya Shādhiliyya. F. Piraino appréhende le soufisme de ces confréries transnationales comme un phénomène expansif, plastique et attractif. La perspective intègre ainsi des jeux d’échelles entre espace national (Italie, France) et logiques transrégionales (Maroc, Algérie, Chypre), et fait dialoguer socio-anthropologie du religieux et islamologie appliquée.Samir Abdelli
Cette recension a déjà fait l'objet d'une publication dans les Cahiers d'études du religieux [En ligne], 26 | 2024, mis en ligne le 01 janvier 2024, sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0 ).
Broché: 408 pages
Editeur : Karthala (26 mai 2023)
Collection : IRMC
Langue : Français
ISBN-13: 978-2384090853
Editeur : Karthala (26 mai 2023)
Collection : IRMC
Langue : Français
ISBN-13: 978-2384090853
Quatrième de couverture
Le soufisme, la dimension spirituelle, mystique et ésotérique de l'islam, est dans une phase d'expansion au XXIe siècle, guidé par des maîtres charismatiques qui renouvellent leur langage, en attirant de nouveaux disciples et en dépassant leurs cadres culturels et géographiques d'origine.
Ce livre décrit le développement du soufisme en Europe occidentale, en particulier en France et en Italie, à travers une recherche empirique prolongée et fondée sur l'observation participante dans quatre confréries soufies à Paris et à Milan : la ʿAlawiyya, la Budshishiyya, la Naqshbandiyya Haqqaniyya et la Aḥmadiyya-Idrisiyya Shadhiliyya.
Dans une perspective réflexive en socio-anthropologie des religions, l'auteur montre la tension présente dans le soufisme contemporain entre la scientia experimentalis, la mystique axée sur l'expérience directe du divin, autorisant une certaine créativité, et la sacra doctrina, la tradition axée sur les textes sacrés, qui reproduit les structures et l'ordre moral islamique.
Il décrit également les différentes formes d'hybridation entre la tradition islamique-soufie, le discours ésotérique occidental, notamment guénonien-traditionaliste, et le discours new age. Ces hybridations comportent souvent la création de nouveaux rituels, doctrines, et structures organisationnelles, et donnent lieu à des discours universalistes variés. Enfin, l'ouvrage discute les différentes options politiques du soufisme en Europe, comme le désintérêt dû à une attente eschatologique imminente, l'engagement citoyen et l'élitisme métapolitique.
Francesco Piraino a obtenu son doctorat en sociologie en 2016 à la Scuola Normale Superiore (Florence) et à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), et a été chercheur Marie Curie à la KU Leuven. Il est actuellement chercheur postdoctoral à l'Université Ca' Foscari et directeur du Centre d'études comparées des civilisations et des spiritualités de la Fondation Cini à Venise. Il a récemment publié Global Sufism : Boundaries, Structures, Politics (Hurst, 2019) et Esoteric Transfers and Constructions : Judaism, Christianity, and Islam (Palgrave, 2021) avec Mark Sedgwick.
Ce livre décrit le développement du soufisme en Europe occidentale, en particulier en France et en Italie, à travers une recherche empirique prolongée et fondée sur l'observation participante dans quatre confréries soufies à Paris et à Milan : la ʿAlawiyya, la Budshishiyya, la Naqshbandiyya Haqqaniyya et la Aḥmadiyya-Idrisiyya Shadhiliyya.
Dans une perspective réflexive en socio-anthropologie des religions, l'auteur montre la tension présente dans le soufisme contemporain entre la scientia experimentalis, la mystique axée sur l'expérience directe du divin, autorisant une certaine créativité, et la sacra doctrina, la tradition axée sur les textes sacrés, qui reproduit les structures et l'ordre moral islamique.
Il décrit également les différentes formes d'hybridation entre la tradition islamique-soufie, le discours ésotérique occidental, notamment guénonien-traditionaliste, et le discours new age. Ces hybridations comportent souvent la création de nouveaux rituels, doctrines, et structures organisationnelles, et donnent lieu à des discours universalistes variés. Enfin, l'ouvrage discute les différentes options politiques du soufisme en Europe, comme le désintérêt dû à une attente eschatologique imminente, l'engagement citoyen et l'élitisme métapolitique.
Francesco Piraino a obtenu son doctorat en sociologie en 2016 à la Scuola Normale Superiore (Florence) et à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), et a été chercheur Marie Curie à la KU Leuven. Il est actuellement chercheur postdoctoral à l'Université Ca' Foscari et directeur du Centre d'études comparées des civilisations et des spiritualités de la Fondation Cini à Venise. Il a récemment publié Global Sufism : Boundaries, Structures, Politics (Hurst, 2019) et Esoteric Transfers and Constructions : Judaism, Christianity, and Islam (Palgrave, 2021) avec Mark Sedgwick.
Recension
Par Samir Abdelli
Le soufisme en Europe. Islam, New Age et ésotérisme, ouvrage issu de la thèse de Francesco Piraino [1], constitue un jalon important des recherches contemporaines sur le soufisme en Europe de l’Ouest en proposant une observation systématisée des différentes confréries françaises et italiennes – Būdshīshiyya, ʿAlāwiyya, Naqshabandiyya Haqqaniyya et Aḥmadiyya-Idrīsiyya Shādhiliyya. F. Piraino appréhende le soufisme de ces confréries transnationales comme un phénomène expansif, plastique et attractif. La perspective intègre ainsi des jeux d’échelles entre espace national (Italie, France) et logiques transrégionales (Maroc, Algérie, Chypre), et fait dialoguer socio-anthropologie du religieux et islamologie appliquée. Les enquêtes de terrain menées sur le temps long, entre Paris et Milan, et fondées sur de nombreux entretiens qualitatifs, mettent en perspective les parcours biographiques des adeptes, les fonctionnements des organisations confrériques et les activités sociales, politiques et culturelles qui leur sont liées. Les entretiens sont complétés par des ethnographies des assises rituelles, quotidiennes et ponctuelles (ijtimāh, ziyārat ou mawled al-nabawī) ainsi que de diverses activités organisées par les confréries (conférences, rencontres-débats ou soirées-concerts).
Partant du cadre conceptuel de la modernité religieuse [2] et de la construction d’un islam européen [3], les recherches de F. Piraino illustrent le fait que la diffusion du soufisme en Europe s’articule dans une tension constante avec le référentiel et la normativité islamiques. Le soufisme est appréhendé dans sa dimension vécue, quotidienne et sociale, tout en prenant en compte ses dimensions historique, doctrinale et philosophique, à rebours d’une vision présentiste. F. Piraino observe différents groupes confrériques dans lesquels se côtoient des musulmans socialisés à l’islam dans l’enfance et l’adolescence, des convertis devenus musulmans à l’âge adulte et des adeptes soufis qui ne s’identifient pas comme musulmans. Il démontre la façon dont l’espace d’implantation d’une confrérie, le fait générationnel et les enjeux de transmission d’une tradition participent à sa mutation. In fine, ce travail permet à F. Piraino de déconstruire un certain nombre de présupposés – le soufisme et l’islam seraient deux éléments distincts ; le soufisme serait un islam « light », « domestiqué » (p. 235) ; le soufisme serait ouvert, libéral ; le soufisme serait apolitique. En s’inspirant des recherches menées sur les espaces anglo-saxons [4], F. Piraino rend compte des imbrications des registres discursifs – islamique, ésotérique et New Age – associés à des pratiques – dhikr, méditation ou usage d’ennéagramme – dans la formulation d’un soufisme européen qui revêt les contours d’une religion universelle.
Les observations de terrain révèlent que les formes d’organisation soufies correspondent peu aux catégories de la sociologie des religions (église, secte, groupe mystique, nouveaux mouvements religieux) et aux idéaux-types qui en émanent (prêtre, sorcier, prophète). À l’inverse, les structures soufies se caractérisent par une certaine fluidité et nécessitent une conceptualisation souple afin d’éviter toute catégorisation trop rigide ou de relativiser la pluralité des formes qui les composent. Ce faisant, F. Piraino analyse le soufisme par une double tension, inspirée du modèle de Danièle Hervieu-Léger et remaniée, qui fait l’objet des deux premiers chapitres [5]. Le soufisme est d’abord entendu comme une Scientia experimentalis, une expérience mystique, comprise comme une mystique, une imagination vivificatrice et indépendante de toute structure religieuse – ce type d’expérience jouant un rôle moteur dans la construction des phénomènes religieux (p. 29-50). Il est aussi compris comme une Sacra doctrina, une doctrine sacrée, entendue comme « tradition discursive [6] », théodicée et structure religieuse, inscrite sur le temps long, des débuts du soufisme dès le viiie siècle au « soufisme global » contemporain. Ainsi, la doctrine soufie serait à la fois porteuse d’une « régénération-revivification » du message religieux et d’une force créatrice qui déborde le cadre religieux lui-même (p. 51-66). Le troisième chapitre est dédié aux origines du soufisme en Europe (p. 67-111) et présente les différents vecteurs ayant participé à sa diffusion et sa construction. Migrants soufis, acteurs et théoriciens de l’ésotérisme européen, du New Age et universitaires religieux ont contribué au développement du soufisme en Europe au long du xxe siècle. Les quatre chapitres suivants constituent des monographies des confréries et couvrent les configurations et déclinaisons possibles des organisations soufies, les modalités d’initiation et de transmission, l’éventail des positions doctrinales et de pratiques rituelles promues et adoptées, la position du curseur vis-à-vis du fiqh, de la sharīʿa et du référentiel islamique mais aussi de la sociologie des acteurs et des activités sociales, culturelles et politiques.
Les enquêtes de terrain menées par F. Piraino font écho à celles dédiées aux mouvements soufis aux États-Unis [7], au Canada [8] et au Royaume-Uni [9]. L’enquête menée sur la Būdshīshiyya démontre que le type de confrérie « transplantée », caractérisée par la dimension ethnique, s’avère modulable en fonction de l’espace de transplantation ; hybride en France, transplantée en Italie. L’étude de l’Aḥmadiyya-Idrīsiyya Shādhiliyya illustre un autre aspect de cette fluidité puisqu’il s’agit d’une confrérie guénonienne, dans laquelle le soufisme est intellectuel et élitiste (les discussions métaphysiques prennent le pas sur les rituels soufis), mais qui va progressivement revenir à une dimension plus centrée sur les référentiels islamiques lors de la succession du maître – d’Abd al-Wahid Pallivicini à son fils Yahya Pallivicini. La confrérie Naqshbandiyya Ḥaqqāniyya (en Italie plus qu’en France) oscille quant à elle entre le modèle de confrérie islamique et celui d’une confrérie désislamisée, perméable aux influences du New Age, et pratiques de « bricolage » religieux. Cette tendance s’observe tant par les figures de leadership (« spiritual trainers », p. 271) que par les modalités d’initiation ou les doctrines et rituels eux-mêmes ou par les activités proposées (des « purifications spéciales » du Burhanuddin Hermann, p. 279, au « spectacle soufi » de Hassan Dyck, p. 280).
F. Piraino aborde la diffusion du soufisme au prisme des différentes formes discursives – l’islam-soufi des migrants, l’ésotérisme traditionaliste, les études universitaires du soufisme et le New Age – qui contribuent collectivement à la fabrique du soufisme européen sans (forcément) impacter sa dimension doctrinale, rituelle et organisationnelle. C’est le cas pour les confréries ʿAlāwiyya, Būdshīshiyya et Naqshbandiyya qui conservent leurs doctrines, rituels et organisations en proposant un format discursif aux couleurs d’un islam intellectuel, éthique et spirituel pour une audience européenne. Une telle entreprise, promotrice d’un « humanisme islamique » (p. 345), est portée par des leaders soufis (tels que Khaled Bentounes, Faouzi Skali ou encore Abdelhafid Benchouk) dans l’optique de répondre aussi bien à la quête individualisée de musulmans qu’au souci de transmission générationnelle ou de participation citoyenne [10]. Par exemple, au nom de ce même humanisme, le cheikh Bentounes, président de l’AISA ONG, est à l’initiative de la Journée Mondiale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) adoptée par l’ONU et célébrée le 16 mai depuis 2017. Quelques cas font exception, notamment dans le soufisme transplanté qui apparait de manière subsidiaire dans cette enquête, pour lesquels le discours soufi peut s’avérer bien plus totalisant et structurant d’un point de vue doctrinal, rituel et organisationnel. Dans ces cas-là, on retrouve l’idée de « cultural binary fission [11] » où l’organisation confrérique constitue un miroir reproduisant des communautés d’origine et où la société environnante n’exerce que peu d’influence. Le soufisme éclaté ou New Age, lui, s’apparente au format du pick and mix et marque (souvent) une séparation entre islam et soufisme. L’offre proposée par les « entrepreneurs spirituels » fait état de la malléabilité doctrinale et rituelle qui laisse aux disciples une grande latitude dans l’accommodation de pratiques tournées vers le bien-être mental, corporel et l’esthétique. Ici, c’est donc la perméabilité et l’imbrication des courants ésotériques (« cultic milieu ») et New Age qui sont observées dans ces formes de soufisme européen.
Les recherches menées sur les cas français et italien témoignent de la façon dont le soufisme européen contemporain se ramifie, se restructure et se réinvente en mobilisant des registres variés et des processus créatifs qui dépassent souvent l’identification revendiquée par les acteurs et les jeux d’assignations. Si l’exhaustivité n’est pas recherchée, elle soulève des interrogations et mobilise des outils conceptuels qui méritent d’être étendus au paysage confrérique européen marqué par le morcellement et la multiplication du maillage soufi. Appréhender les soufismes européens en mobilisant les confréries soufies ayant une renommée moins diffuse, par les « petites confréries », permettrait également d’enrichir le tableau ici présenté, de proposer d’autres formes de déclinaisons possibles de ces « langages » et ces structures et d’éclairer dynamiques et enjeux de ce marché religieux.
Samir Abdelli, « Francesco Piraino, Le soufisme en Europe. Islam, ésotérisme et New Age », Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires [En ligne], 26 | 2024, mis en ligne le 01 janvier 2024, consulté le 16 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org.janus.bis-sorbonne.fr/cerri/9327 ; DOI : https://doi-org.janus.bis-sorbonne.fr/10.4000/120gw
Partant du cadre conceptuel de la modernité religieuse [2] et de la construction d’un islam européen [3], les recherches de F. Piraino illustrent le fait que la diffusion du soufisme en Europe s’articule dans une tension constante avec le référentiel et la normativité islamiques. Le soufisme est appréhendé dans sa dimension vécue, quotidienne et sociale, tout en prenant en compte ses dimensions historique, doctrinale et philosophique, à rebours d’une vision présentiste. F. Piraino observe différents groupes confrériques dans lesquels se côtoient des musulmans socialisés à l’islam dans l’enfance et l’adolescence, des convertis devenus musulmans à l’âge adulte et des adeptes soufis qui ne s’identifient pas comme musulmans. Il démontre la façon dont l’espace d’implantation d’une confrérie, le fait générationnel et les enjeux de transmission d’une tradition participent à sa mutation. In fine, ce travail permet à F. Piraino de déconstruire un certain nombre de présupposés – le soufisme et l’islam seraient deux éléments distincts ; le soufisme serait un islam « light », « domestiqué » (p. 235) ; le soufisme serait ouvert, libéral ; le soufisme serait apolitique. En s’inspirant des recherches menées sur les espaces anglo-saxons [4], F. Piraino rend compte des imbrications des registres discursifs – islamique, ésotérique et New Age – associés à des pratiques – dhikr, méditation ou usage d’ennéagramme – dans la formulation d’un soufisme européen qui revêt les contours d’une religion universelle.
Les observations de terrain révèlent que les formes d’organisation soufies correspondent peu aux catégories de la sociologie des religions (église, secte, groupe mystique, nouveaux mouvements religieux) et aux idéaux-types qui en émanent (prêtre, sorcier, prophète). À l’inverse, les structures soufies se caractérisent par une certaine fluidité et nécessitent une conceptualisation souple afin d’éviter toute catégorisation trop rigide ou de relativiser la pluralité des formes qui les composent. Ce faisant, F. Piraino analyse le soufisme par une double tension, inspirée du modèle de Danièle Hervieu-Léger et remaniée, qui fait l’objet des deux premiers chapitres [5]. Le soufisme est d’abord entendu comme une Scientia experimentalis, une expérience mystique, comprise comme une mystique, une imagination vivificatrice et indépendante de toute structure religieuse – ce type d’expérience jouant un rôle moteur dans la construction des phénomènes religieux (p. 29-50). Il est aussi compris comme une Sacra doctrina, une doctrine sacrée, entendue comme « tradition discursive [6] », théodicée et structure religieuse, inscrite sur le temps long, des débuts du soufisme dès le viiie siècle au « soufisme global » contemporain. Ainsi, la doctrine soufie serait à la fois porteuse d’une « régénération-revivification » du message religieux et d’une force créatrice qui déborde le cadre religieux lui-même (p. 51-66). Le troisième chapitre est dédié aux origines du soufisme en Europe (p. 67-111) et présente les différents vecteurs ayant participé à sa diffusion et sa construction. Migrants soufis, acteurs et théoriciens de l’ésotérisme européen, du New Age et universitaires religieux ont contribué au développement du soufisme en Europe au long du xxe siècle. Les quatre chapitres suivants constituent des monographies des confréries et couvrent les configurations et déclinaisons possibles des organisations soufies, les modalités d’initiation et de transmission, l’éventail des positions doctrinales et de pratiques rituelles promues et adoptées, la position du curseur vis-à-vis du fiqh, de la sharīʿa et du référentiel islamique mais aussi de la sociologie des acteurs et des activités sociales, culturelles et politiques.
Les enquêtes de terrain menées par F. Piraino font écho à celles dédiées aux mouvements soufis aux États-Unis [7], au Canada [8] et au Royaume-Uni [9]. L’enquête menée sur la Būdshīshiyya démontre que le type de confrérie « transplantée », caractérisée par la dimension ethnique, s’avère modulable en fonction de l’espace de transplantation ; hybride en France, transplantée en Italie. L’étude de l’Aḥmadiyya-Idrīsiyya Shādhiliyya illustre un autre aspect de cette fluidité puisqu’il s’agit d’une confrérie guénonienne, dans laquelle le soufisme est intellectuel et élitiste (les discussions métaphysiques prennent le pas sur les rituels soufis), mais qui va progressivement revenir à une dimension plus centrée sur les référentiels islamiques lors de la succession du maître – d’Abd al-Wahid Pallivicini à son fils Yahya Pallivicini. La confrérie Naqshbandiyya Ḥaqqāniyya (en Italie plus qu’en France) oscille quant à elle entre le modèle de confrérie islamique et celui d’une confrérie désislamisée, perméable aux influences du New Age, et pratiques de « bricolage » religieux. Cette tendance s’observe tant par les figures de leadership (« spiritual trainers », p. 271) que par les modalités d’initiation ou les doctrines et rituels eux-mêmes ou par les activités proposées (des « purifications spéciales » du Burhanuddin Hermann, p. 279, au « spectacle soufi » de Hassan Dyck, p. 280).
F. Piraino aborde la diffusion du soufisme au prisme des différentes formes discursives – l’islam-soufi des migrants, l’ésotérisme traditionaliste, les études universitaires du soufisme et le New Age – qui contribuent collectivement à la fabrique du soufisme européen sans (forcément) impacter sa dimension doctrinale, rituelle et organisationnelle. C’est le cas pour les confréries ʿAlāwiyya, Būdshīshiyya et Naqshbandiyya qui conservent leurs doctrines, rituels et organisations en proposant un format discursif aux couleurs d’un islam intellectuel, éthique et spirituel pour une audience européenne. Une telle entreprise, promotrice d’un « humanisme islamique » (p. 345), est portée par des leaders soufis (tels que Khaled Bentounes, Faouzi Skali ou encore Abdelhafid Benchouk) dans l’optique de répondre aussi bien à la quête individualisée de musulmans qu’au souci de transmission générationnelle ou de participation citoyenne [10]. Par exemple, au nom de ce même humanisme, le cheikh Bentounes, président de l’AISA ONG, est à l’initiative de la Journée Mondiale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) adoptée par l’ONU et célébrée le 16 mai depuis 2017. Quelques cas font exception, notamment dans le soufisme transplanté qui apparait de manière subsidiaire dans cette enquête, pour lesquels le discours soufi peut s’avérer bien plus totalisant et structurant d’un point de vue doctrinal, rituel et organisationnel. Dans ces cas-là, on retrouve l’idée de « cultural binary fission [11] » où l’organisation confrérique constitue un miroir reproduisant des communautés d’origine et où la société environnante n’exerce que peu d’influence. Le soufisme éclaté ou New Age, lui, s’apparente au format du pick and mix et marque (souvent) une séparation entre islam et soufisme. L’offre proposée par les « entrepreneurs spirituels » fait état de la malléabilité doctrinale et rituelle qui laisse aux disciples une grande latitude dans l’accommodation de pratiques tournées vers le bien-être mental, corporel et l’esthétique. Ici, c’est donc la perméabilité et l’imbrication des courants ésotériques (« cultic milieu ») et New Age qui sont observées dans ces formes de soufisme européen.
Les recherches menées sur les cas français et italien témoignent de la façon dont le soufisme européen contemporain se ramifie, se restructure et se réinvente en mobilisant des registres variés et des processus créatifs qui dépassent souvent l’identification revendiquée par les acteurs et les jeux d’assignations. Si l’exhaustivité n’est pas recherchée, elle soulève des interrogations et mobilise des outils conceptuels qui méritent d’être étendus au paysage confrérique européen marqué par le morcellement et la multiplication du maillage soufi. Appréhender les soufismes européens en mobilisant les confréries soufies ayant une renommée moins diffuse, par les « petites confréries », permettrait également d’enrichir le tableau ici présenté, de proposer d’autres formes de déclinaisons possibles de ces « langages » et ces structures et d’éclairer dynamiques et enjeux de ce marché religieux.
Samir Abdelli, « Francesco Piraino, Le soufisme en Europe. Islam, ésotérisme et New Age », Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires [En ligne], 26 | 2024, mis en ligne le 01 janvier 2024, consulté le 16 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org.janus.bis-sorbonne.fr/cerri/9327 ; DOI : https://doi-org.janus.bis-sorbonne.fr/10.4000/120gw
Références
_____________________
[1] Francesco Piraino, Le développement du soufisme en Europe. Au-delà de l’antinomie modernité et tradition : thèse de doctorat, EHESS/Scuola Normale Superiore, France/Italie, 2016.
[2] Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire : Paris, Cerf, 1993.
[3] Stefano Allievi, Les convertis à l’islam. Les nouveaux musulmans d’Europe : Paris, L’Harmattan, 1999.
[4] Elliott Bazzano & Marcia Hermansen (eds), Varieties of American Sufism: Islam, Sufi Orders, and Authority in a Time of Transition : New York, SUNY Press, 2020 ; Theodore Gabriel & Ron Geaves, Sufism in Britain : London, Bloomsbury, 2014.
[5] Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti : Paris, Flammarion, 1999, p. 71-78.
[6] Notion empruntée à Talal Asad qui exprime un discours liant éthique, pratique et rapports de pouvoir autour de l’idée de « croyance correcte » ou d’orthodoxie qui influence le présent, se voit légitimée par le passé et se projette vers le futur (p. 53-54). Voir Talal Asad, « L’idée d’une anthropologie de l’islam », traduit de l’anglais par Mattia Gallo & Pierre Lassave, Archives des sciences sociales des religions 180 (2017) (« The Idea of an Anthropology of Islam », Washington, Georgetown University, Occasional Papers Series, 1986, p. 117-137).
[7] Sophia Rose Arjana, Buying Buddhas, Selling Rumi: Orientalism and the Mystical Marketplace : London, One World Academic, 2020 ; E. Bazzano & M. Hermansen (eds), Varieties of American Sufism, op. cit.
[8] Merin Shobhana Xavier, The Dervishes of the North. Rumi, Whirling, and Making of Sufism in Canada : Toronto, University of Toronto Press, 2023.
[9] Ron Geaves, The Sufis of Britain: An Exploration of Muslim Identity : Cardiff, Cardiff Academic Press, 2000.
[10] Mark Sedgwick, « In Search of a Counter-Reformation: Anti-Sufi Stereotypes and the Budshishiyya’s Response », in Michaelle Browers & Charles Kurzman (eds), An Islamic Reformation ? : Oxford, Lexington Books, 2005, p. 125-146.
[11] Ron Geaves, « A Case of Cultural Binary Fission or Transglobal Sufism? The Transmigration of Sufism to Britain », in Ron Geaves, Markus Dressler & Gritt Klinkhammer (eds), Sufis in Western Society: Global Networking and Locality : London, Routledge, 2009.
[1] Francesco Piraino, Le développement du soufisme en Europe. Au-delà de l’antinomie modernité et tradition : thèse de doctorat, EHESS/Scuola Normale Superiore, France/Italie, 2016.
[2] Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire : Paris, Cerf, 1993.
[3] Stefano Allievi, Les convertis à l’islam. Les nouveaux musulmans d’Europe : Paris, L’Harmattan, 1999.
[4] Elliott Bazzano & Marcia Hermansen (eds), Varieties of American Sufism: Islam, Sufi Orders, and Authority in a Time of Transition : New York, SUNY Press, 2020 ; Theodore Gabriel & Ron Geaves, Sufism in Britain : London, Bloomsbury, 2014.
[5] Danièle Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti : Paris, Flammarion, 1999, p. 71-78.
[6] Notion empruntée à Talal Asad qui exprime un discours liant éthique, pratique et rapports de pouvoir autour de l’idée de « croyance correcte » ou d’orthodoxie qui influence le présent, se voit légitimée par le passé et se projette vers le futur (p. 53-54). Voir Talal Asad, « L’idée d’une anthropologie de l’islam », traduit de l’anglais par Mattia Gallo & Pierre Lassave, Archives des sciences sociales des religions 180 (2017) (« The Idea of an Anthropology of Islam », Washington, Georgetown University, Occasional Papers Series, 1986, p. 117-137).
[7] Sophia Rose Arjana, Buying Buddhas, Selling Rumi: Orientalism and the Mystical Marketplace : London, One World Academic, 2020 ; E. Bazzano & M. Hermansen (eds), Varieties of American Sufism, op. cit.
[8] Merin Shobhana Xavier, The Dervishes of the North. Rumi, Whirling, and Making of Sufism in Canada : Toronto, University of Toronto Press, 2023.
[9] Ron Geaves, The Sufis of Britain: An Exploration of Muslim Identity : Cardiff, Cardiff Academic Press, 2000.
[10] Mark Sedgwick, « In Search of a Counter-Reformation: Anti-Sufi Stereotypes and the Budshishiyya’s Response », in Michaelle Browers & Charles Kurzman (eds), An Islamic Reformation ? : Oxford, Lexington Books, 2005, p. 125-146.
[11] Ron Geaves, « A Case of Cultural Binary Fission or Transglobal Sufism? The Transmigration of Sufism to Britain », in Ron Geaves, Markus Dressler & Gritt Klinkhammer (eds), Sufis in Western Society: Global Networking and Locality : London, Routledge, 2009.
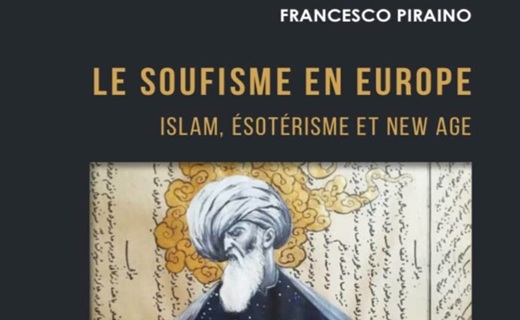
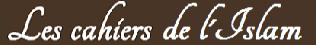


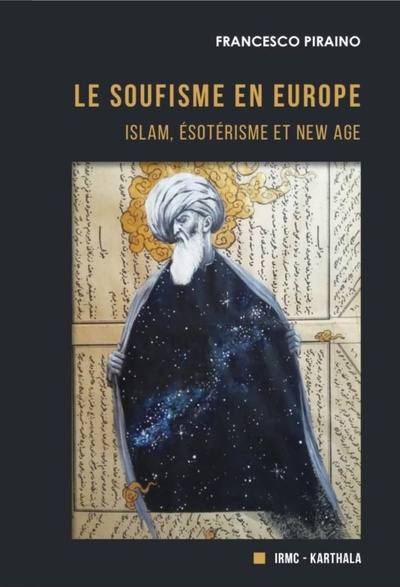










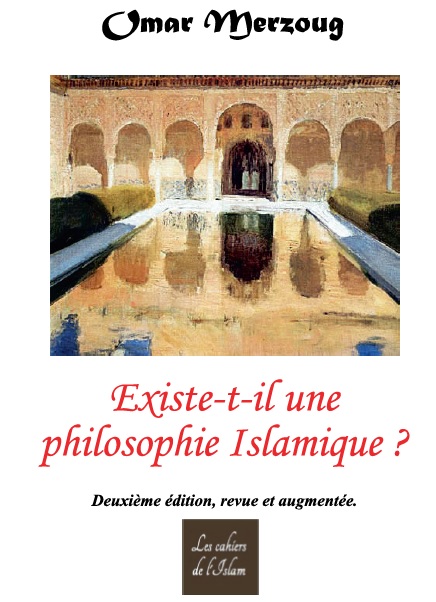



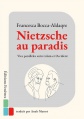








![La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane [Extrait] La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane [Extrait]](https://www.lescahiersdelislam.fr/photo/art/imagette_16_9/87789924-62224472.jpg?v=1746139916)









