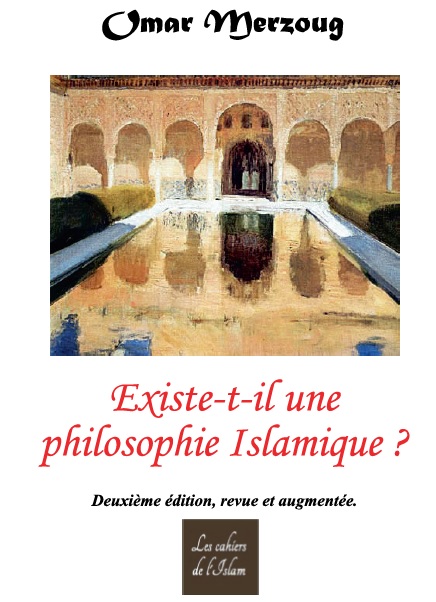« Le Coran est un de ces textes à portée universelle sur lequel on a trop dit, trop écrit et qui demeure, cependant, mal connu ». Cette formule de M. Arkoun, qui date de 1970, n’a rien perdu de son actualité. Comprendre le Kitâb ou le Mûshaf, pour autant qu’on le puisse, c’est pénétrer dans les ressorts les plus intimes de la conscience musulmane. Or, comment, lorsqu’on est étranger à l’aire culturelle arabo-musulmane, extérieur à l’univers de l’islam, y accéder sans s’assimiler le livre qui en détient les secrets, c’est-à-dire sans le traduire ?
Mais, avec le Coran n’est-on pas aux prises avec un texte, à bien des égards, intraduisible ? Tous ceux qui eurent cette témérité en savent quelque chose. « Chaque traduction du Coran proclame sa propre insuffisance » ...
Omar Merzoug
(Docteur en philosophie, Paris-IV Sorbonne)
Auteur de nombreuses traductions dans le domaine de la poésie arabe, il est aussi l'auteur de "Existe-t-il une philosophie Islamique ? Deuxième édition, revue et augmentée (Editions Les Cahiers de l'Islam, 2018).
Comprendre l’Islam est, semble-t-il, une entreprise hérissée de difficultés qui paraissent insurmontables, obstacles auxquels se heurtent les non-musulmans affrontés à l’Islam et aux musulmans. Mais toute tentative de compréhension ne doit-elle pas commencer par l’étude, rigoureuse et sérieuse, des textes fondateurs de l’Islam au premier rang desquels prend place le Coran quand on sait qu’un quart de la population mondiale vit à l’ombre du Coran, source des dogmes, code juridique, guide moral, livre de prière et de méditation, enfermant toute une vision du monde, de l’homme et de la société ? « Traduit » en plus de 80 langues du latin jusqu’au chinois en passant par le wolof, le français, l’anglais, l’allemand, l’italien l’espagnol. Il s’en est écoulé entre 800 millions et trois milliards d’exemplaires dans le monde. Et dans chacune de ces langues, il en existe plusieurs versions. La « bonne » traduction, l’ « honnête » transmission du Coran revêt donc un enjeu considérable à l’heure où le monde musulman connaît un profond désarroi, où l’homme musulman paraît avoir perdu les clefs de la sérénité spirituelle.
Pour tous ceux qui n’en maîtrisent pas l’idiome, le passage obligé reste la traduction, mais malheureusement touchant l’Islam, celle-ci pose plus de problèmes qu’elle n’en résout. Aussi n’est-il pas si étonnant que l’Islam soit si mal compris, si mal interprété par ceux qui n’en maîtrisent pas la langue et ne sont pas initiés à sa culture, y compris par nombre de musulmans français. On a même le sentiment que l’essor des études en islamologie, la prolifération des enquêtes sur le monde arabo-musulman, la somme sans cesse croissante de toutes sortes de publications, d’émissions, de films sur l’islam, l’organisation de séminaires, de congrès, de conférences, de débats et de tables rondes où des « spécialistes » interviennent pour éclairer la lanterne des peuples, toute cette accumulation de savoirs et d’échanges [1] n’a pas pu ou su empêcher la montée des périls. Force est de constater que l’Occident et l’Islam se comprennent encore moins aujourd’hui qu’il y a dix siècles [2]. On semble être revenu à une sorte d’hostilité de moins en moins larvée, de guerre de religions dont les signes sont patents. Nous faisons ici l’hypothèse que le différend majeur, qui semble creuser un fossé abyssal entre l’Occident et l’Islam, ressortit d’abord et avant toute chose à des problèmes de langue. C’est, la plupart du temps, un dialogue de sourds, parce que les interlocuteurs, que les réalités du monde contemporain contraignent à discuter (et à disputer), ne parlent pas la même langue. Pis, ils ne sont pas d’accord sur les règles qui doivent régir tout dialogue. Nombre de quiproquos, de malentendus, d’incompréhensions, de conflits entre l’Occident et l’Islam semblent relever de problèmes de traduction. Il n’en est que plus nécessaire dès lors de procéder à une évaluation critique de ces essais de version ? Quel est leur degré d’exactitude ? Ont-elles réussi à transmettre le message coranique avec le moins d’entropie possible ? De quels procédés ont-elles fait usage pour rendre les tours extraordinaires mystérieux, délicats du texte coranique ? Dans quel esprit ont-elles été conduites ? Que nous révèlent les versions du Coran sur la vision et la philosophie de la traduction de leurs auteurs ? Pourquoi, tout compte fait, encourent-elles une défiance, plus ou moins accusée , de la part des fidèles musulmans qui leur retirent le « label » de l’authenticité ?
Pour tous ceux qui n’en maîtrisent pas l’idiome, le passage obligé reste la traduction, mais malheureusement touchant l’Islam, celle-ci pose plus de problèmes qu’elle n’en résout. Aussi n’est-il pas si étonnant que l’Islam soit si mal compris, si mal interprété par ceux qui n’en maîtrisent pas la langue et ne sont pas initiés à sa culture, y compris par nombre de musulmans français. On a même le sentiment que l’essor des études en islamologie, la prolifération des enquêtes sur le monde arabo-musulman, la somme sans cesse croissante de toutes sortes de publications, d’émissions, de films sur l’islam, l’organisation de séminaires, de congrès, de conférences, de débats et de tables rondes où des « spécialistes » interviennent pour éclairer la lanterne des peuples, toute cette accumulation de savoirs et d’échanges [1] n’a pas pu ou su empêcher la montée des périls. Force est de constater que l’Occident et l’Islam se comprennent encore moins aujourd’hui qu’il y a dix siècles [2]. On semble être revenu à une sorte d’hostilité de moins en moins larvée, de guerre de religions dont les signes sont patents. Nous faisons ici l’hypothèse que le différend majeur, qui semble creuser un fossé abyssal entre l’Occident et l’Islam, ressortit d’abord et avant toute chose à des problèmes de langue. C’est, la plupart du temps, un dialogue de sourds, parce que les interlocuteurs, que les réalités du monde contemporain contraignent à discuter (et à disputer), ne parlent pas la même langue. Pis, ils ne sont pas d’accord sur les règles qui doivent régir tout dialogue. Nombre de quiproquos, de malentendus, d’incompréhensions, de conflits entre l’Occident et l’Islam semblent relever de problèmes de traduction. Il n’en est que plus nécessaire dès lors de procéder à une évaluation critique de ces essais de version ? Quel est leur degré d’exactitude ? Ont-elles réussi à transmettre le message coranique avec le moins d’entropie possible ? De quels procédés ont-elles fait usage pour rendre les tours extraordinaires mystérieux, délicats du texte coranique ? Dans quel esprit ont-elles été conduites ? Que nous révèlent les versions du Coran sur la vision et la philosophie de la traduction de leurs auteurs ? Pourquoi, tout compte fait, encourent-elles une défiance, plus ou moins accusée , de la part des fidèles musulmans qui leur retirent le « label » de l’authenticité ?
**
Y a-t-il plus folle entreprise que de traduire le Coran, ce chef-d’œuvre qui a fondé, façonné et pétri la culture et la civilisation arabo-musulmanes, livre dont l’influence s’étend au-delà de l’aire arabo-musulmane ? Depuis l’origine, le livre sacré des musulmans a beaucoup préoccupé la Chrétienté orientale avant de fasciner [4] un Occident, devenu depuis largement laïc, qui voulait connaître les ressorts de la puissance de ce rival redoutable qu’était l’Islam. Comprendre le livre saint des musulmans se hissait ainsi au rang d’un impératif, mais comme il était libellé en arabe, il fallait en passer par la translation. Depuis le XIIe siècle, beaucoup ont tenté l’aventure, à commencer par Robert de Ketton (R. de Retines) jusqu’aux plus récentes versions en passant par André du Ryer, George Sale, Claude-Étienne Savary, Albert Kasimirski, John Medows Rodwell, Edward Henry Palmer, T.F. Grigull, Max Henning, Juan Vernet, Richard Bell, Rudi Paret, Régis Blachère, Muhammad Hamidullah, Denise Masson, Jean Grosjean, Jacques Berque[5], Abdallah Penot et Maurice Gloton.
Monument de la culture musulmane, le Coran nourrit la pensée, l’art et la littérature, fonde toute une vision du monde, propose un mode de vie. Il est à la fois source des dogmes, guide moral, code juridique, propédeutique de salut. « Le Coran est un de ces textes à portée universelle sur lequel on a trop dit, trop écrit et qui demeure, cependant, mal connu [6] ». Cette formule de M. Arkoun, qui date de 1970, n’a rien perdu de son actualité. Comprendre le Kitâb ou le Mûshaf, pour autant qu’on le puisse, c’est pénétrer dans les ressorts les plus intimes de la conscience musulmane. Or, comment, lorsqu’on est étranger à l’aire culturelle arabo-musulmane, extérieur à l’univers de l’islam, y accéder sans s’assimiler le livre qui en détient les secrets, c’est-à-dire sans le traduire ?
Mais, avec le Coran n’est-on pas aux prises avec un texte, à bien des égards, intraduisible [7] ? Tous ceux qui eurent cette témérité en savent quelque chose. « Chaque traduction du Coran proclame sa propre insuffisance » note A. L. Tibawi [8]. En règle générale, la traduction est toujours une entreprise difficultueuse, hérissée de nombre d’obstacles, même quand on réalise des versions entre des langues proches par leur histoire, par leur structure, qui appartiennent à une même famille, par exemple les langues dites indo-européennes. À plus forte raison, lorsqu’il s’agit d’un livre par bien des aspects mystérieux, dont le texte n’a pas été établi, selon les règles ordinaires de l’érudition, dont il n’existe pas, disent les spécialistes, d’édition critique [9]. Livre de surcroît dont la composition a été bouleversée [10] et dont l’histoire [11] demeure nimbée de mystère.
Pour l’orientalisme classique, le texte du Coran, par bien des aspects, souffre d’un manque de clarté [12], les équivoques abondent, la polysémie s’y donne carrière, les termes dont on ignore le sens exact fourmillent [13]. On ne sait plus dans quel sens étaient reçus certains termes, quelles étaient les acceptions de certaines expressions coraniques en Arabie au temps du Prophète. Un mot, cité une seule fois dans le Coran [14], a suscité la perplexité des commentateurs musulmans, « Iram aux colonnes » (ارم ذات العماد). « Ce passage a fort embarrassé les commentateurs tant pour le sens que pour la construction grammaticale [15] » Certains estiment qu’Iram est la capitale des ʿĀd, « mais l’opinion la plus vraisemblable est qu’Iram désigne une tribu, que ce mot est apposé à ʿād in, et que ʿimād signifie mât de tente ou hauteur. Iram pourrait donc être une subdivision des ʿĀd ». D’autres savants musulmans « ont préféré considérer Iram comme le nom d’une ville, et d̲h̲āti l ʿimād pourrait alors signifier ‘avec les colonnes’, c’est-à-dire les colonnes de marbre de Damas ».
En outre, on a parfois tendance à donner un sens moderne ou contemporain à certains des termes coraniques, ce qui conduit à commettre des faux-sens ou des contre-sens. Le traducteur se voit contraint de choisir entre des sens d’un même mot ou d’une même expression dont chacune est loin de rendre le sens, tel qu’il était reçu à la Mecque ou à Médine. Il arrive aussi que le même mot ait des sens contraires, si bien que le traducteur est contraint d’en retenir un et de renoncer à l’expression de l’autre [16]. Comment décider ? Dès les premières sourates, le traducteur est affronté à un texte dont la structure n’offre rien de semblable aux modes de composer [17] qui ont cours en Occident. Dans un même verset, un même passage, un même fragment, il arrive que l’on ait affaire à des règles de nature juridique, à des préceptes moraux, à des paraboles, à des références aux prophètes des autres religions.
Dans ces conditions la compréhension du texte coranique s’avère fort ardue [18] et comme le traduire suppose toujours de le comprendre, on n’est jamais sûr d’avoir ni bien compris ni correctement traduit. De là une insatisfaction, une frustration, motifs qui poussent toujours d’autres audacieux à recommencer l’entreprise pourtant grevée de nombreuses difficultés, hérissée de formidables [19] obstacles. Pourtant, à plusieurs reprises, le Coran parle de lui-même comme d’un texte « clair » [مبين]. Ce qui fait bondir l’orientaliste Gerd-R Puin : « En le lisant, on remarque qu’environ une phrase sur cinq ne veut rien dire ». Partant « Si le Coran n’est pas compréhensible, - s’il ne peut même pas être compris en arabe, - il est, par conséquent, intraduisible [20] ». Répondre que « l’ancienne question de savoir si le Coran est traduisible, lisible par celui qui ne sait pas l’arabe littéraire, est frappée de vanité par les faits eux-mêmes » non seulement ne résout pas le problème, mais ne le fait pas avancer d’un iota. Il est tout de même significatif que certains termes, des titres de sourates par exemple, ne reçoivent généralement pas de traduction, par ex : Al-Anfâl, al-A’râf, al-Hijr, al-Ahqâf. Certains traducteurs les glosent, d’autres les reprennent tels quels. Blachère, suivi par Masson, traduit « al-Anfâl » par « Butin ». Hamidullah traduit le mot « al-A’râf » par « Limbes », Berque le traduit par « Redans », Blachère et Masson ne le traduisent pas, et Berque ne rend pas davantage « al-Hijr ».
Si ce qu’écrit Jambet était vrai, à savoir que l’effectivité des traductions du Coran fournit ipso facto une réponse à la question de sa « traduisibilité », certains termes coraniques ne devraient pas résister à la traduction. La translittération, le décalque et la glose sont toujours un échec de la traduction et du traducteur chargé de la mener à bien. Et que signifie en français par exemple, le fragment : « Leurs actions ont crevé d’enflure ? [21]». Ne comprenant pas cette formule, le locuteur français ira chercher du côté de telle fable de Jean de La Fontaine quelque lumière, sans être certain d’avoir bien compris. Et pourquoi s’entête-t-on à traduire الغيب (« ghayb ») par « mystère » alors qu’on sait que, comme J. Berque le reconnaît [22] , cette traduction est impropre et, en grande partie, insatisfaisante.
D’autre part, comment traduire un texte qui se présente comme un « miracle ». Aux yeux des musulmans en effet, le Coran est la parole même d’Allah, révélée au Prophète Muhammad par la médiation de l’Ange Gabriel, « dictée surnaturelle enregistré par le Prophète inspiré, simple messager chargé de la transmission de ce dépôt [23] ». Le Livre sacré des musulmans « est le miracle par excellence ; il est doté du privilège mystérieux de l’incomparabilité » écrit Massignon [24] . De son côté, Jean Grosjean renchérit : « Le texte coranique, écrit-il, est un sacrement. Il apporte la grâce de le croire. Sa naissance fut un miracle. Est-ce qu’un traducteur peut refaire un miracle [25] ? ». Enfin le traducteur français des Mille et Une Nuits, s’essayant à une traduction, partielle, du Coran, affirme que le style du Coran « est le style personnel d’Allah. Comme le style est l’essence de l’être, il ne saurait être ici que divin [26] ».
Cette notion de « miracle », si elle est défendue par une majorité d’oulémas et de fidèles orthodoxes, a été contestée dans l’histoire de la pensée islamique. Des penseurs de culture musulmane et des théologiens musulmans l’ont discutée et même rejetée. De manière plus surprenante, Ibrahim al-Nazzâm, l’illustre théologien mû’tazilite, a révoqué en doute le fait qu’il fût impossible jamais de composer un Coran semblable au Coran, heurtant ainsi un verset explicite du Coran : « Dis, certes, si les Humains et les Djinns s’unissaient pour produire une [révélation] pareille à cette Prédication. Ils ne sauraient produire [rien de] de pareil, fussent-ils les uns pour les autres des auxiliaires [27] ». Aux yeux d’Al-Nazzâm, le caractère sublime et insupérable du Coran ne prouve, en aucune manière, l’authenticité de la mission prophétique ou la vérité de l’islam.
De grands noms de la théologie et de la jurisprudence musulmane s’inscrivent en faux contre la traduction du Coran. L’illustre Ibn Hazm évoque, dans son imposant traité [28], Al-Fisal, cette idée de la traduction qu’il juge parfaitement intempestive et toujours de nature à fausser, fondamentalement, le texte coranique. Rappelant d’une part qu’Allah a révélé (انزل) un « Coran arabe [29]» et que de l’autre, chaque prophète n’a jamais prêché d’exemple que dans l’idiome du peuple auquel il a été envoyé, il en tire une conséquence radicale, à savoir que le lecteur d’une version du Coran lit tout autre chose que le véritable Coran, qui lui ne peut être lu, assimilé et véritablement compris que dans son idiome d’origine. C’est la perfection du style et du contenu tout à la fois de la langue arabe et de l’expression coranique qui lui est consubstantielle, qui explique ce parti-pris. Au Xe siècle, une secte philosophique d’obédience néoplatonicienne, les Ikhwân al-Safâ (Frères de la Pureté) ont défendu, dans une de leurs épîtres [30], la perfection de la langue arabe, celle-ci est la langue reine de la création à leurs yeux, son expressivité pertinente ne saurait être rendue par une langue rivale.
Aux yeux d’Ibn Qutayba [31] enfin, la traduction souffre d’une radicale infirmité à l’endroit du texte original. Si l’on peut traduire la Torah et l’Évangile de l’hébreu en grec, en syriaque et dans d’autres langues, la rhétorique et les figures propres à l’arabe ne le permettent pas. La perte de sens et d’information, en somme l’entropie, serait trop importante. La tâche du traducteur serait là encore impossible.
Voilà sans doute pourquoi en Islam les préventions et les réserves contre toutes les traductions du Livre demeurent vives [32]. C’est l’idée même d’une traduction du Coran qui est contestée [33]. L’unique concession qu’on puisse faire à cet égard, c’est de condescendre à considérer qu’on peut expliquer, gloser les sens du Coran pour des oreilles étrangères. Ce qui le montre du reste, c’est que pour les savants musulmans et, pour une large partie des fidèles musulmans, une version du Coran en langue étrangère cesse ipso facto d’être du Coran, d’être, dirait-on en terminologie chrétienne, un « sacrement ». Parce l’expression de la parole d’Allah est consubstantielle à la langue de la révélation, la traduction du texte coranique perd de ce seul fait le caractère de sacralité qui fait du Coran le livre qu’il est et ruine l’autorité qu’il détient [34]. Partant, les traductions entreprises par des musulmans ou des non-musulmans ne peuvent servir à aucun usage liturgique ou cultuel. Jâhiz, l’un des plus illustres écrivains de l’âge arabe classique, et révéré comme tel, a fermement soutenu l’idée d’impossibilité de la traduction. « Le traducteur, écrit-il, ne rend jamais ce que dit le Sage… et comment pourrait-il le faire… à moins d’être dans la connaissance des contenus, de la portée des mots et de l’éventail des acceptions au niveau de l’auteur lui-même ? ». Al-Jâhiz ajoute, avec quelque virulence, épinglant au passage les traducteurs des textes grecs [35]: « Quand donc Ibn al-Bitrîq (Dieu ait son âme), Ibn Na’ima, Ibn Fihriz, Théophile, Ibn Wahilî et Ibn al-Mûqaffa’ ont-ils été les égaux d’Aristote ? Quand donc Khalid [36] a-t-il été le pair de Platon [37]».
Dans le champ de la poésie autant que dans le domaine des sciences, traduire est impossible parce que le traducteur ne peut jamais s’élever à la hauteur de l’auteur et que la version ne saurait, sans présomption, rivaliser avec l’œuvre originale. Le traducteur devrait être de surcroît un travailleur effacé [38] dont l’humilité est la qualité première. On peut donc en inférer que ce qui est vrai des textes philosophiques l’est a fortiori du Coran déclaré « inimitable » par la tradition. « Tel est notre propos touchant les traités de géométrie, d’astronomie, d’arithmétique et de musique, que sera-ce alors si ces livres sont des ouvrages de religion qui traitent de Dieu - le Puissant, le Majestueux - et de la propriété ou de l’impropriété des termes dans lesquelles il convient ou ne convient pas d’en parler ? ». Du côté de l’orthodoxie religieuse et du point de vue de ceux qui se sont donnés mission d’en orchestrer les thèmes et d’en codifier les principes, les docteurs de la loi et les jurisconsultes « définissent le Coran comme le Verbe de Dieu, révélé à Muhammad (Ssp) en langue arabe pour la prédication et le défi (i’jâz) » comme l’écrit M Tibawi. L’orthodoxe fonde sa position sur cet axiome et « la révélation perd ce caractère si le Coran est translaté de l’arabe dans une autre langue » et la tradition est « unanime à soutenir qu’il est impossible de traduire le Coran [39]»
On le voit, la pensée musulmane s’est soulevée avec vigueur contre l’idée même d’une version du Coran qui a paru à beaucoup comme le signe d’une insoutenable présomption, et, pis, d’un blasphème. Comment en effet un livre que la tradition présente comme un livre inimitable peut-il faire l’objet d’une traduction, opération somme toute banale, et être traité comme n’importe quel texte littéraire ? Aux yeux des musulmans, l’orientalisme aborde le Coran comme un ouvrage ordinaire de littérature classique. Nombre de fidèles s’insurgent contre les libertés que les orientalistes prennent avec le Coran.
A la recherche d’une chronologie fort problématique [40], certains orientalistes bouleversent l’ordre des versets [41], émaillent leurs propos d’assertions sans fondement [42], remettent en question leurs propres affirmations ; certains autres sèment leurs proses de jugements à l’emporte-pièce sur l’authenticité du texte révélé, d’autres croient avoir trouvé dans les méthodes historico-critiques le sésame qui leur découvre les mystères du Coran [43], et plus récemment d’autres encore, professant une sorte de scientisme, passé de mode, rejettent avec la présomption qui seyait aux positivistes du début du XXe siècle, toute argumentation adverse comme entachée de fidéisme.
Le désaccord des orientalistes jette « l’honnête homme » dans un profond désarroi. Devant une telle disparité d’opinions, de positions, il se demande quel parti prendre, quel(s) orientaliste(s) suivre, à quelle chapelle se vouer. Leurs controverses paraissent plus ressortir à des querelles idéologiques qu’à des débats scientifiques [44]. Là où l’honnête homme croyait trouver de la science, de la recherche, non pas expérimentale, mais au moins impartiale [45], il voit surgir des coteries, des castes, des « réseaux » où docteurs et doctorants, cherchant à « se faire une place au soleil », en viennent à prendre des libertés avec les principes de la recherche scientifique. Tous pourtant se réclament des méthodes « historico-critiques ». Si les thèses, -et les conclusions qu’en tirent ces chercheurs en études islamiques-, étaient scientifiques de part en part, ils ne s’inscriraient pas en faux les uns contre les autres [46] , ils ne divergeraient pas et ne révoqueraient pas en doute leurs propres assertions.
Qu’on ne vienne pas objecter que le mouvement même de la démarche scientifique exige que chaque théorie scientifique ultérieure réfute, tout ou partie, de la théorie précédente, que chaque philosophe nouveau montrant les faiblesses, les contradictions, les impensés de la philosophie qu’il démolit, établit ainsi sa problématique, développe la teneur de ses thèses et bâtit son propre système. Se posant en critique du platonisme, Aristote n’a aucunement dépassé les positions de Platon. Au reste, Platon lui-même a magistralement fait œuvre d’autocritique [47] . Averroès n’a point réfuté al-Ghazâlî et, pas davantage, Avicenne. Il reproche au premier son anti-péripatétisme et au second d’avoir infecté de néo-platonisme le système aristotélicien. Ce qui motive la critique averroïste d’al-Ghazâlî et d’Avicenne, on pourrait assez facilement le montrer, n’a rien qui relève d’une pure discussion d’idées. Dans toute cette affaire, il ne s’agit au fond que d’une divergence de sentiment, de dissentiments et non de vérité rationnelle [48]. Il y a toute une mythologie de l’odyssée de la science dont il faut s’affranchir. Le mouvement scientifique ne progresse nullement comme une vision autorisée voudrait nous le faire croire. Voilà pourquoi il importe de se dégager d’une conception naïve et, somme toute, scolaire du mouvement des idées.
Il en est de même de l’orientalisme islamisant. C’est parce que chaque orientaliste ou chaque école orientaliste a des vues spécifiques sur l’Islam, le Prophète, la société musulmane qu’ils divergent et s’opposent. Avant même d’avoir commencé leurs travaux, ces chercheurs ont des « prénotions » (comme le disait E. Durkheim) de l’Islam. A les entendre, l’impression prévaut qu’ils ne cherchent dans l’histoire, dans la littérature, dans l’anthropologie, dans l’archéologie même que de quoi les conforter. Ils partent ainsi d’opinions préconçues [49] , ou, à la rigueur, de postulats qui sont, par définition, indémontrables. C‘est là-dessus qu’ils bâtissent, plus ou moins bien, selon le talent que la nature a départi à chacun d’entre eux, selon l’étroitesse ou l‘ampleur de leur culture et leurs compétences, leur doctrine à propos de l’islam. C’est du reste ainsi que l’on a abouti à des errements tout à fait caractéristiques. On voudrait bien savoir sur quels fondements scientifiques certains orientalistes se prononcent sur le caractère « hystérique » du Prophète, et sur quelles bases d’autres le déclarent « épileptique », diagnostics bien hasardeux à une pareille distance historique. Car outre que ces deux affections ne présentent pas le même tableau clinique, il ne semble pas que ces orientalistes appartenant la catégorie des « hommes de lettres » soient qualifiés pour délivrer de pareils jugements. De quelles raisons scientifiques peuvent-ils exciper pour parler ainsi ? L’objectivité, la probité et l’amour désintéressé du vrai sont en principe les qualités premières du savant. Comment, dans ces conditions, peut-on accorder foi aux thèses de semblables « savants » qui dérogent aux règles les plus élémentaires devant gouverner toute entreprise scientifique. Sur quelles preuves se fonde Hirschfield pour attester que le Prophète et Bahira [50] seraient une seule et même personne ? Et comment P. Crone [51] peut-elle affirmer que l’existence de La Mecque est une pure invention des chroniqueurs musulmans avant d’abjurer cette opinion ?
Avoir fondé toute son approche du Coran sur la biographie du prophète conformément à la doxa renanienne, Nöldeke modifie sa position. Contestant une opinion érigée en postulat depuis G. Weil, Blachère déclare : « Il faut renoncer pour toujours à l’idée d’un reclassement des sourates qui collerait à la biographie de Muhammad, fondée uniquement sur la tradition. Seul le Coran pourrait être un guide sûr »[52]. Mais les travaux ultérieurs, et donc plus récents, des orientalistes ont montré le peu de crédit qu’ils accordaient à ce guide prétendument sûr. G. Lüling, dans sa quête d’un « Ur-Qurân [53]», prétendant retrouver un Coran originaire, issu de carmina d’inspiration chrétienne fondus dans le paganisme arabe traditionnel, déclare rompre avec les présupposés méthodologiques et les principes qui avaient gouverné la recherche de Nöldeke et de ses disciples. Les méthodes d’Angelika Neuwirth [54] et de John Burton, touchant la structure des sourates dites mecquoises et le recueil des versets du Coran, n’ont rien de commun.
Quant à P. Crone et M. Cook [55], ils ont soutenu des thèses qui s’éloignent beaucoup des positions de l’orientalisme traditionnel. « There is no hard evidence for the existence of the Koran in any form before the last decade of the seventh century and the tradition which places this rather opaque revelation in its historical context is not attested before the middle of the eighth ». Ils en tirent la conclusion que « The historicity of the Islamic tradition is thus to some degree problematic [56]». Enfin, il semble bien que les travaux du chrétien oriental qui se dissimule sous le nom de C. Luxenberg, ne constituent nullement une « véritable percée dans le domaine des études coraniques » et « un pas en avant capital [57]». On ne nous en voudra pas de préférer le jugement d’un spécialiste reconnu à l’opinion hasardée d’un recenseur qui confesse lui-même l’indigence de ses provisions scientifiques : « L’œuvre de Luxenberg est un curieux mélange d’érudition sémitique et…d’élucubrations fantaisistes » écrit T. Nagel, lequel ajoute que : « dans 95% des cas, la belle théorie de Luxenberg ne fonctionne pas » [59]
C’est par conséquent l’ensemble des présuppositions et des tropismes de l’orientalisme [60]– ou de l’islamologie - que révoquent en doute les musulmans, au motif qu’un livre comme le Coran a un statut particulier qui n’est pas celui des Écritures chrétiennes ou juives [61]. Sans perdre de vue que les Musulmans soupçonnent toute traduction du Coran, faite par des Occidentaux, d’être une tentative empreinte d’hostilité, et, sous des dehors prétendument scientifiques, de dissimuler une nouvelle forme de croisade savante, comme un ghazw [62] idéologique et intellectuel. « La réception des traductions européennes du Coran en milieu musulman a toujours fait problème. Depuis le XIXe siècle, les penseurs musulmans ne cessent d’accumuler les griefs contre l’orientalisme en général, et en particulier contre ses méthodes d’analyse et de critique appliquées aux textes fondateurs de l’islam [63]».
Traduire le Coran n’est donc pas une entreprise de tout repos. Ce truisme n’en est pas un. Le premier obstacle qui se dresse devant le lecteur est évidement la langue arabe dans son état du VIe siècle ap. J-C. Accéder à l’idiome original du Coran est donc réservé à une minorité, à une élite de linguistes, à des savants et n’est pas le partage du vulgum pecus. Sans connaissance de l’arabe, aucune chance de saisir le sens véritable des formules coraniques, des mots porteurs de sens, des tours si caractéristiques du style coranique. En outre la densité du texte, ses procédés stylistiques et rhétoriques, ses figures, ses termes étrangers et inconnus, le paysage étrange qu’il semble nous découvrir, les symboles et les notions spécifiques font que des passages entiers du Coran échappent à notre intelligence [64]. Nous ne comprenons plus ses ellipses, ses tours ramassés, la profondeur des métaphores, le tour déroutant de son style allusif. Si nous sommes perplexes devant un vers de Corneille, devant telle ou telle formule énigmatique de Montaigne, si la peur de commettre un contre-sens nous arrête devant l’énoncé d’un aphorisme de Pascal, que dire alors de l’ampleur de la difficulté qui attend le lecteur et a fortiori le traducteur, face à un état de langue, arabe, assurément plus ancien ?
A la recherche d’une chronologie fort problématique [40], certains orientalistes bouleversent l’ordre des versets [41], émaillent leurs propos d’assertions sans fondement [42], remettent en question leurs propres affirmations ; certains autres sèment leurs proses de jugements à l’emporte-pièce sur l’authenticité du texte révélé, d’autres croient avoir trouvé dans les méthodes historico-critiques le sésame qui leur découvre les mystères du Coran [43], et plus récemment d’autres encore, professant une sorte de scientisme, passé de mode, rejettent avec la présomption qui seyait aux positivistes du début du XXe siècle, toute argumentation adverse comme entachée de fidéisme.
Le désaccord des orientalistes jette « l’honnête homme » dans un profond désarroi. Devant une telle disparité d’opinions, de positions, il se demande quel parti prendre, quel(s) orientaliste(s) suivre, à quelle chapelle se vouer. Leurs controverses paraissent plus ressortir à des querelles idéologiques qu’à des débats scientifiques [44]. Là où l’honnête homme croyait trouver de la science, de la recherche, non pas expérimentale, mais au moins impartiale [45], il voit surgir des coteries, des castes, des « réseaux » où docteurs et doctorants, cherchant à « se faire une place au soleil », en viennent à prendre des libertés avec les principes de la recherche scientifique. Tous pourtant se réclament des méthodes « historico-critiques ». Si les thèses, -et les conclusions qu’en tirent ces chercheurs en études islamiques-, étaient scientifiques de part en part, ils ne s’inscriraient pas en faux les uns contre les autres [46] , ils ne divergeraient pas et ne révoqueraient pas en doute leurs propres assertions.
Qu’on ne vienne pas objecter que le mouvement même de la démarche scientifique exige que chaque théorie scientifique ultérieure réfute, tout ou partie, de la théorie précédente, que chaque philosophe nouveau montrant les faiblesses, les contradictions, les impensés de la philosophie qu’il démolit, établit ainsi sa problématique, développe la teneur de ses thèses et bâtit son propre système. Se posant en critique du platonisme, Aristote n’a aucunement dépassé les positions de Platon. Au reste, Platon lui-même a magistralement fait œuvre d’autocritique [47] . Averroès n’a point réfuté al-Ghazâlî et, pas davantage, Avicenne. Il reproche au premier son anti-péripatétisme et au second d’avoir infecté de néo-platonisme le système aristotélicien. Ce qui motive la critique averroïste d’al-Ghazâlî et d’Avicenne, on pourrait assez facilement le montrer, n’a rien qui relève d’une pure discussion d’idées. Dans toute cette affaire, il ne s’agit au fond que d’une divergence de sentiment, de dissentiments et non de vérité rationnelle [48]. Il y a toute une mythologie de l’odyssée de la science dont il faut s’affranchir. Le mouvement scientifique ne progresse nullement comme une vision autorisée voudrait nous le faire croire. Voilà pourquoi il importe de se dégager d’une conception naïve et, somme toute, scolaire du mouvement des idées.
Il en est de même de l’orientalisme islamisant. C’est parce que chaque orientaliste ou chaque école orientaliste a des vues spécifiques sur l’Islam, le Prophète, la société musulmane qu’ils divergent et s’opposent. Avant même d’avoir commencé leurs travaux, ces chercheurs ont des « prénotions » (comme le disait E. Durkheim) de l’Islam. A les entendre, l’impression prévaut qu’ils ne cherchent dans l’histoire, dans la littérature, dans l’anthropologie, dans l’archéologie même que de quoi les conforter. Ils partent ainsi d’opinions préconçues [49] , ou, à la rigueur, de postulats qui sont, par définition, indémontrables. C‘est là-dessus qu’ils bâtissent, plus ou moins bien, selon le talent que la nature a départi à chacun d’entre eux, selon l’étroitesse ou l‘ampleur de leur culture et leurs compétences, leur doctrine à propos de l’islam. C’est du reste ainsi que l’on a abouti à des errements tout à fait caractéristiques. On voudrait bien savoir sur quels fondements scientifiques certains orientalistes se prononcent sur le caractère « hystérique » du Prophète, et sur quelles bases d’autres le déclarent « épileptique », diagnostics bien hasardeux à une pareille distance historique. Car outre que ces deux affections ne présentent pas le même tableau clinique, il ne semble pas que ces orientalistes appartenant la catégorie des « hommes de lettres » soient qualifiés pour délivrer de pareils jugements. De quelles raisons scientifiques peuvent-ils exciper pour parler ainsi ? L’objectivité, la probité et l’amour désintéressé du vrai sont en principe les qualités premières du savant. Comment, dans ces conditions, peut-on accorder foi aux thèses de semblables « savants » qui dérogent aux règles les plus élémentaires devant gouverner toute entreprise scientifique. Sur quelles preuves se fonde Hirschfield pour attester que le Prophète et Bahira [50] seraient une seule et même personne ? Et comment P. Crone [51] peut-elle affirmer que l’existence de La Mecque est une pure invention des chroniqueurs musulmans avant d’abjurer cette opinion ?
Avoir fondé toute son approche du Coran sur la biographie du prophète conformément à la doxa renanienne, Nöldeke modifie sa position. Contestant une opinion érigée en postulat depuis G. Weil, Blachère déclare : « Il faut renoncer pour toujours à l’idée d’un reclassement des sourates qui collerait à la biographie de Muhammad, fondée uniquement sur la tradition. Seul le Coran pourrait être un guide sûr »[52]. Mais les travaux ultérieurs, et donc plus récents, des orientalistes ont montré le peu de crédit qu’ils accordaient à ce guide prétendument sûr. G. Lüling, dans sa quête d’un « Ur-Qurân [53]», prétendant retrouver un Coran originaire, issu de carmina d’inspiration chrétienne fondus dans le paganisme arabe traditionnel, déclare rompre avec les présupposés méthodologiques et les principes qui avaient gouverné la recherche de Nöldeke et de ses disciples. Les méthodes d’Angelika Neuwirth [54] et de John Burton, touchant la structure des sourates dites mecquoises et le recueil des versets du Coran, n’ont rien de commun.
Quant à P. Crone et M. Cook [55], ils ont soutenu des thèses qui s’éloignent beaucoup des positions de l’orientalisme traditionnel. « There is no hard evidence for the existence of the Koran in any form before the last decade of the seventh century and the tradition which places this rather opaque revelation in its historical context is not attested before the middle of the eighth ». Ils en tirent la conclusion que « The historicity of the Islamic tradition is thus to some degree problematic [56]». Enfin, il semble bien que les travaux du chrétien oriental qui se dissimule sous le nom de C. Luxenberg, ne constituent nullement une « véritable percée dans le domaine des études coraniques » et « un pas en avant capital [57]». On ne nous en voudra pas de préférer le jugement d’un spécialiste reconnu à l’opinion hasardée d’un recenseur qui confesse lui-même l’indigence de ses provisions scientifiques : « L’œuvre de Luxenberg est un curieux mélange d’érudition sémitique et…d’élucubrations fantaisistes » écrit T. Nagel, lequel ajoute que : « dans 95% des cas, la belle théorie de Luxenberg ne fonctionne pas » [59]
C’est par conséquent l’ensemble des présuppositions et des tropismes de l’orientalisme [60]– ou de l’islamologie - que révoquent en doute les musulmans, au motif qu’un livre comme le Coran a un statut particulier qui n’est pas celui des Écritures chrétiennes ou juives [61]. Sans perdre de vue que les Musulmans soupçonnent toute traduction du Coran, faite par des Occidentaux, d’être une tentative empreinte d’hostilité, et, sous des dehors prétendument scientifiques, de dissimuler une nouvelle forme de croisade savante, comme un ghazw [62] idéologique et intellectuel. « La réception des traductions européennes du Coran en milieu musulman a toujours fait problème. Depuis le XIXe siècle, les penseurs musulmans ne cessent d’accumuler les griefs contre l’orientalisme en général, et en particulier contre ses méthodes d’analyse et de critique appliquées aux textes fondateurs de l’islam [63]».
Traduire le Coran n’est donc pas une entreprise de tout repos. Ce truisme n’en est pas un. Le premier obstacle qui se dresse devant le lecteur est évidement la langue arabe dans son état du VIe siècle ap. J-C. Accéder à l’idiome original du Coran est donc réservé à une minorité, à une élite de linguistes, à des savants et n’est pas le partage du vulgum pecus. Sans connaissance de l’arabe, aucune chance de saisir le sens véritable des formules coraniques, des mots porteurs de sens, des tours si caractéristiques du style coranique. En outre la densité du texte, ses procédés stylistiques et rhétoriques, ses figures, ses termes étrangers et inconnus, le paysage étrange qu’il semble nous découvrir, les symboles et les notions spécifiques font que des passages entiers du Coran échappent à notre intelligence [64]. Nous ne comprenons plus ses ellipses, ses tours ramassés, la profondeur des métaphores, le tour déroutant de son style allusif. Si nous sommes perplexes devant un vers de Corneille, devant telle ou telle formule énigmatique de Montaigne, si la peur de commettre un contre-sens nous arrête devant l’énoncé d’un aphorisme de Pascal, que dire alors de l’ampleur de la difficulté qui attend le lecteur et a fortiori le traducteur, face à un état de langue, arabe, assurément plus ancien ?
C’est qu’une langue n’est pas seulement un « instrument de communication » comme se sont plu à le répéter des générations de linguistes. Elle réfléchit de tout un univers, et toute traduction infléchit le texte original dans un sens ou dans un autre. Il n’y a guère de correspondance parfaite, n’en déplaise aux partisans du littéralisme, entre les langues, les linguistes depuis Ferdinand de Saussure [65] nous l’ont assez dit. Et quelque effort que l’on fasse, il y a toujours, dans l’état final d’une traduction, une perte d’une partie du message ou de l’information contenue dans le texte original. Ceci qui est vrai de toute translation est encore dramatiquement vrai de la traduction des Écritures, et, en particulier, du Coran. Paul Mazon, un maître de la traduction, fait un aveu des plus significatifs dans la présentation de sa traduction de l’Iliade : « L’obligation que je m’étais imposée de ne rien éliminer du texte et la nécessité où me mettait notre langue de rendre les mots composés par de lourdes périphrases ont à tel point surchargé ma traduction et ralenti son allure qu’elle ne garde rien de cette aisance si vigoureuse qui fait le plus grand charme du style homérique ». Peut-on en dire autant des traductions de maints fragments coraniques qu’on nous propose ?
(A suivre)
_____________________
[1] Il ne s’agit pas de nier, ou même de minorer, les effets bénéfiques de cette somme des savoirs, mais de suggérer qu’elle a eu des effets pervers qui s’expliquent par toutes sortes de raisons, notamment la diversité des intérêts et les tropismes culturels ou politiques.
[2] Évoquant le jugement de Th. Carlyle qui, dans “The hero as prophet” jugeait la lecture du Coran “toilsome, wearisome, confused jumble”, W Montgomery Watt notait pourtant ceci : « It is against such a background that occidental scholars of the Qur’ân must consider what is required of them. Islamists, and generally orientalists, have functions to perform for their own society” (On Interpreting the Qur’ân, Oriens, vol. 25-26, Brill éditeur)
[3] Que la traduction de Mme Denise Masson ait été agréée par « des autorités musulmanes notoires, d’Al-Azhar en particulier » (C. Hamès, Porte ouverte sur un jardin fermé, Archives des sciences sociales des religions, avril-juin 1992), que la version de J Berque ait été qualifiée de « génial attentat contre le Coran » (Le Monde, 18-2-1991), par des journalistes non spécialistes de la question ou qu’elle ait été bien reçue par des universitaires ou des hommes politiques maghrébins ne signifie pas qu’elles soient parfaites ou qu’elles puissent être ipso facto soustraites à la critique indépendante, qui doit légitimement s’exercer.
[4] Maxime Rodinson, La fascination de l’Islam, F. Maspéro, Paris, 1980. Dans un entretien paru dans « Le Monde » en date du 7 février 1982, Rodinson estime que « Depuis quatorze siècles, d’une certaine façon, l’Occident est fasciné par l’islam parce que celui-ci a été longtemps son rival, son concurrent, son ennemi souvent, le plus proche au niveau des mondes culturels globaux ».
[5] On ne cite ici que les plus connus qui ont commis des traductions intégrales du Coran.
[6] Mohammed Arkoun, Préface à une réédition de la traduction de Kasimirski, reprise dans Lectures du Coran, Albin Michel, Paris, 2016.
[7] Dans ”Lire le Coran au présent », (Revue des deux mondes, mai 1991, pp 171-177) l’arabisant C. Jambet, rendant compte de la traduction française de Jacques Berque, alors professeur honoraire au Collège de France, ne semble pas s’être avisé que Berque n’a pas traduit nombre de fragments coraniques. En tout cas, C. Jambet ne le signale nulle part. Deux exemples parmi tant d’autres : dans la sourate 40, au verset 34, le fragment « كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب »n’a pas été traduit. Dans la sourate « al Hûjûrât » (les appartements), le traducteur omet de traduire la fin du verset 7, « اولئك هم الراشدون » (Ce sont ceux-là qui sont les bien-guidés).
[8] « Is the Qur’ân translatable ? Early Muslim Opinion», The Muslim World, vol. 52, Issue 1, january 1962, p. 4-16.
[9] Ou du moins pas encore.
[10] « Le classement des sourates dans l’édition première et définitive, le muçhaf, ne suit pas l’ordre chronologique de la révélation ou « descente ». Il y a plus : on trouve assez souvent à l’intérieur d’une même sourate des versets reçus à des moments séparés. De quoi ni la croyance, ni la science de l’Islam n’éprouvent la moindre inquiétude » note J. Berque, « En relisant le Coran », p. 714, Le Coran, essai de traduction, 1ère édition, Paris, 1990..
[11] Comme l’atteste l’existence au Collège de France d’une chaire intitulée « Histoire du Coran. Texte et transmission ».
[12] Certains orientalistes pointent, non sans malice, le cas des lettres isolées, dont personne ne sait le sens, et se font fort de les opposer à la proclamation quasi programmatique du Coran prétendu « clair » (mûbin). Le très méticuleux Ibn Hazm n’avait-il pas averti que tout dans le Coran est mûbin, à l’exception des serments et des lettres isolées ?
[13] Que signifient exactement ‘Abb’, Gibt’, et à quoi renvoie exactement « Iram » dont R. Blachère disait qu’ « Il est naturellement impossible de savoir ce que ce verset a pu exactement représenter pour la génération de Mahomet » ?
[14] Coran, LXXXIX, 6.
[15] W. Montgomery Watt, entrée « Iram », Encyclopédie de l’Islam.
[16] Il s’agit des fameux adhdâd.
[17] « Commencer l’étude du Coran par celle de sa composition, c’est l’aborder sous sa face la plus ardue » écrit J. Berque dans « En relisant le Coran », sorte de postface à sa traduction du Coran, Sindbad, 1990.
[18] Introduire dans le texte des titres, des intitulés, le démembrement des versets et leur réarrangement selon un ordre supposé chronologique, comme Blachère l’a tenté, après d’autres, est-il de nature à vraiment aider le lecteur à discerner la structure des sourates ? comme l’affirme W.M Watt ? cf. On interpreting the Qûr’ân, Oriens, vol 2, 1976.
[19] Du latin formido : effroi, terreur.
[20] Propos rapporté dans le magazine Books, numéro spécial consacré à « L’énigme du Coran », n° 10, nov-déc. 2009. Tous les orientalistes ne partagent pas l’opinion de Puin.
[21] Traduction J Berque, sourate XVIII, 105.
[22] « Le ‘ mystère ‘ : cette traduction pour ghayb n’est pas entièrement satisfaisante » note, sourate II, p.26 de sa traduction. On ne saurait trop admirer le sens de la litote. Voir la contribution de Gaudefroy-Demombynes, « Le sens du substantif Ghayb dans le Coran » dans Mélanges offerts à L. Massignon, Institut d’études islamiques de Paris et l’Institut français de Damas, 1956 et l’entrée « Invisible » dans le « Dictionnaire du Coran » sous la direction de M. Moezzi (Laffont éditeur).
[23] L. Massignon, Écrits mémorables, II, p. 423. Robert Laffont, Paris, 2009.
[24] L Massignon, Préface à la traduction du Coran de M. Hamidullah, Le Club français du livre, 1977.
[25] Préface à la version de Denise Masson, Gallimard, 1967.
[26] J.-C. Mardrus, Le Koran, traduction littérale et complète des Sourates Essentielles, Fasquelle éditeur, Paris, 1926.
[27] Coran, XVII, 88, dans la version de R. Blachère. Autres translations du même fragment : « Dis : « Si les hommes et les Djinns s’unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien qui lui ressemble, même s’ils s’aidaient mutuellement » (Tf : D. Masson, 1967) ; « Dis : « Quand même hommes et djinns s’uniraient pour apporter le semblable de ce Coran, ils n’en sauraient apporter le semblable, même s’ils se soutenaient les uns les autres »(Tf : M Hamidullah, 1977) ou : « Dis : Quand les hommes et les génies se réuniraient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien de pareil, lors même qu’ils s’aideraient mutuellement » (Tf Kasimirski, 1841).
[28] « Le Coran est insupérable ; nul ne peut [en produire] un semblable. Allah a mis en échec tous les hommes et les djinns, les Arabes comme les non-Arabes, qui ne sauraient en produire un qui présente semblable composition…Là-dessus le consensus règne parmi les musulmans ». Ibn Hazm, Al-Fisâl, vol III, p. 25, éd. Dar al-Jîl, Beyrouth, 1996.
[29] « Nous l’avons fait descendre sur toi en un Coran arabe, peut-être comprendrez-vous » (Tf D. Masson) ou « Nous l’avons révélé Coran arabe afin que vous le méditiez » (Tf A. Penot).
[30] Dix-septième épître, vol III, p 144.
[31] Thèse qu’il développe dans « Ta’wîl Mushkil al- Qur’ân ». (De l’interprétation du problème du Coran) Bibliothèque scientifique, sd.
[32] « Selon l’enseignement de l’islam, le Coran est inimitable : il est donc impensable de le traduire » note F. Déroche, entrée « Traductions », Dictionnaire du Coran, publié sous la direction de M. A. Amir Moezzi, Robert Laffont, Paris, 2007. De son côté, M. Gloton note que « Le Qur’ân, ne provenant ni d’un poète, ni d’un oracle, ni d’un individu, mais bien d’Allah, ne peut être imité dans son style » Le Coran, essai de traduction et annotations, édition bilingue, al-Bouraq éditeur..
[33] « Un fort courant musulman traditionnel, se fondant d’une part sur l’impossibilité de cerner tous les sens du Coran, que seul Dieu connaît, et, d’autre part, sur l’inimitabilité de sa langue arabe, n’admettait pas la traduction du texte sacré » C. Trabelsi, La problématique de la traduction du Coran, Presses Universitaires Montréal, v. 45, n°3, sept. 2000.
[34] « Dieu s’étant servi de la langue arabe n’a pu s’exprimer que dans le dialecte le plus pur et le coran est donc, au point de vue littéraire et grammatical, un texte d’une pureté irréprochable où un Arabe ne saurait, sans impiété, démêler la plus légère trace de faute. En outre, disent les orthodoxes, on ne saurait admettre que ce livre soit traduit dans une langue étrangère, car il serait à craindre qu’on ne rendît pas exactement la pensée de Dieu et qu’on lui prêtât ainsi des idées qu’il n’a point songé à exprimer ». O. Houdas. Grande Encyclopédie, entrée Coran. Plus récemment, J. Jomier écrit : « Pour les musulmans, le Coran est uniquement le Coran arabe, lui seul est empreint d’un caractère sacré. Le problème de la légitimité des traductions a été l’objet de longues discussions entre les docteurs de la loi. Finalement, il a été admis que la traduction des « idées » était possible ; mais le livre qui en résultait n’était plus vraiment le Coran et ne pouvait servir à des usages liturgiques ». Un chrétien lit le Coran, éditions du Cerf.
[35] Dont beaucoup étaient de tradition chrétienne.
[36] Khalid Ibn Yazid ibn Mu’âwiyya bin A. Sufyân, hérita du califat pendant trois mois, fut le premier des traducteurs en Islam. Dans son livre « Al-Bayân », al-Jâhiz affirme que Khâlid était : « poète et orateur, éloquent, avec un solide bon sens, la tête farcie de textes littéraires, et le premier à avoir traduit des ouvrages d’astronomie, de médecine et d’alchimie ».
[37] Al-Jâhiz, al-Bayân.
[38] S’effacer devant le texte et devant l’auteur qu’on traduit est la règle d’or du métier de traducteur. Ce n’est pas hélas toujours le cas.
[39] “ The voice of the tradition-again with the exception of the Hanafi school- is unanimous in declaring that is virtually impossible to translate Arabic into any language, still less to translate the Arabic of the Qur’ân ”, Tibawi, op.cité.
[40] « Eine genaue Überlieferung der Folge der älteren, überhaupt der mekkanischen, Suren ist übrigens kaum denkbar. Oder will man etwa annehmen, dass Muhammed ein Archiv führte, in welches die Suren nach ihrer Chronologie eingetragen wurden” [une exacte transmission de l’ordre des plus anciennes sourates, à savoir les mecquoises, est au demeurant à peine pensable. Sauf à admettre que Muhammed tenait une archive dans laquelle les sourates étaient ordonnées selon leur chronologie » Th. Nöldeke, in Geschichte des Qorans.
[41] Le numéro des versets dans la traduction Blachère ne correspond pas toujours à ceux de l’édition du Caire.
[42] Dans ses tentatives de classement chronologique des sourates du Coran, Nöldeke (in Geschichte des Qorans) écrit que les sourates où il est peu question ou pas du tout question des juifs et des chrétiens doivent être classées chronologiquement parmi les premières. Or la sourate al-Ikhlas, où il est fortement question de la croyance chrétienne de la « généalogie » de Dieu, est, selon la plupart des exégètes, mecquoise. Angelika Neuwirth déclare ranger 85 sourates comme mecquoises sans qu’aucun argument vienne étayer ses dires. (in Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, Berlin, 2007).
[43] Tout le récent « Coran des historiens » (éd. du Cerf) est, de part en part, tributaire des ces méthodes.
[44] Maxime Rodinson et Bernard Lewis en sont un excellent exemple.
[45] Blachère a eu l’honnêteté de reconnaître, dans son Introduction au Coran, qu’une part non négligeable de subjectivité entrait dans les recherches orientalistes.
[46] Blachère critique Hirschfield et W.Montgomery Watt critique Richard Bell. Ce dernier jugeait le système de Nöldeke, inspiré de Weil, primaire etc.
[47] Dans le dialogue connu sous le nom de « Parménide ». Comme le dit un éminent historien de la philosophie : « Aristote n’a pas déduit son ontologie d’une critique préalable de la doctrine platonicienne des Idées ; c’est au contraire une certaine vue ou un certain sentiment de la nature du réel qui lui ont dicté sa critique du platonisme ». E. Gilson, L’Être et l’Essence, Vrin, Paris.
[48] On pourrait ajouter que Hegel n’a nullement réfuté Kant, puisqu’il y eut des kantiens après la réfutation prétendument définitive de Hegel et Marx n’a nullement dépassé Hegel, puisqu’il y eut des hégéliens après Marx qui ont estimé que sa critique a « manqué le coche ». Après avoir opposé le sentiment de l’existence au « système » hégélien Kierkegaard n’a pas davantage convaincu les hégéliens de stricte obédience etc.
[49] Où la subjectivité remplit un rôle plus important qu’on ne veut bien l’avouer, comme le confesse Blachère, dans un élan de sincérité bien rare dans cette corporation.
[50] Nom désignant un prêtre prétendument nestorien.
[51] Mais il fallait provoquer le scandale pour attirer l’attention sur soi.
[52] Introduction au Coran p. 255. M. Rodinson partageait la même conviction. Voir son Mahomet, éd du Seuil.
[53] Günter Lüling, « Über den Ur-Qurân” Approches pour une reconstitution des hymnes antéislamiques chrétiens dans le Coran », 1974.
[54] « Studien zur Komposition der mekkanischen Suren », (à l’origine, une thèse de doctorat soutenue en 1976.) Berlin et John Burton, The collection of the Qur’ân, Cambridge University Press, 1977.
[55] Hagarism. The Making of the Islamic World, Cambridge University Press, 1980. Ils y écrivent : « no early source outside the Islamic literary tradition refers to Mecca by name », et que les adeptes de la nouvelle foi ne se nommaient pas « musulmans », mais les « Mahgraye. » : « the is no good reason to suppose that the bearers of this primitive identity called themselves ‘Muslims’ (p. 8).[…] “Our sources do however reveal an earlier designation of the community…this designation appears in Greek as ‘Magaritai’ in a papyrus of 642, and in Syriac as ‘Mahgre’ or ‘Mahgraye’ from as early as the 640s. The corresponding Arabic term is muhâjirûn » op cit, p 8.
[56] Il n’y a pas de preuve solide que le Coran ait existé sous quelque forme que ce soit avant la dernière décennie du VIIe siècle et la tradition, qui situe cette révélation plutôt opaque dans son contexte historique, n’est pas attestée avant le milieu du VIIIe siècle » P.Crone et M.Cook,op cité, p. 3.
[57] R. Brague, « Le Coran, sortir du cercle ? », revue Critique, avril 2003, éditions de Minuit.
[58] « Je suis conscient de n’avoir pour ce faire qu’une légitimité bien légère…Je suis moins arabisant que frotté d’arabe » déclare R. Brague. Chargé de titres et d’excellences, ce dernier se permet pourtant de se gausser des traductions du Coran et de dresser un palmarès des traducteurs « sérieux ». Ce qui sème le doute sur l’indigence de son savoir et sa (fausse ?) modestie bruyamment proclamées. (R. Brague, art.cit).
[59] « Des critiques sérieux décrivent un manque total de rigueur méthodologique». T. Nagel, article d’abord paru dans la F.A. Zeitung, repris dans Books nov-déc. 2009.
[60] L’orientalisme, mot devenu péjoratif et ayant mauvaise presse depuis l’article, qui fit grand bruit, d’Anouar Abd Al-Malek « Orientalism in crisis » (déc.1963) et des travaux d’Edward Saïd « Orientalism », publié en 1979, (L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident, T.française, Seuil 1980). On préfère parler maintenant d’ « islamologie ». Voir les réactions de Rodinson, dans La fascination de l’islam (Maspéro éditeur) et de Bernard Lewis, dans Islam, Gallimard et aussi l’essai de J.-P. Charnay, Les Contre-Orients, Sindbad, 1980.
[61] .
[62] C’est le mot arabe qui a donné en français « razzia » ou « rezzou ».
[63] Ali Mérad, L’exégèse coranique, Puf, Paris, 1998. « Pendant des siècles en Occident, note J. Jomier, il a été fort difficile de jeter un regard paisible sur l’Islam et le Coran ». « Un chrétien lit le Coran »., op cité.
[64] « Il est peu de livres religieux d’origine orientale dont la lecture, plus que celle du Coran, déconcerte nos habitudes intellectuelles […] devant ce texte hérissé de difficultés, riche par ses obscurités même, hérissé de difficultés, surprenant par son style elliptique, souvent allusif, nous nous arrêtons, quêtant l’idée directrice reliant entre eux, en une impeccable logique, des récits ou des développements dont l’enchaînement se découvre mal » R. Blachère, Le Coran, Puf, 1966.
[65] (1857-1916). Auteur du fameux « Cours de linguistique générale » édité par deux de ses disciples, Ch. Bally et C. A. Sechehaye sur la base des notes de cours professés par Saussure..
[1] Il ne s’agit pas de nier, ou même de minorer, les effets bénéfiques de cette somme des savoirs, mais de suggérer qu’elle a eu des effets pervers qui s’expliquent par toutes sortes de raisons, notamment la diversité des intérêts et les tropismes culturels ou politiques.
[2] Évoquant le jugement de Th. Carlyle qui, dans “The hero as prophet” jugeait la lecture du Coran “toilsome, wearisome, confused jumble”, W Montgomery Watt notait pourtant ceci : « It is against such a background that occidental scholars of the Qur’ân must consider what is required of them. Islamists, and generally orientalists, have functions to perform for their own society” (On Interpreting the Qur’ân, Oriens, vol. 25-26, Brill éditeur)
[3] Que la traduction de Mme Denise Masson ait été agréée par « des autorités musulmanes notoires, d’Al-Azhar en particulier » (C. Hamès, Porte ouverte sur un jardin fermé, Archives des sciences sociales des religions, avril-juin 1992), que la version de J Berque ait été qualifiée de « génial attentat contre le Coran » (Le Monde, 18-2-1991), par des journalistes non spécialistes de la question ou qu’elle ait été bien reçue par des universitaires ou des hommes politiques maghrébins ne signifie pas qu’elles soient parfaites ou qu’elles puissent être ipso facto soustraites à la critique indépendante, qui doit légitimement s’exercer.
[4] Maxime Rodinson, La fascination de l’Islam, F. Maspéro, Paris, 1980. Dans un entretien paru dans « Le Monde » en date du 7 février 1982, Rodinson estime que « Depuis quatorze siècles, d’une certaine façon, l’Occident est fasciné par l’islam parce que celui-ci a été longtemps son rival, son concurrent, son ennemi souvent, le plus proche au niveau des mondes culturels globaux ».
[5] On ne cite ici que les plus connus qui ont commis des traductions intégrales du Coran.
[6] Mohammed Arkoun, Préface à une réédition de la traduction de Kasimirski, reprise dans Lectures du Coran, Albin Michel, Paris, 2016.
[7] Dans ”Lire le Coran au présent », (Revue des deux mondes, mai 1991, pp 171-177) l’arabisant C. Jambet, rendant compte de la traduction française de Jacques Berque, alors professeur honoraire au Collège de France, ne semble pas s’être avisé que Berque n’a pas traduit nombre de fragments coraniques. En tout cas, C. Jambet ne le signale nulle part. Deux exemples parmi tant d’autres : dans la sourate 40, au verset 34, le fragment « كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب »n’a pas été traduit. Dans la sourate « al Hûjûrât » (les appartements), le traducteur omet de traduire la fin du verset 7, « اولئك هم الراشدون » (Ce sont ceux-là qui sont les bien-guidés).
[8] « Is the Qur’ân translatable ? Early Muslim Opinion», The Muslim World, vol. 52, Issue 1, january 1962, p. 4-16.
[9] Ou du moins pas encore.
[10] « Le classement des sourates dans l’édition première et définitive, le muçhaf, ne suit pas l’ordre chronologique de la révélation ou « descente ». Il y a plus : on trouve assez souvent à l’intérieur d’une même sourate des versets reçus à des moments séparés. De quoi ni la croyance, ni la science de l’Islam n’éprouvent la moindre inquiétude » note J. Berque, « En relisant le Coran », p. 714, Le Coran, essai de traduction, 1ère édition, Paris, 1990..
[11] Comme l’atteste l’existence au Collège de France d’une chaire intitulée « Histoire du Coran. Texte et transmission ».
[12] Certains orientalistes pointent, non sans malice, le cas des lettres isolées, dont personne ne sait le sens, et se font fort de les opposer à la proclamation quasi programmatique du Coran prétendu « clair » (mûbin). Le très méticuleux Ibn Hazm n’avait-il pas averti que tout dans le Coran est mûbin, à l’exception des serments et des lettres isolées ?
[13] Que signifient exactement ‘Abb’, Gibt’, et à quoi renvoie exactement « Iram » dont R. Blachère disait qu’ « Il est naturellement impossible de savoir ce que ce verset a pu exactement représenter pour la génération de Mahomet » ?
[14] Coran, LXXXIX, 6.
[15] W. Montgomery Watt, entrée « Iram », Encyclopédie de l’Islam.
[16] Il s’agit des fameux adhdâd.
[17] « Commencer l’étude du Coran par celle de sa composition, c’est l’aborder sous sa face la plus ardue » écrit J. Berque dans « En relisant le Coran », sorte de postface à sa traduction du Coran, Sindbad, 1990.
[18] Introduire dans le texte des titres, des intitulés, le démembrement des versets et leur réarrangement selon un ordre supposé chronologique, comme Blachère l’a tenté, après d’autres, est-il de nature à vraiment aider le lecteur à discerner la structure des sourates ? comme l’affirme W.M Watt ? cf. On interpreting the Qûr’ân, Oriens, vol 2, 1976.
[19] Du latin formido : effroi, terreur.
[20] Propos rapporté dans le magazine Books, numéro spécial consacré à « L’énigme du Coran », n° 10, nov-déc. 2009. Tous les orientalistes ne partagent pas l’opinion de Puin.
[21] Traduction J Berque, sourate XVIII, 105.
[22] « Le ‘ mystère ‘ : cette traduction pour ghayb n’est pas entièrement satisfaisante » note, sourate II, p.26 de sa traduction. On ne saurait trop admirer le sens de la litote. Voir la contribution de Gaudefroy-Demombynes, « Le sens du substantif Ghayb dans le Coran » dans Mélanges offerts à L. Massignon, Institut d’études islamiques de Paris et l’Institut français de Damas, 1956 et l’entrée « Invisible » dans le « Dictionnaire du Coran » sous la direction de M. Moezzi (Laffont éditeur).
[23] L. Massignon, Écrits mémorables, II, p. 423. Robert Laffont, Paris, 2009.
[24] L Massignon, Préface à la traduction du Coran de M. Hamidullah, Le Club français du livre, 1977.
[25] Préface à la version de Denise Masson, Gallimard, 1967.
[26] J.-C. Mardrus, Le Koran, traduction littérale et complète des Sourates Essentielles, Fasquelle éditeur, Paris, 1926.
[27] Coran, XVII, 88, dans la version de R. Blachère. Autres translations du même fragment : « Dis : « Si les hommes et les Djinns s’unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien qui lui ressemble, même s’ils s’aidaient mutuellement » (Tf : D. Masson, 1967) ; « Dis : « Quand même hommes et djinns s’uniraient pour apporter le semblable de ce Coran, ils n’en sauraient apporter le semblable, même s’ils se soutenaient les uns les autres »(Tf : M Hamidullah, 1977) ou : « Dis : Quand les hommes et les génies se réuniraient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien de pareil, lors même qu’ils s’aideraient mutuellement » (Tf Kasimirski, 1841).
[28] « Le Coran est insupérable ; nul ne peut [en produire] un semblable. Allah a mis en échec tous les hommes et les djinns, les Arabes comme les non-Arabes, qui ne sauraient en produire un qui présente semblable composition…Là-dessus le consensus règne parmi les musulmans ». Ibn Hazm, Al-Fisâl, vol III, p. 25, éd. Dar al-Jîl, Beyrouth, 1996.
[29] « Nous l’avons fait descendre sur toi en un Coran arabe, peut-être comprendrez-vous » (Tf D. Masson) ou « Nous l’avons révélé Coran arabe afin que vous le méditiez » (Tf A. Penot).
[30] Dix-septième épître, vol III, p 144.
[31] Thèse qu’il développe dans « Ta’wîl Mushkil al- Qur’ân ». (De l’interprétation du problème du Coran) Bibliothèque scientifique, sd.
[32] « Selon l’enseignement de l’islam, le Coran est inimitable : il est donc impensable de le traduire » note F. Déroche, entrée « Traductions », Dictionnaire du Coran, publié sous la direction de M. A. Amir Moezzi, Robert Laffont, Paris, 2007. De son côté, M. Gloton note que « Le Qur’ân, ne provenant ni d’un poète, ni d’un oracle, ni d’un individu, mais bien d’Allah, ne peut être imité dans son style » Le Coran, essai de traduction et annotations, édition bilingue, al-Bouraq éditeur..
[33] « Un fort courant musulman traditionnel, se fondant d’une part sur l’impossibilité de cerner tous les sens du Coran, que seul Dieu connaît, et, d’autre part, sur l’inimitabilité de sa langue arabe, n’admettait pas la traduction du texte sacré » C. Trabelsi, La problématique de la traduction du Coran, Presses Universitaires Montréal, v. 45, n°3, sept. 2000.
[34] « Dieu s’étant servi de la langue arabe n’a pu s’exprimer que dans le dialecte le plus pur et le coran est donc, au point de vue littéraire et grammatical, un texte d’une pureté irréprochable où un Arabe ne saurait, sans impiété, démêler la plus légère trace de faute. En outre, disent les orthodoxes, on ne saurait admettre que ce livre soit traduit dans une langue étrangère, car il serait à craindre qu’on ne rendît pas exactement la pensée de Dieu et qu’on lui prêtât ainsi des idées qu’il n’a point songé à exprimer ». O. Houdas. Grande Encyclopédie, entrée Coran. Plus récemment, J. Jomier écrit : « Pour les musulmans, le Coran est uniquement le Coran arabe, lui seul est empreint d’un caractère sacré. Le problème de la légitimité des traductions a été l’objet de longues discussions entre les docteurs de la loi. Finalement, il a été admis que la traduction des « idées » était possible ; mais le livre qui en résultait n’était plus vraiment le Coran et ne pouvait servir à des usages liturgiques ». Un chrétien lit le Coran, éditions du Cerf.
[35] Dont beaucoup étaient de tradition chrétienne.
[36] Khalid Ibn Yazid ibn Mu’âwiyya bin A. Sufyân, hérita du califat pendant trois mois, fut le premier des traducteurs en Islam. Dans son livre « Al-Bayân », al-Jâhiz affirme que Khâlid était : « poète et orateur, éloquent, avec un solide bon sens, la tête farcie de textes littéraires, et le premier à avoir traduit des ouvrages d’astronomie, de médecine et d’alchimie ».
[37] Al-Jâhiz, al-Bayân.
[38] S’effacer devant le texte et devant l’auteur qu’on traduit est la règle d’or du métier de traducteur. Ce n’est pas hélas toujours le cas.
[39] “ The voice of the tradition-again with the exception of the Hanafi school- is unanimous in declaring that is virtually impossible to translate Arabic into any language, still less to translate the Arabic of the Qur’ân ”, Tibawi, op.cité.
[40] « Eine genaue Überlieferung der Folge der älteren, überhaupt der mekkanischen, Suren ist übrigens kaum denkbar. Oder will man etwa annehmen, dass Muhammed ein Archiv führte, in welches die Suren nach ihrer Chronologie eingetragen wurden” [une exacte transmission de l’ordre des plus anciennes sourates, à savoir les mecquoises, est au demeurant à peine pensable. Sauf à admettre que Muhammed tenait une archive dans laquelle les sourates étaient ordonnées selon leur chronologie » Th. Nöldeke, in Geschichte des Qorans.
[41] Le numéro des versets dans la traduction Blachère ne correspond pas toujours à ceux de l’édition du Caire.
[42] Dans ses tentatives de classement chronologique des sourates du Coran, Nöldeke (in Geschichte des Qorans) écrit que les sourates où il est peu question ou pas du tout question des juifs et des chrétiens doivent être classées chronologiquement parmi les premières. Or la sourate al-Ikhlas, où il est fortement question de la croyance chrétienne de la « généalogie » de Dieu, est, selon la plupart des exégètes, mecquoise. Angelika Neuwirth déclare ranger 85 sourates comme mecquoises sans qu’aucun argument vienne étayer ses dires. (in Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, Berlin, 2007).
[43] Tout le récent « Coran des historiens » (éd. du Cerf) est, de part en part, tributaire des ces méthodes.
[44] Maxime Rodinson et Bernard Lewis en sont un excellent exemple.
[45] Blachère a eu l’honnêteté de reconnaître, dans son Introduction au Coran, qu’une part non négligeable de subjectivité entrait dans les recherches orientalistes.
[46] Blachère critique Hirschfield et W.Montgomery Watt critique Richard Bell. Ce dernier jugeait le système de Nöldeke, inspiré de Weil, primaire etc.
[47] Dans le dialogue connu sous le nom de « Parménide ». Comme le dit un éminent historien de la philosophie : « Aristote n’a pas déduit son ontologie d’une critique préalable de la doctrine platonicienne des Idées ; c’est au contraire une certaine vue ou un certain sentiment de la nature du réel qui lui ont dicté sa critique du platonisme ». E. Gilson, L’Être et l’Essence, Vrin, Paris.
[48] On pourrait ajouter que Hegel n’a nullement réfuté Kant, puisqu’il y eut des kantiens après la réfutation prétendument définitive de Hegel et Marx n’a nullement dépassé Hegel, puisqu’il y eut des hégéliens après Marx qui ont estimé que sa critique a « manqué le coche ». Après avoir opposé le sentiment de l’existence au « système » hégélien Kierkegaard n’a pas davantage convaincu les hégéliens de stricte obédience etc.
[49] Où la subjectivité remplit un rôle plus important qu’on ne veut bien l’avouer, comme le confesse Blachère, dans un élan de sincérité bien rare dans cette corporation.
[50] Nom désignant un prêtre prétendument nestorien.
[51] Mais il fallait provoquer le scandale pour attirer l’attention sur soi.
[52] Introduction au Coran p. 255. M. Rodinson partageait la même conviction. Voir son Mahomet, éd du Seuil.
[53] Günter Lüling, « Über den Ur-Qurân” Approches pour une reconstitution des hymnes antéislamiques chrétiens dans le Coran », 1974.
[54] « Studien zur Komposition der mekkanischen Suren », (à l’origine, une thèse de doctorat soutenue en 1976.) Berlin et John Burton, The collection of the Qur’ân, Cambridge University Press, 1977.
[55] Hagarism. The Making of the Islamic World, Cambridge University Press, 1980. Ils y écrivent : « no early source outside the Islamic literary tradition refers to Mecca by name », et que les adeptes de la nouvelle foi ne se nommaient pas « musulmans », mais les « Mahgraye. » : « the is no good reason to suppose that the bearers of this primitive identity called themselves ‘Muslims’ (p. 8).[…] “Our sources do however reveal an earlier designation of the community…this designation appears in Greek as ‘Magaritai’ in a papyrus of 642, and in Syriac as ‘Mahgre’ or ‘Mahgraye’ from as early as the 640s. The corresponding Arabic term is muhâjirûn » op cit, p 8.
[56] Il n’y a pas de preuve solide que le Coran ait existé sous quelque forme que ce soit avant la dernière décennie du VIIe siècle et la tradition, qui situe cette révélation plutôt opaque dans son contexte historique, n’est pas attestée avant le milieu du VIIIe siècle » P.Crone et M.Cook,op cité, p. 3.
[57] R. Brague, « Le Coran, sortir du cercle ? », revue Critique, avril 2003, éditions de Minuit.
[58] « Je suis conscient de n’avoir pour ce faire qu’une légitimité bien légère…Je suis moins arabisant que frotté d’arabe » déclare R. Brague. Chargé de titres et d’excellences, ce dernier se permet pourtant de se gausser des traductions du Coran et de dresser un palmarès des traducteurs « sérieux ». Ce qui sème le doute sur l’indigence de son savoir et sa (fausse ?) modestie bruyamment proclamées. (R. Brague, art.cit).
[59] « Des critiques sérieux décrivent un manque total de rigueur méthodologique». T. Nagel, article d’abord paru dans la F.A. Zeitung, repris dans Books nov-déc. 2009.
[60] L’orientalisme, mot devenu péjoratif et ayant mauvaise presse depuis l’article, qui fit grand bruit, d’Anouar Abd Al-Malek « Orientalism in crisis » (déc.1963) et des travaux d’Edward Saïd « Orientalism », publié en 1979, (L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident, T.française, Seuil 1980). On préfère parler maintenant d’ « islamologie ». Voir les réactions de Rodinson, dans La fascination de l’islam (Maspéro éditeur) et de Bernard Lewis, dans Islam, Gallimard et aussi l’essai de J.-P. Charnay, Les Contre-Orients, Sindbad, 1980.
[61] .
[62] C’est le mot arabe qui a donné en français « razzia » ou « rezzou ».
[63] Ali Mérad, L’exégèse coranique, Puf, Paris, 1998. « Pendant des siècles en Occident, note J. Jomier, il a été fort difficile de jeter un regard paisible sur l’Islam et le Coran ». « Un chrétien lit le Coran »., op cité.
[64] « Il est peu de livres religieux d’origine orientale dont la lecture, plus que celle du Coran, déconcerte nos habitudes intellectuelles […] devant ce texte hérissé de difficultés, riche par ses obscurités même, hérissé de difficultés, surprenant par son style elliptique, souvent allusif, nous nous arrêtons, quêtant l’idée directrice reliant entre eux, en une impeccable logique, des récits ou des développements dont l’enchaînement se découvre mal » R. Blachère, Le Coran, Puf, 1966.
[65] (1857-1916). Auteur du fameux « Cours de linguistique générale » édité par deux de ses disciples, Ch. Bally et C. A. Sechehaye sur la base des notes de cours professés par Saussure..