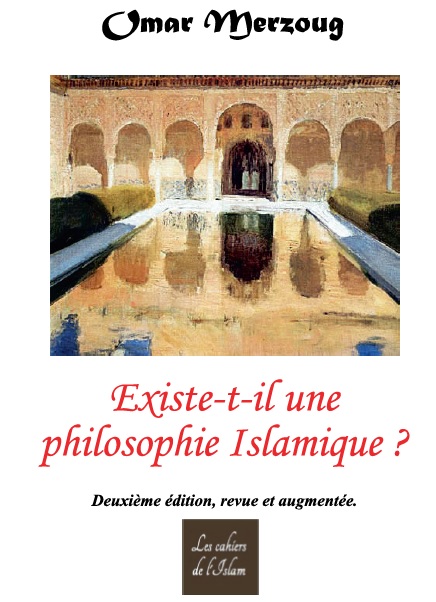La diffusion de l’islam dans les différents pays de l’Amérique latine, qui n’est pas spectaculaire mais constante, est le produit à la fois de migrations de personnes musulmanes (soit venant de pays dits arabo-musulmans soit de pays non musulmans comme la France ou les États-Unis) et de conversions, avec un taux de conversion sensiblement supérieur à ce qu’il est dans les pays européens. L’implantation de cette religion de ce côté de l’Atlantique se traduit visiblement par la constitution de lieux de cultes, salles de prière et mosquées, qui allient en général de façon substantielle salle de prière et lieu d’enseignement que ce soit du côté sunnite (incluant les diverses obédiences soufis) ou du côté chiite, comprenant en particulier des cours de langue. En effet la maîtrise minimale de l’arabe est présentée comme une condition sine qua non de la conversion, qui passe par la récitation avec compréhension de la profession de foi, dite shahâda, et le fait que celle-ci doit être prononcée en arabe est une affirmation non questionnée.
Non questionnée non plus, du moins en Amérique latine, y compris par des musulmans qui sont très loin de l’orthodoxie (il y a par exemple des musulmanes converties qui défendent le féminisme islamique et le droit à l’avortement) ou des musulmans victimes de racisme (soupçonnés, en tant qu’indigènes, d’être incapables de devenir de vrais musulmans, selon le témoignage d’Aymaras en Bolivie ou de musulmanes latinos au Costa Rica) est l’affirmation que la prière obligatoire performée cinq fois par jour dans le sunnisme et de façon communautaire le vendredi, doive être en arabe coranique, quel que soit le degré de compréhension de cette « langue » ; il convient de mettre des guillemets, car l’arabe coranique n‘est pas une langue en tant que telle mais l’idiome singulier dans lequel est écrit le Coran – une langue dite « claire » pour un texte qui est souvent à la limite de l’incompréhensible.
Non questionnée non plus, du moins en Amérique latine, y compris par des musulmans qui sont très loin de l’orthodoxie (il y a par exemple des musulmanes converties qui défendent le féminisme islamique et le droit à l’avortement) ou des musulmans victimes de racisme (soupçonnés, en tant qu’indigènes, d’être incapables de devenir de vrais musulmans, selon le témoignage d’Aymaras en Bolivie ou de musulmanes latinos au Costa Rica) est l’affirmation que la prière obligatoire performée cinq fois par jour dans le sunnisme et de façon communautaire le vendredi, doive être en arabe coranique, quel que soit le degré de compréhension de cette « langue » ; il convient de mettre des guillemets, car l’arabe coranique n‘est pas une langue en tant que telle mais l’idiome singulier dans lequel est écrit le Coran – une langue dite « claire » pour un texte qui est souvent à la limite de l’incompréhensible.
Les convertis des pays latino-américains ne maîtrisent pas cette « langue » ; certes, mais il faut dire qu’ils ne sont pas dans une position fondamentalement différente que les arabophones. En effet, l’arabe moderne, et ses formes dialectales vernaculaires plus encore, est à l’arabe du Coran ce que l’espagnol est au latin de Lucrèce, créateur d’une langue poétique et archaïsante, ou plutôt ce que le grec contemporain est à la langue d’Homère dont l’étrangeté poétique devait être, y compris par les grecs de la Grèce classique, interprétée en permanence, si bien qu’elle a donné lieu à une tradition exégétique pour le moins imposante. De plus, la langue arabe a évolué dans le temps, tandis que le Coran est resté figé, si bien que le sens du Coran a subi des glissements sémantiques : par exemple quand on dit Jayb en langue Coranique, et qu’on l’interprète par « poitrine » au lieu de l’interpréter par « matrice/ poche », le signifiant ne bouge pas, mais le signifié a bougé, si bien qu’on est paradoxalement dans de la traduction, alors même qu’on ne saute pas d’une langue à une autre. Autrement dit, compte tenu du caractère arbitraire et évolutif du langage, on récite un Coran complètement décalé de « son » intention de départ (Qasd). Dès lors, pourquoi interdire les versions traduites dans le rituel ? En effet, si l’intention est plus importante que les actes, elle prend le dessus sur la lettre. Ou alors, doit-on penser que de toute façon le sens du Coran est transcendant, donc inaccessible, d’où l’importance de le réciter sans vraiment le comprendre ? En tout cas, l’islam est par définition une religion qui implique un plurilinguisme ou un code shifting ou un code switching. L’accès au Coran nécessite un apprentissage de plusieurs années, que ce soit par la mémorisation (qui abandonne la question du sens) ou par la compréhension – qui, quant à elle, est sans fin. La première est traditionnellement très importante, et elle est enseignée dès l’enfance dans les madrasas, écoles Coraniques, et doit être entretenue toute sa vie. Le hâfiz – une personne qui connaît par cœur tout le Coran – est très valorisée, dans la mesure où on estime que, par sa mémorisation, qui doit permettre une récitation selon la règle de récitation (tajwid ) et comporte aussi la connaissance de la vocalisation, il porte en soi la parole de dieu. Le hâfiz peut être par ailleurs totalement illettré.

Avec la seconde, on entre dans un univers de savoir incommensurable, celui du tafsîr, qui est une interprétation du sens littéral (sens apparent (zahîr), et appartient à l’arborescence des sciences religieuses islamiques, à côté de l'ʼIʻrāb (analyse syntaxique des versets) et du tabyîn (l’explicitation du sens « littéral »), et vise l'explication des termes du Coran et ce que l'on en tire d'enseignement. Le tafsir qui repose sur des règles d’interprétation sophistiquées nécessite naturellement une connaissance de l’arabe Coranique ainsi que de toute la tradition orale ; il se compose de la connaissance des « causes de la révélation » (sabab nuzul), de « l'abrogeant et de l'abrogé » (nasikh wa mansoukh) et du « mécquois et du médinois » parmi les versets et sourates. La connaissance ou la « science » (ilm) qui désigne la connaissance religieuse dans le Coran, est, pour le musulman, un bien symbolique et spirituel hautement souhaitable, plus encore pour ceux qui ne sont pas nés musulmans et veulent compenser par un haut degré de savoir islamique ce qui est vécu souvent comme un handicap initial. À côté de ces centres de prière et d’enseignement, il y a une multiplicité de propositions par internet ainsi que la possibilité d’obtenir une bourse pour un cursus d’études dans un pays où les sciences islamiques sont enseignées.
Alors que, d’évidence, la plupart des grands auteurs de tafsir ont écrit en arabe, les écoles et formations en sciences islamiques qui se trouvent hors des pays arabophones assurent aujourd’hui leurs cours et formations en langue vernaculaire et recommandent, au moins pour commencer, de se baser sur des ouvrages traduits ou sur des ouvrages de vulgarisation. Le « message » du Coran, la compréhension de son sens, est accessible quelle que soit la langue. De façon intéressante, il y a une contradiction dynamique entre les caractéristiques du Coran, défini par la clarté et l’univocité de son sens ainsi que par l’universalité de son message, et la complexité de son exégèse, marquée par la plurivocité, la sophistication et la technicité.
À la suite de travaux sur les modèles chrétiens d’évangélisation, ainsi que sur la querelle des rites qui appartient à l’histoire du catholicisme en Chine, je me suis interrogée sur l’éventualité d’une performation de la prière obligatoire dans une langue d’usage (que ce soit la langue maternelle ou la langue d’usage – la question se pose en Amérique latine où de nombreuses personnes maîtrisent plusieurs langues, comme dans les Andes l’aymara ou le quechua et le castillan) ou dans une autre langue de savoir islamique. J’ai souligné que l’apprentissage des sciences islamiques se fait souvent en vernaculaire, mais il y a aussi des traditions d’exégèse savante qui ne sont pas en arabe. Par exemple les Ouïghours en Chine, selon la tradition centrasiatique, pratiquent l'exégèse coranique en persan tout en étant sunnites, dans une branche soufie, et turcophones.
À la suite de travaux sur les modèles chrétiens d’évangélisation, ainsi que sur la querelle des rites qui appartient à l’histoire du catholicisme en Chine, je me suis interrogée sur l’éventualité d’une performation de la prière obligatoire dans une langue d’usage (que ce soit la langue maternelle ou la langue d’usage – la question se pose en Amérique latine où de nombreuses personnes maîtrisent plusieurs langues, comme dans les Andes l’aymara ou le quechua et le castillan) ou dans une autre langue de savoir islamique. J’ai souligné que l’apprentissage des sciences islamiques se fait souvent en vernaculaire, mais il y a aussi des traditions d’exégèse savante qui ne sont pas en arabe. Par exemple les Ouïghours en Chine, selon la tradition centrasiatique, pratiquent l'exégèse coranique en persan tout en étant sunnites, dans une branche soufie, et turcophones.
Il y a plusieurs angles pour aborder la question des enjeux de la récitation de la prière obligatoire en vernaculaire, sur laquelle il n’y a pas de travaux systématiques [1]. D’abord un angle d’ordre comparatif qui alignerait l’islam sur le christianisme dans une vision libérale progressiste. Les historiens mettent en relation l’évolution interne du christianisme et le rôle joué par la traduction de la Bible en vernaculaire et la désacralisation de la vulgate – la Bible en latin qui avait un statut de texte sacré. On sait moins qu’elle a été remplacée au 17e siècle par la version Septante (grecque) qui permettait de faire tenir debout la chronologie sainte contestée par l’historiographie chinoise. Il faut encore faire intervenir le contexte chinois pour toucher le noyau dur et pour le moment intangible du rite catholique : en effet, au terme de la querelle des rites, il n’a jamais été transigé sur la composition de l’hostie – du blé. L’inculturation connaît ses limites, qui ne sont pas celles de la traduction de la Bible, laquelle est au cœur de l’opération missionnaire. Autrement dit, la traduction de la Bible, qui n’est pas un texte sacré, ne posait aucune difficulté d’ordre théologique aux chrétiens pour qui c’est le Christ qui incarne la parole de dieu (le Verbe divin fait homme) ; la situation est autre pour le Coran, considéré comme la parole même de dieu exprimée dans un texte dicté, incréé, sans qu’il y ait la moindre inclusion de la parole de Mahomet, considéré comme un simple porte-parole.
En réalité, la position de Mustafa Kemal, qui a tenté d’imposer la vernacularisation de la performance de la prière, inspiré par Ziya Gökalp, est donc moins théologique que politique ; et la manière dont il a voulu instrumentaliser la religion et la laïcité en constituant en réalité un régime dictatorial constitue un précédent pour l’islamisme qui se diffuse dans les pays majoritairement musulman où la vernacularisation est rapportée à l’occidentalisation, si bien que le retour à la prière en arabe a été vécu en 1950 comme une libération [2].
Et pourtant, il est facile de voir que certains individus ou groupes musulmans préconisent le vernaculaire pour performer la prière, en se revendiquant d’une évolution libéraleprogressiste dans l’islam. Je veux parler des musulmans dits humanistes c’est-à-dire pour qui l’unité de dieu n’implique pas un théocentrisme absolu, mais également des courants LGTB [3], et d’autres mouvements qui sont rejetés de l’islam orthodoxe. Pour ces derniers, le choix de prier en vernaculaire est militant, comme une façon de casser les normes d’une orthopraxie visant à la standardisation et refusant tout compromis avec ce qui est présenté comme une morale moderne. Pour les premiers, qui acceptent toutes les formes de critique textuelle sur le Coran, à l’image de la façon dont la bible hébraïque et la bible chrétienne ont été soumises à la méthode historico-critique, ils engagent une réflexion parfois qualifiée de néo mutazilite pour affirmer la nécessité de contextualiser et historiciser en particulier des versets qui s’expliquent dans le contexte de l’Arabie du VIIe siècle, mais ne sont manifestement plus en phase avec les exigences morales de notre époque. L’idée qui sous-tend leur démarche affirmant que le Coran est « créé » et non pas « incréé » est que, y compris dans le Coran, Dieu et Sa parole n’ont pas le même statut. Dieu transcende le temps, mais Sa parole s’implique dans le temps. Elle entrelace l’absolu et le relatif, l’universel et le particulier, le spirituel et le temporel. C’est pourquoi le Coran ne peut être lu comme un ensemble de commandements à observer tels quels partout et toujours, comme l’explique Mahmoud Hussein [4].
Le choix du vernaculaire rassemble ceux qui sont persécutés par les entrepreneurs d’un islam rigoriste - wahhabites en tête dont émane la plus grande production de livres et de supports audio, y compris en Amérique latine ; prier dans sa langue est ainsi une résistance, parfois enracinée dans une tradition (on pense aux alévis turcs, parfois rejetés de l’islam [5]) en même temps qu’un appel à un islam inclusif tolérant, moderne, adapté au monde sécularisé.
Il convient d’évoquer ici, à la limite du thème de la prière, les versions en français du Coran telles qu’elles permettent en Afrique aux femmes de s’affranchir du contrôle patriarcal, sur la base de l’inventivité linguistique [6] : en effet, alors que les femmes dites en état d’impureté ne peuvent, selon l’orthodoxie, ni toucher ni lire le Coran, elles ont cependant accès à tout moment à un Coran traduit, dépourvu de cette sacralité – je ne sais cependant pas si ce Coran peut être traduit par une femme. Il faut rappeler que la version Pléiade, la grande édition française de textes de l’humanité, a été pendant longtemps attribuée à D. Masson, pour ne pas écrire Denise [7].
Néanmoins ces entreprises de traduction sont admises et même encouragées par les orthodoxes dès lors que « elles doivent être comprises, non pas comme des contretypes du Message divin, mais uniquement comme des commentaires d’un très haut niveau du Livre saint. Elles sont le témoignage de l’érudition de leurs auteurs et œuvrent pour l’assimilation du message coranique, sans pour autant nier l’intangibilité du texte arabe [8]. »
L’interprétation libérale progressiste, qui établit une relation nécessaire entre modernisation et sécularisation [9], et tente de faire le lien entre des expériences religieuses très différentes, va souvent de pair avec une certaine approche de l’histoire des religions, également téléologique, qui décrirait un itinéraire d’épurement de la religion, passant d’une forte ritualisation à une spiritualisation et une intériorisation. Force est de constater cependant que ce mouvement dont la description rappelle quelquefois les « grands récits » si souvent déconstruits ne s’avère pas et que cette interprétation repose sur une compréhension limitée de la religion et des rites [10]. Il n’est donc pas évident que la « modernité » soit le synonyme d’un développement des langues vernaculaires en opposition avec la langue religieuse /classique. Outre la critique théorique que l’on peut adresser à l’interprétation libérale progressiste, elle ne résiste pas à l’épreuve des faits, et la mise en équivalence de l’adoption de la prière en langue vernaculaire et d’individus ou groupes mis au ban par l’orthodoxie musulmane ne vaut pas généralement ; certes elle vaut pour les alévis, mais pas pour les membres de l’ahmadiyya, un mouvement réformiste musulman messianiste et missionnaire, très présent en Amérique latine [11] qui, en raison même de leur persécution au Pakistan et de leur exclusion de l’islam par l’orthodoxie, tiennent à l’arabe coranique pour manifester leur appartenance à l’oumma, ou communauté de fidèles musulmans, et la rectitude de leur interprétation ; en effet ils ne sont interdits au Pakistan que s’ils se disent musulmans et il leur est défendu de lire le Coran.
Un autre exemple parmi tant d’autres serait un groupe de Kenyans [12] qui maintiennent l’arabe dans la juxtaposition de leur système de croyance – les religions traditionnelles d’un côté et l’islam de l’autre sont juxtaposés comme les deux langues ne se mêlent pas et comme dans les lieux de culte les niches des unes et de l’autre sont bien séparées. Les orthodoxes les accusent évidemment d’associationnisme, et critiquent ce qu’ils interprètent comme la rémanence de cultes préislamiques.
Aussi peut-on avancer une deuxième ligne d’interprétation sur la base de la distinction, dans l’islam, entre un universalisme représenté par le peuple de dieu – l’oumma – sans distinction de genre ou de race, et un hégémonisme arabe qui accompagne l’expansion de l’islam depuis son origine ; le fondateur des Frères musulmans, Hassan al-Banna le soutient dans ses Épîtres, attribuant entre autres aux Ottomans et à leur incapacité à comprendre le Coran en arabe la responsabilité du déclin politique des musulmans [13]. De nombreux musulmans s’insurgent contre l’« ethnicisation de l’islam [14] », et de fait c’est bien une vision plus sociale et politique de la religion, qui met en évidence l’arabité parfois ethnocentrique de la religion, si bien qu’y compris dans des courants non fréristes, adopter l’islam c’est aussi adopter un accoutrement, une nourriture, revendiquer la supériorité civilisationnelle de l’Islam avec un grand i, défendre les « causes arabes », dont en particulier les Palestiniens, même dans la période contemporaine où le panislamisme a détrôné le panarabisme [15]. Le panislamisme porte cependant des traces importantes du panarabisme. « Tout se passe comme si le sentiment de solidarité arabe était récupéré par le panislamisme. Etrange trajectoire d’un nationalisme qui s’exprime désormais par le biais d’un mouvement internationaliste par essence [16]. » En effet, le panislamisme définit un universalisme ouvert aux non arabes, mais l’arabe est un ciment fort de cette oumma, concept politique né au XXe siècle à partir d’une réalité anthropologique : « Le mot umma, étymologiquement, réfère à la mère (umm), à la tente (bayt, en hébreu olêl et en arabe ahl) de l’épouse du chef, à la maisonnée du chef, à sa famille cognatique et à sa clientèle ; par opposition à son clan agnatique, et à sa race, désignée, comme Ibn Khaldoun l’a noté, par le mot sha’b, “peuple” ; le sentiment raciste (shu’ûbiyya), l’esprit de corps (‘asabiyya) du clan désigne ce particularisme nationaliste [17]. » La constitution transnationale de l’oumma, substituée à la nation arabe, explique que le pouvoir turc, en dépit de son très fort nationalisme dit néo-ottoman [18], ne promeuve pas le turc comme langue de la prière, ce qui se pratique cependant dans quelques mosquées de la diaspora, en France et en Allemagne. En effet, d’une part l’intention de turciser le Coran – et la prière – remonte à Ataturk, et sa « Révolution linguistique » est « perçue comme antireligieuse et anti-islamique [19] » ; d’autre part, le rêve califal se superpose au rêve néo-ottoman, et exige l’arabe, d’autant qu'il a été établi que le chef de la communauté musulmane, le calife doit être un membre de la tribu de Qoreish.
En revanche, alors que le panislamisme se comprend en parallèle avec la mutation de l’identité panarabe en identité sunnite, on pourrait entendre que la résistance des chiites passe par l’affirmation du vernaculaire pour la prière, ce qui se fait quelquefois en Iran [20]. Rappelons que Salman al Farissi – Salman le Perse, qui reconnut Mahomet alors qu’il était esclave et se convertit en même temps qu’il put s’affranchir, et qui fut donc un compagnon du prophète et par ailleurs très proche de l’imam Ali – est dit avoir traduit le Coran en persan et avoir été autorisé à lire la Fatiha [21] en persan ; la légende doit bien dire quelque chose de la réalité des pratiques originelles chez les proches de l’imam Ali [22]. Pourtant on ne peut assimiler chiites et langue perse : rappelons que d’une part les chiites ne sont pas majoritairement persans, un grand nombre sont arabes, et même la ville sainte du chiisme se trouve dans ce qui est aujourd’hui l’Irak. Le conflit moderne entre chiisme et sunnisme prend son essor, non pas autour de conflits confessionnels, mais en raison des usages politiques des deux courants de l’islam, avec la création des États ottoman et safavide, et plus encore autour de la tentative d’assimilation politique moderne du chiisme et de la République islamique d’Iran [23]. La distinction de taille entre chiites et sunnites du point de vue de la prière ne concerne pas la langue de la prière, mais son organisation : les chiites retiennent trois prières quotidiennes et non pas cinq, ou plus précisément ils groupent les cinq prières en trois.
Dans la continuité de l’interprétation sociale et culturelle de la revendication de la prière en vernaculaire, il convient d’attirer l’attention sur l’opposition entre un islam populaire et un islam plus conscientisé. En effet, de nombreuses personnes des générations antérieures, au Maghreb, témoignent avoir prié intégralement en amazigh (berbère) et cela non pas par protestation contre quelque pression que ce soit, mais parce qu’elles étaient analphabètes dans toutes langues, et néanmoins pieuses. On ne peut dire que cet usage était réservé à la prière individuelle, et hors rite communautaire – la prière du vendredi en particulier, dans la mesure où l’obligation d’assister au prône du vendredi donné par un imam devenu salarié de l’État est récente : elle remonte aux années 1980, concomitante à la rénovation et construction de mosquées. Ce n’est pas l’alphabétisation – et donc une meilleure connaissance des exigences des textes religieux – qui a réduit voire interdit cette pratique, mais d’une part la situation politique de l’Algérie indépendante qui réprimait les aspirations à l’autonomie des régions kabyles et l’affirmation de leur différence culturelle passant par la langue, ainsi que la salafisation qui a introduit sa propagande et imposé un islam uniforme, soumis à un très fort contrôle social et fondé sur le takfirisme –exclusion des déviants – qui s’est diffusé à la faveur de l’électrification des lieux de culte, qui leur conférait d’autres fonctions, et de l’arrivée des haut-parleurs [24]. Aujourd’hui existent des traductions du Coran en amazigh, qui ne sont cependant guère plus accessibles, car la plupart des gens ne maîtrisent pas l’alphabet.
En réalité, la position de Mustafa Kemal, qui a tenté d’imposer la vernacularisation de la performance de la prière, inspiré par Ziya Gökalp, est donc moins théologique que politique ; et la manière dont il a voulu instrumentaliser la religion et la laïcité en constituant en réalité un régime dictatorial constitue un précédent pour l’islamisme qui se diffuse dans les pays majoritairement musulman où la vernacularisation est rapportée à l’occidentalisation, si bien que le retour à la prière en arabe a été vécu en 1950 comme une libération [2].
Et pourtant, il est facile de voir que certains individus ou groupes musulmans préconisent le vernaculaire pour performer la prière, en se revendiquant d’une évolution libéraleprogressiste dans l’islam. Je veux parler des musulmans dits humanistes c’est-à-dire pour qui l’unité de dieu n’implique pas un théocentrisme absolu, mais également des courants LGTB [3], et d’autres mouvements qui sont rejetés de l’islam orthodoxe. Pour ces derniers, le choix de prier en vernaculaire est militant, comme une façon de casser les normes d’une orthopraxie visant à la standardisation et refusant tout compromis avec ce qui est présenté comme une morale moderne. Pour les premiers, qui acceptent toutes les formes de critique textuelle sur le Coran, à l’image de la façon dont la bible hébraïque et la bible chrétienne ont été soumises à la méthode historico-critique, ils engagent une réflexion parfois qualifiée de néo mutazilite pour affirmer la nécessité de contextualiser et historiciser en particulier des versets qui s’expliquent dans le contexte de l’Arabie du VIIe siècle, mais ne sont manifestement plus en phase avec les exigences morales de notre époque. L’idée qui sous-tend leur démarche affirmant que le Coran est « créé » et non pas « incréé » est que, y compris dans le Coran, Dieu et Sa parole n’ont pas le même statut. Dieu transcende le temps, mais Sa parole s’implique dans le temps. Elle entrelace l’absolu et le relatif, l’universel et le particulier, le spirituel et le temporel. C’est pourquoi le Coran ne peut être lu comme un ensemble de commandements à observer tels quels partout et toujours, comme l’explique Mahmoud Hussein [4].
Le choix du vernaculaire rassemble ceux qui sont persécutés par les entrepreneurs d’un islam rigoriste - wahhabites en tête dont émane la plus grande production de livres et de supports audio, y compris en Amérique latine ; prier dans sa langue est ainsi une résistance, parfois enracinée dans une tradition (on pense aux alévis turcs, parfois rejetés de l’islam [5]) en même temps qu’un appel à un islam inclusif tolérant, moderne, adapté au monde sécularisé.
Il convient d’évoquer ici, à la limite du thème de la prière, les versions en français du Coran telles qu’elles permettent en Afrique aux femmes de s’affranchir du contrôle patriarcal, sur la base de l’inventivité linguistique [6] : en effet, alors que les femmes dites en état d’impureté ne peuvent, selon l’orthodoxie, ni toucher ni lire le Coran, elles ont cependant accès à tout moment à un Coran traduit, dépourvu de cette sacralité – je ne sais cependant pas si ce Coran peut être traduit par une femme. Il faut rappeler que la version Pléiade, la grande édition française de textes de l’humanité, a été pendant longtemps attribuée à D. Masson, pour ne pas écrire Denise [7].
Néanmoins ces entreprises de traduction sont admises et même encouragées par les orthodoxes dès lors que « elles doivent être comprises, non pas comme des contretypes du Message divin, mais uniquement comme des commentaires d’un très haut niveau du Livre saint. Elles sont le témoignage de l’érudition de leurs auteurs et œuvrent pour l’assimilation du message coranique, sans pour autant nier l’intangibilité du texte arabe [8]. »
L’interprétation libérale progressiste, qui établit une relation nécessaire entre modernisation et sécularisation [9], et tente de faire le lien entre des expériences religieuses très différentes, va souvent de pair avec une certaine approche de l’histoire des religions, également téléologique, qui décrirait un itinéraire d’épurement de la religion, passant d’une forte ritualisation à une spiritualisation et une intériorisation. Force est de constater cependant que ce mouvement dont la description rappelle quelquefois les « grands récits » si souvent déconstruits ne s’avère pas et que cette interprétation repose sur une compréhension limitée de la religion et des rites [10]. Il n’est donc pas évident que la « modernité » soit le synonyme d’un développement des langues vernaculaires en opposition avec la langue religieuse /classique. Outre la critique théorique que l’on peut adresser à l’interprétation libérale progressiste, elle ne résiste pas à l’épreuve des faits, et la mise en équivalence de l’adoption de la prière en langue vernaculaire et d’individus ou groupes mis au ban par l’orthodoxie musulmane ne vaut pas généralement ; certes elle vaut pour les alévis, mais pas pour les membres de l’ahmadiyya, un mouvement réformiste musulman messianiste et missionnaire, très présent en Amérique latine [11] qui, en raison même de leur persécution au Pakistan et de leur exclusion de l’islam par l’orthodoxie, tiennent à l’arabe coranique pour manifester leur appartenance à l’oumma, ou communauté de fidèles musulmans, et la rectitude de leur interprétation ; en effet ils ne sont interdits au Pakistan que s’ils se disent musulmans et il leur est défendu de lire le Coran.
Un autre exemple parmi tant d’autres serait un groupe de Kenyans [12] qui maintiennent l’arabe dans la juxtaposition de leur système de croyance – les religions traditionnelles d’un côté et l’islam de l’autre sont juxtaposés comme les deux langues ne se mêlent pas et comme dans les lieux de culte les niches des unes et de l’autre sont bien séparées. Les orthodoxes les accusent évidemment d’associationnisme, et critiquent ce qu’ils interprètent comme la rémanence de cultes préislamiques.
Aussi peut-on avancer une deuxième ligne d’interprétation sur la base de la distinction, dans l’islam, entre un universalisme représenté par le peuple de dieu – l’oumma – sans distinction de genre ou de race, et un hégémonisme arabe qui accompagne l’expansion de l’islam depuis son origine ; le fondateur des Frères musulmans, Hassan al-Banna le soutient dans ses Épîtres, attribuant entre autres aux Ottomans et à leur incapacité à comprendre le Coran en arabe la responsabilité du déclin politique des musulmans [13]. De nombreux musulmans s’insurgent contre l’« ethnicisation de l’islam [14] », et de fait c’est bien une vision plus sociale et politique de la religion, qui met en évidence l’arabité parfois ethnocentrique de la religion, si bien qu’y compris dans des courants non fréristes, adopter l’islam c’est aussi adopter un accoutrement, une nourriture, revendiquer la supériorité civilisationnelle de l’Islam avec un grand i, défendre les « causes arabes », dont en particulier les Palestiniens, même dans la période contemporaine où le panislamisme a détrôné le panarabisme [15]. Le panislamisme porte cependant des traces importantes du panarabisme. « Tout se passe comme si le sentiment de solidarité arabe était récupéré par le panislamisme. Etrange trajectoire d’un nationalisme qui s’exprime désormais par le biais d’un mouvement internationaliste par essence [16]. » En effet, le panislamisme définit un universalisme ouvert aux non arabes, mais l’arabe est un ciment fort de cette oumma, concept politique né au XXe siècle à partir d’une réalité anthropologique : « Le mot umma, étymologiquement, réfère à la mère (umm), à la tente (bayt, en hébreu olêl et en arabe ahl) de l’épouse du chef, à la maisonnée du chef, à sa famille cognatique et à sa clientèle ; par opposition à son clan agnatique, et à sa race, désignée, comme Ibn Khaldoun l’a noté, par le mot sha’b, “peuple” ; le sentiment raciste (shu’ûbiyya), l’esprit de corps (‘asabiyya) du clan désigne ce particularisme nationaliste [17]. » La constitution transnationale de l’oumma, substituée à la nation arabe, explique que le pouvoir turc, en dépit de son très fort nationalisme dit néo-ottoman [18], ne promeuve pas le turc comme langue de la prière, ce qui se pratique cependant dans quelques mosquées de la diaspora, en France et en Allemagne. En effet, d’une part l’intention de turciser le Coran – et la prière – remonte à Ataturk, et sa « Révolution linguistique » est « perçue comme antireligieuse et anti-islamique [19] » ; d’autre part, le rêve califal se superpose au rêve néo-ottoman, et exige l’arabe, d’autant qu'il a été établi que le chef de la communauté musulmane, le calife doit être un membre de la tribu de Qoreish.
En revanche, alors que le panislamisme se comprend en parallèle avec la mutation de l’identité panarabe en identité sunnite, on pourrait entendre que la résistance des chiites passe par l’affirmation du vernaculaire pour la prière, ce qui se fait quelquefois en Iran [20]. Rappelons que Salman al Farissi – Salman le Perse, qui reconnut Mahomet alors qu’il était esclave et se convertit en même temps qu’il put s’affranchir, et qui fut donc un compagnon du prophète et par ailleurs très proche de l’imam Ali – est dit avoir traduit le Coran en persan et avoir été autorisé à lire la Fatiha [21] en persan ; la légende doit bien dire quelque chose de la réalité des pratiques originelles chez les proches de l’imam Ali [22]. Pourtant on ne peut assimiler chiites et langue perse : rappelons que d’une part les chiites ne sont pas majoritairement persans, un grand nombre sont arabes, et même la ville sainte du chiisme se trouve dans ce qui est aujourd’hui l’Irak. Le conflit moderne entre chiisme et sunnisme prend son essor, non pas autour de conflits confessionnels, mais en raison des usages politiques des deux courants de l’islam, avec la création des États ottoman et safavide, et plus encore autour de la tentative d’assimilation politique moderne du chiisme et de la République islamique d’Iran [23]. La distinction de taille entre chiites et sunnites du point de vue de la prière ne concerne pas la langue de la prière, mais son organisation : les chiites retiennent trois prières quotidiennes et non pas cinq, ou plus précisément ils groupent les cinq prières en trois.
Dans la continuité de l’interprétation sociale et culturelle de la revendication de la prière en vernaculaire, il convient d’attirer l’attention sur l’opposition entre un islam populaire et un islam plus conscientisé. En effet, de nombreuses personnes des générations antérieures, au Maghreb, témoignent avoir prié intégralement en amazigh (berbère) et cela non pas par protestation contre quelque pression que ce soit, mais parce qu’elles étaient analphabètes dans toutes langues, et néanmoins pieuses. On ne peut dire que cet usage était réservé à la prière individuelle, et hors rite communautaire – la prière du vendredi en particulier, dans la mesure où l’obligation d’assister au prône du vendredi donné par un imam devenu salarié de l’État est récente : elle remonte aux années 1980, concomitante à la rénovation et construction de mosquées. Ce n’est pas l’alphabétisation – et donc une meilleure connaissance des exigences des textes religieux – qui a réduit voire interdit cette pratique, mais d’une part la situation politique de l’Algérie indépendante qui réprimait les aspirations à l’autonomie des régions kabyles et l’affirmation de leur différence culturelle passant par la langue, ainsi que la salafisation qui a introduit sa propagande et imposé un islam uniforme, soumis à un très fort contrôle social et fondé sur le takfirisme –exclusion des déviants – qui s’est diffusé à la faveur de l’électrification des lieux de culte, qui leur conférait d’autres fonctions, et de l’arrivée des haut-parleurs [24]. Aujourd’hui existent des traductions du Coran en amazigh, qui ne sont cependant guère plus accessibles, car la plupart des gens ne maîtrisent pas l’alphabet.
Quoi qu’il en soit de ce que, par ces traductions, l’islam conscientisé des prédicateurs semi-lettrés, qui s’appuient sur une vision littéraliste, a tendance à s’étendre aux pays non majoritairement musulmans, et en particulier en Amérique latine, dans la mesure où ce sont des livres wahabites qui sont massivement et gratuitement diffusés en vernaculaire, produisant une apparence d’éducation islamique qui est en réalité une propagande, qui ne laisse aucune place à la diversité de l’islam. De fait, il semble qu’ici le thème de l’intangibilité religieuse de l’arabe associée à la nécessité de l’espagnol se transforme en un bilinguisme réel permettant à ceux qui l’incarnent de mieux assimiler le message musulman historiquement constitué en arabe et de le restituer pour les masses potentielles en langue espagnole.
L’interprétation des jeux linguistiques dans le contexte musulman (language shifting) met en avant le paradigme politique, en particulier dans le cadre africain où la lutte politique contre l’islam d’État, un islam soufi porté par des élites arabophones maraboutiques peut passer par la diffusion d’un islam francophone, dit réformiste [25], ou par la destruction de leur legs ancestral – on peut citer la destruction célèbre des livres de Tombouctou. Dans ce dernier cas cependant de l’islam frériste francophone, qui peut se lire comme le dit Fabienne Samson comme une stratégie politique de conquête du pouvoir et de disqualification des élites [26], on ne touche pas à ce noyau qu’est la prière obligatoire.
Si, dans le consensus actuel, la Fatiha, qui ouvre la prière, est censée être prononcée en arabe coranique, au point que seul « le diable [peut] vous souffler l’idée de nous demander l’autorisation de faire la Fatiha en langue amazigh [27] », en réalité cette obligation a une histoire, et le débat sur la langue du Coran – débouchant sur le débat sur la langue de dieu –est en tension permanente dans la théologie musulmane. Après la défaite des mutazilites (qui ont dominé du VIIIe siècle à la fin du ixe et qui, par ailleurs, persécutèrent leurs opposants), il a été décidé théologiquement, par la victoire du sunnisme sur les mutazilites, que le Coran est incréé, sacré et intangible – le Coran non pas l’objet matériel, encore que ce soit le livre qui soit sacralisé en une vision fétichiste, de sorte que, par exemple, un non-musulman n’a pas le droit de toucher un Coran, mais la langue dans laquelle ou par laquelle il est « descendu » ; ses moindres mots sont la parole de dieu. Le débat ne fut cependant pas réglé par la défaite des mutazilites, et même à l’intérieur de la conception du Coran incréé, partagée par les chiites (un moment tenté par le mutazilisme aussi au Xe siècle) et par les quatre écoles juridiques sunnites, les débats ne manquent pas. Sur la question de la prière en vernaculaire, c’est Abu Hanafi, le fondateur de l’école hanafite (dont il faut remarquer au passage que, des quatre fondateurs d’école, il était le seul à n’être pas purement arabe, mais descendant d’un esclave perse affranchi), qui a soutenu que la prière pouvait ne pas être faite en arabe coranique, par les non arabophones comme par les arabophones [28] (et c’est lui qui raconte l’histoire de Salman le perse, compagnon du prophète et, selon la légende, premier traducteur du Coran en persan).
En effet, dans un débat théologique qui porte sur ce qui constitue le miracle du Coran, sa signification ou sa composition (en arabe), Abu Hanafi conclut que les deux relèvent du miracle, si bien qu’un non arabophone serait toujours capable de percevoir le miracle coranique dans sa propre langue, en percevant le miracle que constitue sa signification. En outre, selon son raisonnement, même un arabophone ne peut reproduire le Coran et donc identifie la dimension miraculeuse autant dans sa signification que dans sa structure ; or la signification (ma’na) peut être traduite, si la composante linguistique (nazm) ne le peut pas. Enfin, Mahomet lui-même a permis aux tribus arabes autres que celles qui maîtrisaient le dialecte Quraysh de réciter le Coran (alors non écrit) dans un ahruf (dialecte ou variante) différent, ce qui vaut par extension pour tous les peuples islamisés – mais non arabisés. Cela s’étend même au fameux « Allahu Akbar » [Dieu est grand] et à l’appel à la prière (adhan).
Un des arguments intéressants qu’il apporte en faveur de son propos est de dire que le Coran contient des traductions de textes prophétiques écrits en autre langue– des extraits de la bible hébraïque ou chrétienne par exemple, dont le caractère prophétique est indubitable. Donc l’arabe n’est pas une nécessité pour qu’un verset soit considéré comme la parole de dieu, ce qui implique par ailleurs que pour Abu Hanafi les juifs et les chrétiens n’étaient pas des falsificateurs ; à l’inverse, pour les écoles rigoristes, le prêche du vendredi est obligatoirement en arabe, et le prononcer en une autre langue est une bidaa (innovation néfaste).
Autrement dit, le choix entre le vernaculaire ou l’arabe coranique reviendrait à savoir si l’orant met l’emphase sur l’incommensurabilité de Dieu soit sur la compréhension par le sujet. Je parle d’emphase, car dans les deux cas les deux aspects sont revendiqués. Mais, par rapport à la compréhension et au fait d’assumer pleinement ce qui est dit, j’ai des cas de musulmans ayant prononcé la shahâda exclusivement en français – notons que, du reste, la shahâda n’étant pas coranique [29] ne devrait pas nécessiter d’être dite en arabe.
Pour ceux qui affirment l’obligation absolue, pour sa validité, de la prononciation en arabe de la Fatiha en premier lieu, dès lors que Dieu, dans le Coran, est dit s’exprimer dans une « langue claire [30] » qui ne l’est aucunement au sens rationnel, prononcer la prière en arabe coranique serait l’équivalent de parler en langue ou glossolalie (le fait de parler ou de comprendre une langue inconnue). Les dimensions performatives de la récitation du Coran, de sa cantillation, ont été maintes fois signalées [31] ; l’orant réactualise la « descente » du Coran sur terre ; il ne s’agit pas d’une simple récitation liturgique, mais d’un acte sacramentel. C’est à cette première interprétation que renvoient les nombreuses personnes qui prient en arabe coranique, qu’elles soient arabophones ou non arabophones. Ces personnes opposent ainsi les paroles de dieu même c’est-à-dire le Coran qu’elles disent dans la prière obligatoire avec ses propres mots, se chargeant en quelque sorte de l’énergie divine, comme quand le prêtre opérant la transsubstantiation dit « ceci est mon corps », aux invocations (doua) qu’elles disent en langue d’usage et qui expriment leurs propres demandes et pensées. La participation se fait donc mystiquement, dans la récitation comme mimésis, en termes d’arrachement à soi et sous la forme de la possession par le très haut. « En utilisant les mots de Dieu pour lui dire ce qu’elle veut, la récitante vient à coexister avec le divin par les mots exacts qui lui appartiennent [32]. »
En revanche les orants qui privilégient la prière en langue vernaculaire parlent davantage de la participation de l’homme, passant par la compréhension, qui devient la dimension la plus importante. L’individualisation du croire joue ici un rôle important [33]. La présence du vernaculaire veut dire, chez certains musulmans qui le pratiquent, une affirmation fondamentale de l’islam, à savoir qu’il n’y a pas d’intermédiaire et pas d’autorités religieuses. Ils disent donc être pleinement musulmans du fait même qu’ils privilégient leur relation avec Dieu par rapport aux prescriptions des hommes. Le code switching entre donc dans la condition complexe de la négociation des identités.
Reda Benkirane va plus loin [34]. Pour le disciple d’Iqbal, qui a écrit en anglais The Reconstruction of Religious Thought in Islam, seule la mise en acte des mots est proprement coranique, et la langue coranique ne fait sens que dans l’action et la transformation de la société et du monde. Pour lui, voir dans le Coran uniquement l'éternité et la pluralité des significations des mots et de leurs racines (« enfouies sous terre »), c'est perpétrer une adoration païenne d’une caractéristique linguistique qui précédait l'avènement de la révélation du Coran et croire, au sens animiste du terme, que les significations de cette langue suffisent à exprimer le réel. Autrement dit aujourd'hui les musulmans qui croient sacraliser la langue arabe parce qu’elle est la langue du Coran fétichisent une langue et oublient le caractère concret du Coran. En fait leur sacralisation correspond à une adoration fétiche de la lettre, oubliant la nature empirique du verbe Coranique. Loin que la récitation en arabe coranique soit une mise en acte, il se pourrait qu’elle soit une erreur théologique. Autrement dit, si la langue arabe a un statut particulier du fait qu’elle est la langue de la révélation, sa sacralisation relève d’une confusion. Plus encore, la question de la langue de la prière pose la question centrale de l’islam, à savoir l’incarnation : comment un Dieu infini, transcendant, peut-il s'adresser à un monde incarné limité. La théologie chiite fait la différence entre le Coran muet et le Coran parlant, et pendant longtemps ils ont été accusés d'avoir un autre Coran ou de ne croire que partiellement au Coran que l'on a entre les mains [35]. Quand l’Imam Ali parle, pour les chiites, il a plus de légitimité que le Coran muet ; et, d'après les récits eschatologiques, lors de la parousie de l'Imam caché, on entendra un cri du ciel, qui sera compris de tous. Si l’on transpose à notre époque, ce cri devrait être en anglais…
Quoi qu’il en soit, alors que les analyses historico-critiques prouvent que, de même que la shahâda n’est pas Coranique et que même le texte Coranique a une histoire et une rédaction postérieure à sa descente – les savants rejoignent ici les mutazilites pour dire que le texte est créé. Il en va de même des hadiths, la deuxième source de l’islam avec le Coran qui en est la première. Les hadiths, faits et gestes de Mahomet, constituent selon les interprétations soit la sunna elle-même soit une approche de la sunna entendue comme la torah orale chez les Juifs. Or c’est des hadiths qu’est tirée la codification de la prière, que le Coran se contente de recommander comme une pratique sans donner de détails sur son exécution. Donc décider du statut des hadiths par rapport à la sunna est fondamental pour réfléchir sur la prière.
Par ailleurs il ne convient pas d’isoler la langue de la prière de l’ensemble de la gestuelle et du rite [36], voire de la répétition. Au-delà du fait que, autant voire plus que la langue, sont discutées aussi la nécessité du tapis de prière, la forme du vêtement etc., il faut souligner que la parole de la prière est un rite au même titre que tout ce qui l’entoure : ablutions, prosternation, vêtements, gestes, pureté ou impureté, en fait tout est codifié, tout est imposé, et donc tout est discuté – la prescription de langue est l’une parmi tant d’autres, et il est artificiel et faux de l’isoler. Il suffit pour s’en convaincre de lire le chapitre qu’Avicenne, dans le Kitab al Isharatwa Tanbihat [37], consacre à la prière et à ses aspects à la fois sémiotiques et sémiologiques, d’abord comme gestes soumis à une codification stricte selon un modèle espace-temps bien précis. Pour Avicenne les gestes de la prière ne sont qu’une reproduction par le corps des mouvements de l’âme. Aussi l’argument d’autorité faisant du recours à une langue liturgique unificatrice une nécessité intimement liée au concept même d’Unicité et d’Universalité de Dieu perd-il tout son sens face à une sémiotique du corps, dans laquelle la prière apparaît comme un modèle archétypique préservé par une tradition mimétique « priez comme vous m’avez vu prier » et qui par conséquent vient court-circuiter toute opposition supposée entre prière en langue originale / traduction puisqu’elle constitue une sorte de canal anagogique dont la fonction serait de reconduire ainsi le sens du phonème vers sa destination finale.
Je voudrais donc questionner ceux qui arguent du fait que le sermon peut être intégralement dit dans la langue vernaculaire, disons en français, pour dire que cette pratique introduit le français comme langue rituelle. On peut le dire, dans un sens qui est évident, et qui fait du français une des nombreuses langues de l’islam, à côté de l’amazigh, du tamachek, du peul, du kurde, de l’ourdou, du swahili, du fulfulde, du turc, du farsi, etc., cela est vrai dans un sens, mais dans l’autre non : en fait cela revient à traduire dans une ontologie islamique ce qui n’en relève pas d’abord – le français qui a un contenu et une histoire non islamique (face à l’arabe coranique réputé débarrassé de tout ce qui est période des ténèbres antéislamique).
Le français, quand il est inscrit dans la ritualité et le temps islamique de la prière dont on a pu dire en analysant les hadiths qui ne sont pas une chronologie de la vie de Mahomet, mais des instants qui sortent toute la religion du temps et de l’espace, devient effectivement une langue liturgique mais il se peut que, ainsi islamisé, il perde son altérité ontologique , à la différence de ce qui se passe chez les convertis kenyans, par exemple, chez qui le code switching permet l’articulation des identités dans le cadre de la juxtaposition des religions et met en œuvre non pas du syncrétisme mais une sorte de poly-ontologie [38]. En face, la promotion de la langue d’usage (sauf pour la Fatiha, de fait) pourrait bien, dans certains cas, traduire la volonté d’islamiser ladite langue et donc de lui retirer sa capacité à être juxtaposée à l’arabe en sa faculté d’exprimer une autre ontologie.
Pour conclure, quand l’ensemble de la prière est en arabe coranique, on peut avoir affaire à un sujet clivé (le sujet clivé de la plupart des religions dans la situation de l’homme moderne [39]) : il est islamique dans la prière (où par exemple c’est la volonté de Dieu qui fait l’existence de chaque chose) et adepte d’un raisonnement scientifique dans la vie quotidienne (il admet les causes secondes). Or la mono ontologie de l’islam ne fait-elle pas que l’autre savoir devient relatif ? Peut-on aller jusqu’à dire que le code shifting (arabe dans la prière et langue d’usage hors de la prière) permet le maintien d’un clivage – esprit scientifique d’un côté, et de l’autre croyance dans le fait que Allah fait tout et décide de tout –, permettant un certain jeu et négociation des identités. Ce jeu serait au contraire suspendu par l’encadrement des douaa en vernaculaire dans un ensemble arabe coranique, qui reviendrait à opérer une sorte de traduction en arabe même du vernaculaire, non pas d’un point de vue linguistique, mais ontologique. Cet encadrement rigoureux aurait un effet actif sur la langue vernaculaire, arabisée sans l’être, et dessinerait une équivalence entre le système de la science et le système de la foi. L’intrication de la langue d’usage et de la langue coranique, revendiquée par l’islamisme, ne produit pas un syncrétisme ou concordisme, un basculement de la science dans la croyance et permet donc, en réduisant la poly-ontologie, de réaffirmer l’hégémonie ethnoreligieuse arabe.
Évidemment, cette situation ne se retrouve pas dans le choix du vernaculaire pour l’ensemble de la prière, qui pose cependant d’autres problèmes. En effet, le but d’une langue liturgique n’est pas seulement celui d’assurer une hégémonie culturelle et linguistique. Alors que, dans le cas chrétien, le latin s’est substitué à une langue originelle inexistante [40], le Coran est piégé entre les lectures absolutistes d’une part (considérant l’arabe comme une sorte de langue cosmique) et les relativistes qui considèrent la langue du Coran comme un simple support, un simple référent.
L’interprétation des jeux linguistiques dans le contexte musulman (language shifting) met en avant le paradigme politique, en particulier dans le cadre africain où la lutte politique contre l’islam d’État, un islam soufi porté par des élites arabophones maraboutiques peut passer par la diffusion d’un islam francophone, dit réformiste [25], ou par la destruction de leur legs ancestral – on peut citer la destruction célèbre des livres de Tombouctou. Dans ce dernier cas cependant de l’islam frériste francophone, qui peut se lire comme le dit Fabienne Samson comme une stratégie politique de conquête du pouvoir et de disqualification des élites [26], on ne touche pas à ce noyau qu’est la prière obligatoire.
Si, dans le consensus actuel, la Fatiha, qui ouvre la prière, est censée être prononcée en arabe coranique, au point que seul « le diable [peut] vous souffler l’idée de nous demander l’autorisation de faire la Fatiha en langue amazigh [27] », en réalité cette obligation a une histoire, et le débat sur la langue du Coran – débouchant sur le débat sur la langue de dieu –est en tension permanente dans la théologie musulmane. Après la défaite des mutazilites (qui ont dominé du VIIIe siècle à la fin du ixe et qui, par ailleurs, persécutèrent leurs opposants), il a été décidé théologiquement, par la victoire du sunnisme sur les mutazilites, que le Coran est incréé, sacré et intangible – le Coran non pas l’objet matériel, encore que ce soit le livre qui soit sacralisé en une vision fétichiste, de sorte que, par exemple, un non-musulman n’a pas le droit de toucher un Coran, mais la langue dans laquelle ou par laquelle il est « descendu » ; ses moindres mots sont la parole de dieu. Le débat ne fut cependant pas réglé par la défaite des mutazilites, et même à l’intérieur de la conception du Coran incréé, partagée par les chiites (un moment tenté par le mutazilisme aussi au Xe siècle) et par les quatre écoles juridiques sunnites, les débats ne manquent pas. Sur la question de la prière en vernaculaire, c’est Abu Hanafi, le fondateur de l’école hanafite (dont il faut remarquer au passage que, des quatre fondateurs d’école, il était le seul à n’être pas purement arabe, mais descendant d’un esclave perse affranchi), qui a soutenu que la prière pouvait ne pas être faite en arabe coranique, par les non arabophones comme par les arabophones [28] (et c’est lui qui raconte l’histoire de Salman le perse, compagnon du prophète et, selon la légende, premier traducteur du Coran en persan).
En effet, dans un débat théologique qui porte sur ce qui constitue le miracle du Coran, sa signification ou sa composition (en arabe), Abu Hanafi conclut que les deux relèvent du miracle, si bien qu’un non arabophone serait toujours capable de percevoir le miracle coranique dans sa propre langue, en percevant le miracle que constitue sa signification. En outre, selon son raisonnement, même un arabophone ne peut reproduire le Coran et donc identifie la dimension miraculeuse autant dans sa signification que dans sa structure ; or la signification (ma’na) peut être traduite, si la composante linguistique (nazm) ne le peut pas. Enfin, Mahomet lui-même a permis aux tribus arabes autres que celles qui maîtrisaient le dialecte Quraysh de réciter le Coran (alors non écrit) dans un ahruf (dialecte ou variante) différent, ce qui vaut par extension pour tous les peuples islamisés – mais non arabisés. Cela s’étend même au fameux « Allahu Akbar » [Dieu est grand] et à l’appel à la prière (adhan).
Un des arguments intéressants qu’il apporte en faveur de son propos est de dire que le Coran contient des traductions de textes prophétiques écrits en autre langue– des extraits de la bible hébraïque ou chrétienne par exemple, dont le caractère prophétique est indubitable. Donc l’arabe n’est pas une nécessité pour qu’un verset soit considéré comme la parole de dieu, ce qui implique par ailleurs que pour Abu Hanafi les juifs et les chrétiens n’étaient pas des falsificateurs ; à l’inverse, pour les écoles rigoristes, le prêche du vendredi est obligatoirement en arabe, et le prononcer en une autre langue est une bidaa (innovation néfaste).
Autrement dit, le choix entre le vernaculaire ou l’arabe coranique reviendrait à savoir si l’orant met l’emphase sur l’incommensurabilité de Dieu soit sur la compréhension par le sujet. Je parle d’emphase, car dans les deux cas les deux aspects sont revendiqués. Mais, par rapport à la compréhension et au fait d’assumer pleinement ce qui est dit, j’ai des cas de musulmans ayant prononcé la shahâda exclusivement en français – notons que, du reste, la shahâda n’étant pas coranique [29] ne devrait pas nécessiter d’être dite en arabe.
Pour ceux qui affirment l’obligation absolue, pour sa validité, de la prononciation en arabe de la Fatiha en premier lieu, dès lors que Dieu, dans le Coran, est dit s’exprimer dans une « langue claire [30] » qui ne l’est aucunement au sens rationnel, prononcer la prière en arabe coranique serait l’équivalent de parler en langue ou glossolalie (le fait de parler ou de comprendre une langue inconnue). Les dimensions performatives de la récitation du Coran, de sa cantillation, ont été maintes fois signalées [31] ; l’orant réactualise la « descente » du Coran sur terre ; il ne s’agit pas d’une simple récitation liturgique, mais d’un acte sacramentel. C’est à cette première interprétation que renvoient les nombreuses personnes qui prient en arabe coranique, qu’elles soient arabophones ou non arabophones. Ces personnes opposent ainsi les paroles de dieu même c’est-à-dire le Coran qu’elles disent dans la prière obligatoire avec ses propres mots, se chargeant en quelque sorte de l’énergie divine, comme quand le prêtre opérant la transsubstantiation dit « ceci est mon corps », aux invocations (doua) qu’elles disent en langue d’usage et qui expriment leurs propres demandes et pensées. La participation se fait donc mystiquement, dans la récitation comme mimésis, en termes d’arrachement à soi et sous la forme de la possession par le très haut. « En utilisant les mots de Dieu pour lui dire ce qu’elle veut, la récitante vient à coexister avec le divin par les mots exacts qui lui appartiennent [32]. »
En revanche les orants qui privilégient la prière en langue vernaculaire parlent davantage de la participation de l’homme, passant par la compréhension, qui devient la dimension la plus importante. L’individualisation du croire joue ici un rôle important [33]. La présence du vernaculaire veut dire, chez certains musulmans qui le pratiquent, une affirmation fondamentale de l’islam, à savoir qu’il n’y a pas d’intermédiaire et pas d’autorités religieuses. Ils disent donc être pleinement musulmans du fait même qu’ils privilégient leur relation avec Dieu par rapport aux prescriptions des hommes. Le code switching entre donc dans la condition complexe de la négociation des identités.
Reda Benkirane va plus loin [34]. Pour le disciple d’Iqbal, qui a écrit en anglais The Reconstruction of Religious Thought in Islam, seule la mise en acte des mots est proprement coranique, et la langue coranique ne fait sens que dans l’action et la transformation de la société et du monde. Pour lui, voir dans le Coran uniquement l'éternité et la pluralité des significations des mots et de leurs racines (« enfouies sous terre »), c'est perpétrer une adoration païenne d’une caractéristique linguistique qui précédait l'avènement de la révélation du Coran et croire, au sens animiste du terme, que les significations de cette langue suffisent à exprimer le réel. Autrement dit aujourd'hui les musulmans qui croient sacraliser la langue arabe parce qu’elle est la langue du Coran fétichisent une langue et oublient le caractère concret du Coran. En fait leur sacralisation correspond à une adoration fétiche de la lettre, oubliant la nature empirique du verbe Coranique. Loin que la récitation en arabe coranique soit une mise en acte, il se pourrait qu’elle soit une erreur théologique. Autrement dit, si la langue arabe a un statut particulier du fait qu’elle est la langue de la révélation, sa sacralisation relève d’une confusion. Plus encore, la question de la langue de la prière pose la question centrale de l’islam, à savoir l’incarnation : comment un Dieu infini, transcendant, peut-il s'adresser à un monde incarné limité. La théologie chiite fait la différence entre le Coran muet et le Coran parlant, et pendant longtemps ils ont été accusés d'avoir un autre Coran ou de ne croire que partiellement au Coran que l'on a entre les mains [35]. Quand l’Imam Ali parle, pour les chiites, il a plus de légitimité que le Coran muet ; et, d'après les récits eschatologiques, lors de la parousie de l'Imam caché, on entendra un cri du ciel, qui sera compris de tous. Si l’on transpose à notre époque, ce cri devrait être en anglais…
Quoi qu’il en soit, alors que les analyses historico-critiques prouvent que, de même que la shahâda n’est pas Coranique et que même le texte Coranique a une histoire et une rédaction postérieure à sa descente – les savants rejoignent ici les mutazilites pour dire que le texte est créé. Il en va de même des hadiths, la deuxième source de l’islam avec le Coran qui en est la première. Les hadiths, faits et gestes de Mahomet, constituent selon les interprétations soit la sunna elle-même soit une approche de la sunna entendue comme la torah orale chez les Juifs. Or c’est des hadiths qu’est tirée la codification de la prière, que le Coran se contente de recommander comme une pratique sans donner de détails sur son exécution. Donc décider du statut des hadiths par rapport à la sunna est fondamental pour réfléchir sur la prière.
Par ailleurs il ne convient pas d’isoler la langue de la prière de l’ensemble de la gestuelle et du rite [36], voire de la répétition. Au-delà du fait que, autant voire plus que la langue, sont discutées aussi la nécessité du tapis de prière, la forme du vêtement etc., il faut souligner que la parole de la prière est un rite au même titre que tout ce qui l’entoure : ablutions, prosternation, vêtements, gestes, pureté ou impureté, en fait tout est codifié, tout est imposé, et donc tout est discuté – la prescription de langue est l’une parmi tant d’autres, et il est artificiel et faux de l’isoler. Il suffit pour s’en convaincre de lire le chapitre qu’Avicenne, dans le Kitab al Isharatwa Tanbihat [37], consacre à la prière et à ses aspects à la fois sémiotiques et sémiologiques, d’abord comme gestes soumis à une codification stricte selon un modèle espace-temps bien précis. Pour Avicenne les gestes de la prière ne sont qu’une reproduction par le corps des mouvements de l’âme. Aussi l’argument d’autorité faisant du recours à une langue liturgique unificatrice une nécessité intimement liée au concept même d’Unicité et d’Universalité de Dieu perd-il tout son sens face à une sémiotique du corps, dans laquelle la prière apparaît comme un modèle archétypique préservé par une tradition mimétique « priez comme vous m’avez vu prier » et qui par conséquent vient court-circuiter toute opposition supposée entre prière en langue originale / traduction puisqu’elle constitue une sorte de canal anagogique dont la fonction serait de reconduire ainsi le sens du phonème vers sa destination finale.
Je voudrais donc questionner ceux qui arguent du fait que le sermon peut être intégralement dit dans la langue vernaculaire, disons en français, pour dire que cette pratique introduit le français comme langue rituelle. On peut le dire, dans un sens qui est évident, et qui fait du français une des nombreuses langues de l’islam, à côté de l’amazigh, du tamachek, du peul, du kurde, de l’ourdou, du swahili, du fulfulde, du turc, du farsi, etc., cela est vrai dans un sens, mais dans l’autre non : en fait cela revient à traduire dans une ontologie islamique ce qui n’en relève pas d’abord – le français qui a un contenu et une histoire non islamique (face à l’arabe coranique réputé débarrassé de tout ce qui est période des ténèbres antéislamique).
Le français, quand il est inscrit dans la ritualité et le temps islamique de la prière dont on a pu dire en analysant les hadiths qui ne sont pas une chronologie de la vie de Mahomet, mais des instants qui sortent toute la religion du temps et de l’espace, devient effectivement une langue liturgique mais il se peut que, ainsi islamisé, il perde son altérité ontologique , à la différence de ce qui se passe chez les convertis kenyans, par exemple, chez qui le code switching permet l’articulation des identités dans le cadre de la juxtaposition des religions et met en œuvre non pas du syncrétisme mais une sorte de poly-ontologie [38]. En face, la promotion de la langue d’usage (sauf pour la Fatiha, de fait) pourrait bien, dans certains cas, traduire la volonté d’islamiser ladite langue et donc de lui retirer sa capacité à être juxtaposée à l’arabe en sa faculté d’exprimer une autre ontologie.
Pour conclure, quand l’ensemble de la prière est en arabe coranique, on peut avoir affaire à un sujet clivé (le sujet clivé de la plupart des religions dans la situation de l’homme moderne [39]) : il est islamique dans la prière (où par exemple c’est la volonté de Dieu qui fait l’existence de chaque chose) et adepte d’un raisonnement scientifique dans la vie quotidienne (il admet les causes secondes). Or la mono ontologie de l’islam ne fait-elle pas que l’autre savoir devient relatif ? Peut-on aller jusqu’à dire que le code shifting (arabe dans la prière et langue d’usage hors de la prière) permet le maintien d’un clivage – esprit scientifique d’un côté, et de l’autre croyance dans le fait que Allah fait tout et décide de tout –, permettant un certain jeu et négociation des identités. Ce jeu serait au contraire suspendu par l’encadrement des douaa en vernaculaire dans un ensemble arabe coranique, qui reviendrait à opérer une sorte de traduction en arabe même du vernaculaire, non pas d’un point de vue linguistique, mais ontologique. Cet encadrement rigoureux aurait un effet actif sur la langue vernaculaire, arabisée sans l’être, et dessinerait une équivalence entre le système de la science et le système de la foi. L’intrication de la langue d’usage et de la langue coranique, revendiquée par l’islamisme, ne produit pas un syncrétisme ou concordisme, un basculement de la science dans la croyance et permet donc, en réduisant la poly-ontologie, de réaffirmer l’hégémonie ethnoreligieuse arabe.
Évidemment, cette situation ne se retrouve pas dans le choix du vernaculaire pour l’ensemble de la prière, qui pose cependant d’autres problèmes. En effet, le but d’une langue liturgique n’est pas seulement celui d’assurer une hégémonie culturelle et linguistique. Alors que, dans le cas chrétien, le latin s’est substitué à une langue originelle inexistante [40], le Coran est piégé entre les lectures absolutistes d’une part (considérant l’arabe comme une sorte de langue cosmique) et les relativistes qui considèrent la langue du Coran comme un simple support, un simple référent.
___________
[1] Il convient de citer un numéro de revue dirigé par Catherine Milleret Nilufar Haeri, « Langues, religion et modernité dans l'espace musulman », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 124, novembre 2008, https://journals.openedition.org/remmm/5997
[2] Umut Azak, « Secularism in Turkey as a NationalistSearch for Vernacular Islam », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 124, novembre 2008, consulté le 26 septembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/remmm/6025
[3] https://londonqueermuslims.com/
[4] Mahmoud Hussein, « Le Coran, entre texte et contexte », Courrier de l’UNESCO, avril-juin 2017, https://fr.unesco.org/courier/avril-juin-2017/Coran-texte-contexte
[5] Thierry Zarcone, « La confrontation Sunnites-Alevis en Turquie : l’impossible reconnaissance », Confluences Méditerranée, vol. 105, no. 2, 2018, p. 47-63.
[6] Voir le dossier « Religiosités musulmanes dans le monde francophone », dir. Claude Prudhomme, Histoire, monde et cultures religieuses 2015/4 (n° 36).
[7] Voir la discussion sur l’emploi de D. dans le compte rendu par Félix Arin, Le Coran, traduction de Denise Masson, Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°3, 1967. p. 199-202. www.persee.fr/doc/remmm_0035-1474_1967_num_3_1_951
[8] Jean-Claude Penrad, « L’intangible et la nécessité »,Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 124, novembre 2008, consulté le 25 septembre 2018. URL :http://journals.openedition.org/remmm/6008
[9] Joshua Fishman, « A decalogue of basic theoretical perspectives for a sociology of language and religion », T. Omoniyi et J. Fishman (éds.), Explorations in the Sociology of Language and Religion, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, 2006 : 13-25.
[10] Voir Philippe Borgeaud, Exercices d’histoire des religions : Comparaisons, rites, mythes et émotions, Leyde : Brill, 2016.
[11] Asif Arif, L'Ahmadiyya : un islam interdit, Paris : L’harmattan, 2014
[12] VoirJanet McIntosh, The Edge of Islam : Power, Personhood and Ethno-Religious Boundaries on the Kenya Coast, Durham-London : Duke University Press, 2009.
[13] Voir Paul Brykczynski, « Radical Islam and the Nation : The Relationship between Nationalism and Islam in the Political Thought of Hassan al-Banna and Sayyid Qutb », History of Intellectual Culture 5 (1) 2005 : 1-19.
[14] Denis Matringe, Un islam non arabe. Horizons indiens et pakistanais, Paris : Téraèdre/IISM-EHESS, 2005.
[15] Lequel, assurément, était teinté d’islamisme, comme le démontre Olivier Carré, Mystique et politique : lecture révolutionnaire du Coran par Sayyid Qutb, frère musulman radical, Paris, Presses de Sciences Po/Éd. du Cerf, 1984
[16] Olivier Roy, « L’islamisme, nouveau panarabisme », in Les Enjeux 2006, Alternatives internationales, en partenariat avec le CERI, Hors-Série, 3, décembre 2006.
[17] Louis Massignon, « L’Umma et ses synonymes » [1946], in Opera Minora, Beyrouth, Dar al-Maaref, 1963, vol. 1, p. 97-103
[18] Voir Dorothée Schmid, « Turquie : du kémalisme au néo-ottomanisme », Questions internationales (janvier/février 2017) ; et Bayram Balci, « La nouvelle Turquie d’Erdoğan, entre islamisme et nationalisme », in Alain Dieckhoff et Philippe Portier (dir.), L'Enjeu mondial. Religion et politique, Presses de Sciences Po, 2017, p. 141-151.,
[19] Johann Strauss, « Modernisation, nationalisation, désislamisation », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 124, novembre 2008, consulté le 26 septembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/remmm/6024
[20] https://www.youtube.com/watch?v=ONupah3mW_0
[21] La Fatiha est la sourate d'ouverture du Coran ; elle est récitée au début de la salat (prière) par l’orant debout après qu’il s’est orienté vers la Mecque. Elle est récitée au début de chaque unité (rak'ah ) de prière, donc récitée théoriquement 17 fois par jour par un pratiquant.
[22] Voir la discussion dans Travis Zadeh, « The Fātiḥa of Salmān al-Fārisī and the Modern Controversy over Translating the Qurʾān », in The Meaning of the Word : Lexicology and Tafsir, éd. Stephen Burge (Oxford : Institute of Ismaili Studies/Oxford University Press, 2015), p. 375-420
[23] Laurence Louër, Sunnites et chiites. Histoire politique d'une discorde (Paris : Seuil, 2017).
[24] Voir Kamel Chachoua, L’Islam kabyle, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001.
[25] Voir Rachid Id Yassine, « Les musulmans francophones : des religiosités indécises ? », Histoire, monde et cultures religieuses, vol. 36, no. 4, 2015, p. 7-14 ; Marie Miran, Islam, -histoire-et-modernité en Côte d’Ivoire, Paris : Karthala, 2006, et CIMEF (Colloque international des musulmans de l’espace francophone), Les Musulmans francophones. Réflexions sur la compréhension, la terminologie, le discours, Lyon : Tawhid, 2001.
[26] Fabienne Samson, « Introduction : La question des classifications en islam », in « L’islam, au-delà des catégories », numéro spécial n°206-207, Les Cahiers d’études Africaines, 2012.
[27] Kamel Chachoua, « Le piège : Kabyle de langue, Arabe de religion », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 124, novembre 2008, consulté le 26 septembre 2018.URL : http://journals.openedition.org/remmm/6028
[28] Voir Travis Zadeh, The Vernacular Qu’ran : Translation and the Rise of Persian Exegesis, Oxford : Oxford University Press, 2012.
[29] Sur l’histoire de la profession de foi, voir Frédéric Imbert, « L’Islam des pierres : l’expression de la foi dans les graffiti arabes des premiers siècles », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 129, juillet 2011, http://journals.openedition.org/remmm/7067
[30] Sourate 26, v. 192-195 : « Ce (Coran) ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, "193 - et l'Esprit fidèle est descendu avec cela" "194 - sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs,""195 - en une langue arabe très claire ».
[31] Thomas Hoffmann, The Poetic Qurʾān. Studies on QurʾānicPoeticity, Wiesbaden :Harrassowitz, 2007
[32] Niloofar Haeri, « The Private Performance of “Salat” Prayers : Repetition, Time, and Meaning », Anthropological Quarterly, 86(1) 2013, 5-34.
[33] Voir Danièle Hervieu-Léger, « Le partage du croire religieux dans des sociétés d'individus », L'Année sociologique, vol. vol. 60, no. 1, 2010, p. 41-62.
[34] Réda Benkirane, Islam, à la reconquête du sens, Paris : Le Pommier, 2017. Je lis ici le dernier chapitre.
[35] Voir Mohammad Ali Amir-Moezzi, Le Coran silencieux et le Coran parlant. Sources scripturaires de l’islam entre histoire et ferveur, Paris : CNRS Éditions 2011
[36] Marie-Laure Boursin, « À l’heure de la prière : entre pratiques et expérimentations », Ethnologie française, vol. 168, no. 4, 2017, p. 623-636.
[37] Ibn Sina (Avicenne), Livre des directives et remarques (Kitâb al-Isharatwa-l-tanbihat), traduit par Amélie-Marie Goichon, Paris : Vrin, 1951
[38] Janet McIntosh, The Edge of Islam, op. cit., p. 213.
[39] Pierre Gisel, éd., Les Constellations du croire. Dispositifs hérités, problématisations, destin contemporain. Genève : Éditions Labor et Fides, 2009, p. 24.
[40] Je n’ai pas eu accès au chapitre 3 du volume dirigé par Mordechai Z. Cohen et Adele Berlin, Scriptures in Judaism, Christianity and Islam : Overlapping Inquiries (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), où Meir M. Bar-Asher discute du droit à traduire les Écritures en islam (p. 65 sqq.)
[1] Il convient de citer un numéro de revue dirigé par Catherine Milleret Nilufar Haeri, « Langues, religion et modernité dans l'espace musulman », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 124, novembre 2008, https://journals.openedition.org/remmm/5997
[2] Umut Azak, « Secularism in Turkey as a NationalistSearch for Vernacular Islam », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 124, novembre 2008, consulté le 26 septembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/remmm/6025
[3] https://londonqueermuslims.com/
[4] Mahmoud Hussein, « Le Coran, entre texte et contexte », Courrier de l’UNESCO, avril-juin 2017, https://fr.unesco.org/courier/avril-juin-2017/Coran-texte-contexte
[5] Thierry Zarcone, « La confrontation Sunnites-Alevis en Turquie : l’impossible reconnaissance », Confluences Méditerranée, vol. 105, no. 2, 2018, p. 47-63.
[6] Voir le dossier « Religiosités musulmanes dans le monde francophone », dir. Claude Prudhomme, Histoire, monde et cultures religieuses 2015/4 (n° 36).
[7] Voir la discussion sur l’emploi de D. dans le compte rendu par Félix Arin, Le Coran, traduction de Denise Masson, Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°3, 1967. p. 199-202. www.persee.fr/doc/remmm_0035-1474_1967_num_3_1_951
[8] Jean-Claude Penrad, « L’intangible et la nécessité »,Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 124, novembre 2008, consulté le 25 septembre 2018. URL :http://journals.openedition.org/remmm/6008
[9] Joshua Fishman, « A decalogue of basic theoretical perspectives for a sociology of language and religion », T. Omoniyi et J. Fishman (éds.), Explorations in the Sociology of Language and Religion, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, 2006 : 13-25.
[10] Voir Philippe Borgeaud, Exercices d’histoire des religions : Comparaisons, rites, mythes et émotions, Leyde : Brill, 2016.
[11] Asif Arif, L'Ahmadiyya : un islam interdit, Paris : L’harmattan, 2014
[12] VoirJanet McIntosh, The Edge of Islam : Power, Personhood and Ethno-Religious Boundaries on the Kenya Coast, Durham-London : Duke University Press, 2009.
[13] Voir Paul Brykczynski, « Radical Islam and the Nation : The Relationship between Nationalism and Islam in the Political Thought of Hassan al-Banna and Sayyid Qutb », History of Intellectual Culture 5 (1) 2005 : 1-19.
[14] Denis Matringe, Un islam non arabe. Horizons indiens et pakistanais, Paris : Téraèdre/IISM-EHESS, 2005.
[15] Lequel, assurément, était teinté d’islamisme, comme le démontre Olivier Carré, Mystique et politique : lecture révolutionnaire du Coran par Sayyid Qutb, frère musulman radical, Paris, Presses de Sciences Po/Éd. du Cerf, 1984
[16] Olivier Roy, « L’islamisme, nouveau panarabisme », in Les Enjeux 2006, Alternatives internationales, en partenariat avec le CERI, Hors-Série, 3, décembre 2006.
[17] Louis Massignon, « L’Umma et ses synonymes » [1946], in Opera Minora, Beyrouth, Dar al-Maaref, 1963, vol. 1, p. 97-103
[18] Voir Dorothée Schmid, « Turquie : du kémalisme au néo-ottomanisme », Questions internationales (janvier/février 2017) ; et Bayram Balci, « La nouvelle Turquie d’Erdoğan, entre islamisme et nationalisme », in Alain Dieckhoff et Philippe Portier (dir.), L'Enjeu mondial. Religion et politique, Presses de Sciences Po, 2017, p. 141-151.,
[19] Johann Strauss, « Modernisation, nationalisation, désislamisation », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 124, novembre 2008, consulté le 26 septembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/remmm/6024
[20] https://www.youtube.com/watch?v=ONupah3mW_0
[21] La Fatiha est la sourate d'ouverture du Coran ; elle est récitée au début de la salat (prière) par l’orant debout après qu’il s’est orienté vers la Mecque. Elle est récitée au début de chaque unité (rak'ah ) de prière, donc récitée théoriquement 17 fois par jour par un pratiquant.
[22] Voir la discussion dans Travis Zadeh, « The Fātiḥa of Salmān al-Fārisī and the Modern Controversy over Translating the Qurʾān », in The Meaning of the Word : Lexicology and Tafsir, éd. Stephen Burge (Oxford : Institute of Ismaili Studies/Oxford University Press, 2015), p. 375-420
[23] Laurence Louër, Sunnites et chiites. Histoire politique d'une discorde (Paris : Seuil, 2017).
[24] Voir Kamel Chachoua, L’Islam kabyle, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001.
[25] Voir Rachid Id Yassine, « Les musulmans francophones : des religiosités indécises ? », Histoire, monde et cultures religieuses, vol. 36, no. 4, 2015, p. 7-14 ; Marie Miran, Islam, -histoire-et-modernité en Côte d’Ivoire, Paris : Karthala, 2006, et CIMEF (Colloque international des musulmans de l’espace francophone), Les Musulmans francophones. Réflexions sur la compréhension, la terminologie, le discours, Lyon : Tawhid, 2001.
[26] Fabienne Samson, « Introduction : La question des classifications en islam », in « L’islam, au-delà des catégories », numéro spécial n°206-207, Les Cahiers d’études Africaines, 2012.
[27] Kamel Chachoua, « Le piège : Kabyle de langue, Arabe de religion », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 124, novembre 2008, consulté le 26 septembre 2018.URL : http://journals.openedition.org/remmm/6028
[28] Voir Travis Zadeh, The Vernacular Qu’ran : Translation and the Rise of Persian Exegesis, Oxford : Oxford University Press, 2012.
[29] Sur l’histoire de la profession de foi, voir Frédéric Imbert, « L’Islam des pierres : l’expression de la foi dans les graffiti arabes des premiers siècles », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 129, juillet 2011, http://journals.openedition.org/remmm/7067
[30] Sourate 26, v. 192-195 : « Ce (Coran) ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, "193 - et l'Esprit fidèle est descendu avec cela" "194 - sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs,""195 - en une langue arabe très claire ».
[31] Thomas Hoffmann, The Poetic Qurʾān. Studies on QurʾānicPoeticity, Wiesbaden :Harrassowitz, 2007
[32] Niloofar Haeri, « The Private Performance of “Salat” Prayers : Repetition, Time, and Meaning », Anthropological Quarterly, 86(1) 2013, 5-34.
[33] Voir Danièle Hervieu-Léger, « Le partage du croire religieux dans des sociétés d'individus », L'Année sociologique, vol. vol. 60, no. 1, 2010, p. 41-62.
[34] Réda Benkirane, Islam, à la reconquête du sens, Paris : Le Pommier, 2017. Je lis ici le dernier chapitre.
[35] Voir Mohammad Ali Amir-Moezzi, Le Coran silencieux et le Coran parlant. Sources scripturaires de l’islam entre histoire et ferveur, Paris : CNRS Éditions 2011
[36] Marie-Laure Boursin, « À l’heure de la prière : entre pratiques et expérimentations », Ethnologie française, vol. 168, no. 4, 2017, p. 623-636.
[37] Ibn Sina (Avicenne), Livre des directives et remarques (Kitâb al-Isharatwa-l-tanbihat), traduit par Amélie-Marie Goichon, Paris : Vrin, 1951
[38] Janet McIntosh, The Edge of Islam, op. cit., p. 213.
[39] Pierre Gisel, éd., Les Constellations du croire. Dispositifs hérités, problématisations, destin contemporain. Genève : Éditions Labor et Fides, 2009, p. 24.
[40] Je n’ai pas eu accès au chapitre 3 du volume dirigé par Mordechai Z. Cohen et Adele Berlin, Scriptures in Judaism, Christianity and Islam : Overlapping Inquiries (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), où Meir M. Bar-Asher discute du droit à traduire les Écritures en islam (p. 65 sqq.)