Dates : du 17 au 20 juin 2026
Langues : français, arabe et anglais
Lieu : Tunis, Tunisie (en présentiel uniquement)
Contact : conference-islamophobia-tunis@protonmail.com
Coordination générale
Iman EL FEKI, SAGE, CNRS/Université de Strasbourg, elfekiiman@gmail.com
Adrien THIBAULT, IRMC Tunis, CNRS/MEAE, adrien.thibault@irmcmaghreb.org
Calendrier
- 15 octobre 2025 : ouverture de l’appel à communications ;
- 1er décembre 2025 : date limite pour l’envoi des propositions de communication à l’adresse conference-islamophobia-tunis@protonmail.com ;
- Début janvier 2026 : annonce des communications retenues par le comité scientifique ;
- 20 mai 2026 : date limite pour l’envoi des textes supports des interventions (20 minutes).
Argumentaire
Le concept d’islamophobie a aujourd’hui plus d’un siècle et a connu une institutionnalisation croissante en Europe depuis la parution du rapport britannique du Runnymede Trust (Conway, 1997). Il est désormais reconnu par diverses organisations internationales ayant leur siège sur le continent européen (telles que le Conseil de l’Europe et l’UNESCO), employé par diverses institutions nationales (telles que la Commission des lois de l’Assemblée nationale française1, la Commission fédérale suisse contre le racisme2 ou la Chambre des communes britannique3), a intégré les dictionnaires (tels que le Collins, l’OED, le Larousse, le Diccionario de la lengua española…) et s’est imposé dans les études sur le racisme, les discriminations et les politiques de sécurité en Europe. Force est toutefois de constater, d’une part, qu’il reste davantage discuté dans les espaces académiques anglophones que dans les espaces académiques francophones et a fortiori français (même si les travaux se multiplient depuis une vingtaine d’années et la parution de La nouvelle islamophobie en 2003) et, d’autre part, qu’il est particulièrement peu discuté au Maghreb, alors qu’il entretient avec cette région du monde des liens étroits et pluriels.
Ce colloque international voudrait contribuer à combler cette double lacune en réunissant à Tunis des chercheur·es en sciences sociales de toutes disciplines ou de tout champ de recherche pluridisciplinaire, de toute nationalité et de tout statut, mobilisant, discutant, étudiant ou croisant dans leurs recherches le concept d’islamophobie ou des notions connexes (haine, hostilité, discrimination ou racisme anti musulmans, anti-islamique, anti-arabes, anti-maghrébin·es, etc.) depuis une ou plusieurs perspectives maghrébines, afin d’en montrer/interroger la pertinence scientifique, la spécificité éventuelle, les origines, les contextes d’usage et les articulations. À cette fin, il propose de prendre pour point de départ et pour objet de discussion transversale la définition qu’en donnent Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed dans leur ouvrage de référence sur le sujet (2013, p. 20) :
Ce colloque international voudrait contribuer à combler cette double lacune en réunissant à Tunis des chercheur·es en sciences sociales de toutes disciplines ou de tout champ de recherche pluridisciplinaire, de toute nationalité et de tout statut, mobilisant, discutant, étudiant ou croisant dans leurs recherches le concept d’islamophobie ou des notions connexes (haine, hostilité, discrimination ou racisme anti musulmans, anti-islamique, anti-arabes, anti-maghrébin·es, etc.) depuis une ou plusieurs perspectives maghrébines, afin d’en montrer/interroger la pertinence scientifique, la spécificité éventuelle, les origines, les contextes d’usage et les articulations. À cette fin, il propose de prendre pour point de départ et pour objet de discussion transversale la définition qu’en donnent Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed dans leur ouvrage de référence sur le sujet (2013, p. 20) :
« l’islamophobie correspond au processus social complexe de racialisation/altérisation, appuyé sur le signe de l’appartenance (réelle ou supposée) à la religion musulmane, dont les modalités sont variables en fonction des contextes nationaux et des périodes historiques. Il s’agit d’un phénomène global et “genré” parce qu’influencé par la circulation internationale des idées et des personnes et par les rapports sociaux de sexe. »
De même que cette définition, le colloque international invite à développer les analyses à partir de différentes périodes historiques (coloniale ou postcoloniale), différents contextes nationaux (pays du Maghreb ou d’Europe), différents types de circulations internationales (des concepts, des discours, des politiques, des pratiques institutionnelles ou des personnes) et à l’intersection de différents rapports sociaux (race, genre, mais aussi classe, nationalité, âge, sexualité…). Les propositions de communications pourront être individuelles ou collectives et fonder leur propos sur un matériau empirique maghrébin, européen ou les deux.
Elles devront répondre à un ou plusieurs des six axes suivants :
1. Socio-histoire maghrébine du concept d’islamophobie
2. De l’islamophobie au Maghreb colonial et dans la métropole ?
3. La coproduction postcoloniale des idées islamophobes entre le Maghreb et l’Europe
4. Les effets de l’islamophobie contemporaine sur la circulation des personnes vers/depuis le Maghreb
5. (La lutte contre) L’islamophobie en Europe au prisme de l’immigration maghrébine postcoloniale
6. De l’islamophobie au Maghreb ? Réflexions sur la transposabilité du concept aux sociétés à majorité musulmane
3. La coproduction postcoloniale des idées islamophobes entre le Maghreb et l’Europe
4. Les effets de l’islamophobie contemporaine sur la circulation des personnes vers/depuis le Maghreb
5. (La lutte contre) L’islamophobie en Europe au prisme de l’immigration maghrébine postcoloniale
6. De l’islamophobie au Maghreb ? Réflexions sur la transposabilité du concept aux sociétés à majorité musulmane

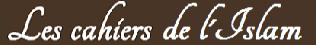



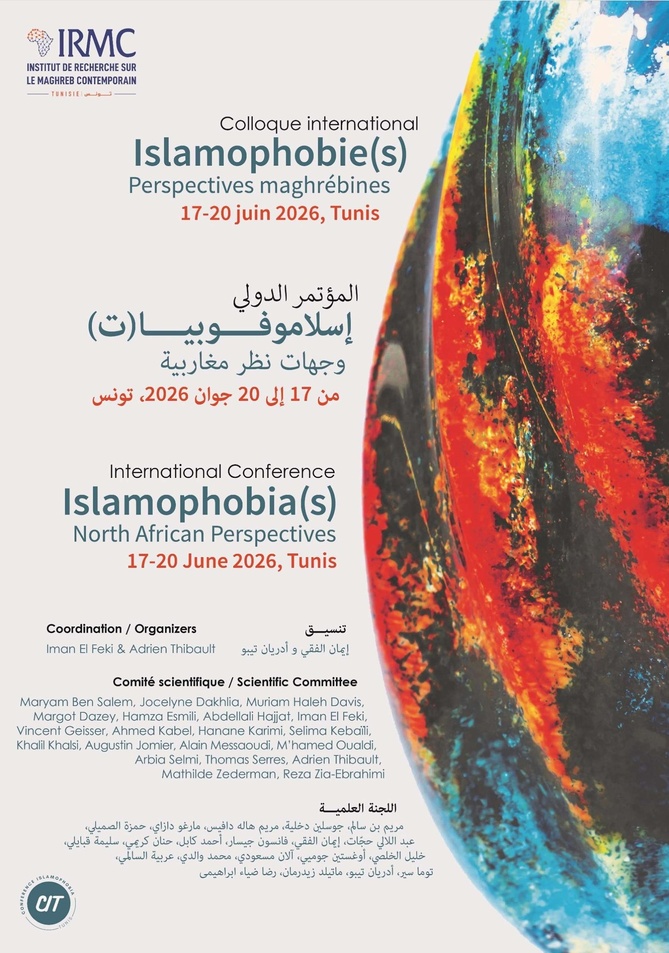










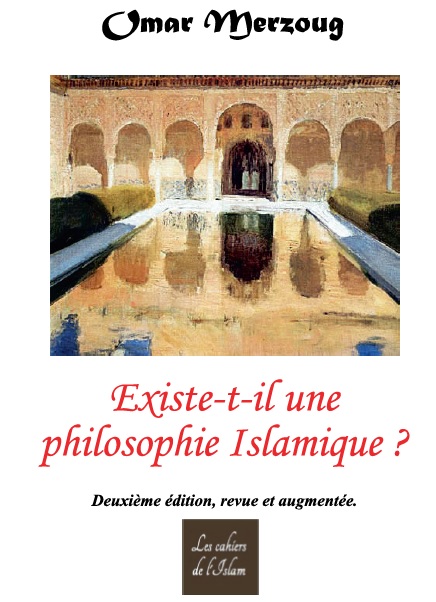



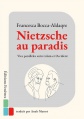








![La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane [Extrait] La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane [Extrait]](https://www.lescahiersdelislam.fr/photo/art/imagette_16_9/87789924-62224472.jpg?v=1746139916)









