Ce texte rédigé par Ahmed Moatassime est tiré de la revue Tiers-Monde, l'Islam et son actualité pour le Tiers-Monde sous la direction d'Ahmed Moatassime (Volume 23 Numéro 92 pp. 795-817) publié sur Persée.fr sous licence creative commons. Il s'agit ici de la première partie. La seconde partie peut-être lue ici.
Bien que ce texte soit déjà assez ancien (1982), nous avons considéré qu'il s'agissait d'une bonne introduction aux fondements juridiques Musulmans (Usul al Fiqh) eux mêmes utilisés dans le cadre des systèmes politiques musulmans.
Ahmed Moatassime est universitaire, chercheur au CNRS et professeur à l’Institut d’Études du Développement Économique et Social à Paris.
Ancien disciple de Jacques Berque qu’il a rencontré pour la première fois en 1964 au Collège de France il est l’auteur de plusieurs ouvrages.
Bien que ce texte soit déjà assez ancien (1982), nous avons considéré qu'il s'agissait d'une bonne introduction aux fondements juridiques Musulmans (Usul al Fiqh) eux mêmes utilisés dans le cadre des systèmes politiques musulmans.
Ahmed Moatassime est universitaire, chercheur au CNRS et professeur à l’Institut d’Études du Développement Économique et Social à Paris.
Ancien disciple de Jacques Berque qu’il a rencontré pour la première fois en 1964 au Collège de France il est l’auteur de plusieurs ouvrages.

Ce rappel historique et contemporain ne s'adresse pas aux spécialistes. Ils n'y trouveront probablement rien de ce qu'ils ne savent déjà. Il se destine avant tout aux lecteurs non islamisants : chercheurs, enseignants, étudiants ou autres. Parmi eux tous ceux qui s'intéressent plus particulièrement au Tiers Monde mais qui ne s'estiment pas assez informés de la dynamique sociologique propre à ces sociétés, notamment dans les pays musulmans. Il ne se passe plus un débat international sur le développement, ni une rencontre universitaire, ni enfin un stage de coopérants sans que la sphère islamique ne soit évoquée, ce qui est très significatif. Néanmoins nous nous sommes aperçu que certains ne connaissent paradoxalement l'Islam que par quelques bribes de son aspect « religieux » : faire la prière en tournant cinq fois par jour la face vers La Mecque, pratiquer le jeûne au mois du Ramadan et, éventuellement, s'abstenir d'absorber des boissons fermentées. Exigences rituelles que n'observent guère tous les Musulmans. Mais ceux-ci ne renoncent pas, pour autant, à leur islamité dont les fondements spirituels, rappelons-le, transcendent les rites. Il est en revanche un aspect qui, consciemment ou non, reste mal perçu. Pourtant, il consacre un deuxième versant du Message islamique, et non des moindres, à savoir sa dynamique temporelle. En l'occurrence, sa fonction politique qui a joué et joue encore un rôle historique et social déterminant. On ne comprendra rien à l'actualité musulmane si ce phénomène central de l'expression islamique est réduit à des épithètes péjoratives comme « fanatisme » ou « extrémisme », « obscurantisme » ou même « intégrisme ». Aussi les changements et remises en cause politiques au nom de l'Islam, dans le monde musulman contemporain, paraissent-ils surprendre. En fait, pour quiconque ayant suivi l'évolution de l'histoire islamique depuis ses origines, un tel phénomène n'a rien d'exceptionnel. Au contraire, il confirme une attitude fondamentale de l'Islam face à la politique depuis sa naissance.
Mohammed, le premier, en a fait la condition sine qua non de son dessein spirituel et social. Les schismes dans l'Islam n'ont jamais eu de divergences dogmatiques, mais bien politiques : c'est sur la nature du pouvoir que l'Islam s'est divisé dès le vne siècle en « sunnites » (caractère électif ou collégial) et « chiites » (caractère héréditaire ou personnel). La renaissance arabo-islamique depuis la fin du xixe siècle comme tous les mouvements de résistance à la domination coloniale se sont déterminés par et dans le cadre de l'Islam, bien qu'ils aient emprunté aux idéologies libérales et /ou marxistes leurs moyens d'action. Cette dynamique sociale paraît d'autant plus intéressante à observer qu'elle élimine à la longue la poignée de « Religieux » ayant servi de tremplin initial à un soulèvement populaire. Les exemples sont si nombreux que seule une étude globale est en mesure d'élucider. Non seulement en vue de tirer la leçon du passé, mais aussi et surtout pour mieux comprendre l'actualité et se projeter sur l'avenir. Tant il est vrai que l'Islam est impliqué chaque jour, culturellement et politiquement, dans la lutte pour le développement économique et social.
Il n'est évidemment pas possible, dans une étude limitée, d'envisager une analyse exhaustive. Mais nous nous arrêterons plus particulièrement à cette dialectique permanente entre « légitimité islamique » et « légalité étatique ». Dialectique qui, à travers le temps et l'espace, paraît avoir donné aux ruptures révolutionnaires en Islam une fonction régulatrice. D'autant que les prolongements actuels semblent vouloir reproduire, malgré la nouvelle version planétaire, la même dynamique.
I. — LÉGITIMITÉ ISLAMIQUE
Elle se fonde généralement sur un triptyque allant d'un choix institutionnel fondamental à une méthodologie juridique aux sources multiples, en passant par une recherche intellectuelle en perpétuel mouvement.
a) Un choix institutionnel fondé sur la nature du pouvoir
Ce choix remonte à un événement historique d'importance capitale pour l'Islam, qui eut pour origine le problème posé par le pouvoir après la mort du Prophète Mohammed en 632. Celui-ci n'a désigné aucun successeur de son vivant, comme pour laisser aux Musulmans le soin de régler eux-mêmes la question de leur propre gouvernement. Aussi pendant un quart de siècle environ, des élections locales improvisées ont-elles porté successivement à la tête de l'Etat musulman, en pleine expansion, les quatre premiers Califes (proches compagnons du Prophète) dit « orthodoxes » ou « rachidoun » (bien dirigés) : Abou-Bakr, Omar, Othman, enfin Ali, gendre du Prophète, époux de sa fille, Fatima.
Mais, en 657, l'élection du quatrième Calife, Ali, fut vigoureusement contestée par Aïcha, jeune veuve du Prophète, et Mo'awya, gouverneur de Damas. Aussi, Ali abdiqua-t-il au profit de ce dernier à la suite du célèbre « arbitrage d'Adrouh » rendu par une commission instituée à Siffîne, sur la rive droite de l'Euphrate. Cette défaite historique éloigne Ali d'anciens partisans appelés, depuis lors, les « Kharijïtes » ou « Sortants » et dont il subsiste encore une très faible minorité au Maghreb et à Oman. Mais les répercussions politiques de Siffîne sont surtout d'ordre institutionnel. Elles impriment à la légitimation du pouvoir un caractère héréditaire pour les fidèles partisans d'Ali et sa descendance, ou chiites, et une portée élective pour les autres Musulmans, appelés sunnites. C'est-à-dire fidèles à la Sunna ou Tradition du Prophète qui semble avoir laissé le gouvernement des Hommes à l'initiative des Hommes.
Actuellement les chiites représenteraient environ 10 % de la population islamique mondiale. Ils sont surtout concentrés en Iran et dans une partie de l'Irak, avec des minorités plus ou moins denses au Liban et en Afghanistan ou disséminés à travers la partie asiatique du monde musulman. Quant à la majorité sunnite, elle s'étend de l'Atlantique à l'Indus et se réserve l'exclusivité du Maghreb et de l'Afrique noire. C'est donc au sein de cette masse considérable, longtemps fécondée par la dimension dialectique de ses minorités turbulentes, que se sont forgés, dans le temps et dans l'espace, les instruments idéologiques de gouvernement, résultat d'une longue et profonde recherche intellectuelle.
b) Une recherche intellectuelle basée sur l'« Ijtihad » (effort)
Chez les non-spécialistes, il y a souvent une confusion sémantique entre jihad et ijtihad . Mais les deux mots diffèrent, bien qu'ils aient une racine commune : jehd (effort).
Le Jihad, malencontreusement traduit par « guerre sainte », signifie tout simplement « lutte », « combat ». Car l'arabe possède le terme harb pour dire « guerre », mais aucun pour dire « sainte » dans le sens qu'on lui donne. Le jihad peut certes s'exprimer dans une lutte armée révolutionnaire lorsqu'il s'agit d'un combat existentiel. D'où le mot « Moujahidoun » donné aux Combattants et même à leur expression écrite, « El-Moujahid ». Mais ce « jihad mineur » (al-jihad al-asghar) ne doit pas faire oublier, selon le Prophète, le « jihad majeur » (al-jihad al-akbar), à savoir la lutte individuelle et collective pour la promotion de l'homme et la justice sociale.
L'Ijtihad, en revanche, n'est pas un mode d'action ni de comportement comme le jihad. Il participe néanmoins des mêmes objectifs, à savoir la dignité de l'homme et l'intérêt général ( maslaha) . L'Ijtihad, donc, est un effort constant, rigoureux et persévérant de recherche intellectuelle, purement théorique. Il a pour but essentiel une adaptation permanente de l'instrument juridique et social aux changements continuels qui peuvent se produire dans l'espace islamique et le temps humain : à condition toutefois que ces changements soient au service de l'Homme et non l'inverse. A ce titre l'Ijtihad s'est toujours imposé comme un moyen implacable de légitimation de pouvoir islamique en fonction de finalités précises ( maqsad ). Durement combattu par le conservatisme stérile, mais aussi défendu par les réformateurs, l'Ijtihad reste, malgré tout, un outil intellectuel irremplaçable pour faire évoluer une méthodologie juridique islamique, aujourd'hui en panne. D'autant qu'il a, à son actif, l'une des plus grandes jurisprudences politiques, élaborée pendant les premiers siècles de l'Islam sur une base éthique et pratique.
c) Une méthodologie juridique plurale
II est largement répandu que le monde islamique ne fonctionne ou ne doit fonctionner qu'avec ou par la « loi coranique ». Or le Coran n'est ni la « Bible » pour justifier des tabous, ni le Code Napoléon pour qu'on puisse y chercher des articles taillés sur mesure. Le Coran est avant tout une œuvre d'inspiration et de suggestion qui interroge l'homme et l'invite à réfléchir sur son propre destin. Il lui assigne une responsabilité majeure, basée en quelque sorte sur le libre arbitre (qadar). Aussi, grâce à l’ijtihad, les premiers savants de l'Islam ont-ils pu mettre au point toute une méthodologie juridique. Elle a pour support, le Coran, certes, mais aussi le Hadith, le Qîyass et L' ijmaâ , enfin tout ce qui est susceptible de donner au pouvoir islamique une légitimité politique fondée sur l'éthique sociale et la pratique humaniste. Le Coran reste cependant le fondement principal de la Loi islamique. Et aucun Musulman ne peut, ni ne doit se passer de cette source essentielle. Il s'y réfère chaque fois qu'elle est en mesure d'apporter une solution claire et satisfaisante à une situation temporelle donnée et aux exigences de son évolution dans le temps et dans l'espace. Mais les premiers savants de l'Islam s'étaient vite rendu compte, après la mort du Prophète, que le texte coranique n'avait pas toujours prévu des réponses directement applicables aux problèmes complexes qui se posèrent à la nouvelle société musulmane ayant débordé les frontières arabiques.
Après avoir fourni un effort incomparable d'exégèse et d'interprétation du Coran, on en est venu à une deuxième source : le Hadith (ou « Sunna », c'est-à-dire la Tradition du Prophète, ses faits et gestes) pour compléter la source coranique. Tout un travail de recueil de textes est accompli. Il donna lieu à des vérifications rigoureuses qui n'ont rien à envier à celles employées par les méthodes actuelles de recherche en sciences sociales. Si les chiites ont préféré s'en tenir à leur propre version des Hadiths, les sunnites, en revanche, se sont livré à une étude comparative très poussée avant toute authentification. Parmi les recueils les plus cités figurent ceux de deux grands chercheurs : Bokhari (m. 869) et Moslim (m. 874).
Mais, c'est le Qîyass (raisonnement par analogie), considéré par beaucoup de chercheurs comme une troisième source, qui semble avoir ouvert le plus la voie au libéralisme et à l'interprétation personnelle. Il s'agit de rapprocher un problème nouvellement posé, d'un cas semblable déjà résolu, pour trouver une solution adéquate juridiquement fondée. On prête à Bourguiba d'avoir eu recours à cette source pour autoriser en Tunisie la rupture du Ramadan. Il aurait argué que le Prophète avait autorisé les Musulmans à rompre le jeûne dans un combat armé ou « jihad mineur » alors qu'il s'agit aujourd'hui de conserver aux travailleurs leur force physique pour mener à bien le « jihad majeur » ou lutte pour le développement (supra, l.b).
Enfin, il faut insister sur une quatrième source : L’ïjmaâ (ou consensus général) qui présente un intérêt capital pour la jurisprudence islamique. Cette source se distingue tant par le rôle déterminant qu'elle a joué dans le passé que par les perspectives de progrès qu'elle pourrait ouvrir aux pays musulmans. D'autant que l'Ijmaâ est fondé sur un Hadith célèbre du Prophète disant que « ma communauté ne se mettra jamais d'accord sur une erreur ».
L'enjeu est de taille et les difficultés aussi. C'est sans doute à ce titre que les docteurs sunnites se sont toujours posé la question de savoir de quel consensus il s'agit. Est-ce que l'unanimité faite par l'Ijmaâ, autour d'un point donné, en un lieu donné et à une époque donnée, peut ou non engager d'autres générations, dans d'autres lieux et en d'autres temps à venir ? Mais les expériences historiques, l'étendue géographique et la diversité culturelle et ethnique qui prévalent en terre d'Islam semblent avoir jusqu'ici introduit dans les faits une liberté d'appréciation. Arme à double tranchant qui peut tout aussi bien ouvrir la voie au progrès que devenir un instrument redoutable au bénéfice de l'arbitraire. Mais si l'on considère que L’ijmaâ (ou consensus général), aussi bien dans sa forme que dans son contenu, ne peut être déterminé que par l’ijtihad (ou voie de l'effort), on comprend dès lors les perspectives qu'offre une telle procédure. D'autant que l'Ijtihad ne doit pas se pratiquer sans rigueur intellectuelle ni garantie morale et, en tout état de cause, il ne peut l'être que par des chercheurs ou « Ulémas » indépendants du pouvoir politique (supra,
Quoi qu'il en soit, ce sont ces quatre sources — Coran, Hadith, Qîyass et Ijmaâ — qui ont été, pour une grande part, à l'origine de la méthode juridique islamique, notamment sunnite. Elles ont été souvent complétées par des démarches parallèles allant de la raison formelle (âql) à l'appréciation personnelle (ray) en passant par les coutumes populaires (Orf) et des considérations d'intérêt général (maslaha). Le produit de cet effort a donné lieu à quatre grandes Ecoles : Hanifite (d'Abou Hanifa, m. 767), Malikite (de Malik, m. 795), Chafiite (de Chafi'i, m. 819) et Hanbalite (d'Ibn Hanbal, m. 855).
Leur originalité respective réside dans l'emploi plus ou moins fréquent que ces Ecoles font des différentes sources.
Le résultat de ce processus est considéré jusqu'ici comme la Charia alislamiya (légitimité islamique) et la méthodologie employée, comme le Fiqh (jurisprudence). C'est dans cet arsenal juridique que puisent encore la plupart des pays musulmans actuels, à majorité sunnite, en vue de conformer à la légitimité islamique, leur légalité étatique.
a) Un choix institutionnel fondé sur la nature du pouvoir
Ce choix remonte à un événement historique d'importance capitale pour l'Islam, qui eut pour origine le problème posé par le pouvoir après la mort du Prophète Mohammed en 632. Celui-ci n'a désigné aucun successeur de son vivant, comme pour laisser aux Musulmans le soin de régler eux-mêmes la question de leur propre gouvernement. Aussi pendant un quart de siècle environ, des élections locales improvisées ont-elles porté successivement à la tête de l'Etat musulman, en pleine expansion, les quatre premiers Califes (proches compagnons du Prophète) dit « orthodoxes » ou « rachidoun » (bien dirigés) : Abou-Bakr, Omar, Othman, enfin Ali, gendre du Prophète, époux de sa fille, Fatima.
Mais, en 657, l'élection du quatrième Calife, Ali, fut vigoureusement contestée par Aïcha, jeune veuve du Prophète, et Mo'awya, gouverneur de Damas. Aussi, Ali abdiqua-t-il au profit de ce dernier à la suite du célèbre « arbitrage d'Adrouh » rendu par une commission instituée à Siffîne, sur la rive droite de l'Euphrate. Cette défaite historique éloigne Ali d'anciens partisans appelés, depuis lors, les « Kharijïtes » ou « Sortants » et dont il subsiste encore une très faible minorité au Maghreb et à Oman. Mais les répercussions politiques de Siffîne sont surtout d'ordre institutionnel. Elles impriment à la légitimation du pouvoir un caractère héréditaire pour les fidèles partisans d'Ali et sa descendance, ou chiites, et une portée élective pour les autres Musulmans, appelés sunnites. C'est-à-dire fidèles à la Sunna ou Tradition du Prophète qui semble avoir laissé le gouvernement des Hommes à l'initiative des Hommes.
Actuellement les chiites représenteraient environ 10 % de la population islamique mondiale. Ils sont surtout concentrés en Iran et dans une partie de l'Irak, avec des minorités plus ou moins denses au Liban et en Afghanistan ou disséminés à travers la partie asiatique du monde musulman. Quant à la majorité sunnite, elle s'étend de l'Atlantique à l'Indus et se réserve l'exclusivité du Maghreb et de l'Afrique noire. C'est donc au sein de cette masse considérable, longtemps fécondée par la dimension dialectique de ses minorités turbulentes, que se sont forgés, dans le temps et dans l'espace, les instruments idéologiques de gouvernement, résultat d'une longue et profonde recherche intellectuelle.
b) Une recherche intellectuelle basée sur l'« Ijtihad » (effort)
Chez les non-spécialistes, il y a souvent une confusion sémantique entre jihad et ijtihad . Mais les deux mots diffèrent, bien qu'ils aient une racine commune : jehd (effort).
Le Jihad, malencontreusement traduit par « guerre sainte », signifie tout simplement « lutte », « combat ». Car l'arabe possède le terme harb pour dire « guerre », mais aucun pour dire « sainte » dans le sens qu'on lui donne. Le jihad peut certes s'exprimer dans une lutte armée révolutionnaire lorsqu'il s'agit d'un combat existentiel. D'où le mot « Moujahidoun » donné aux Combattants et même à leur expression écrite, « El-Moujahid ». Mais ce « jihad mineur » (al-jihad al-asghar) ne doit pas faire oublier, selon le Prophète, le « jihad majeur » (al-jihad al-akbar), à savoir la lutte individuelle et collective pour la promotion de l'homme et la justice sociale.
L'Ijtihad, en revanche, n'est pas un mode d'action ni de comportement comme le jihad. Il participe néanmoins des mêmes objectifs, à savoir la dignité de l'homme et l'intérêt général ( maslaha) . L'Ijtihad, donc, est un effort constant, rigoureux et persévérant de recherche intellectuelle, purement théorique. Il a pour but essentiel une adaptation permanente de l'instrument juridique et social aux changements continuels qui peuvent se produire dans l'espace islamique et le temps humain : à condition toutefois que ces changements soient au service de l'Homme et non l'inverse. A ce titre l'Ijtihad s'est toujours imposé comme un moyen implacable de légitimation de pouvoir islamique en fonction de finalités précises ( maqsad ). Durement combattu par le conservatisme stérile, mais aussi défendu par les réformateurs, l'Ijtihad reste, malgré tout, un outil intellectuel irremplaçable pour faire évoluer une méthodologie juridique islamique, aujourd'hui en panne. D'autant qu'il a, à son actif, l'une des plus grandes jurisprudences politiques, élaborée pendant les premiers siècles de l'Islam sur une base éthique et pratique.
c) Une méthodologie juridique plurale
II est largement répandu que le monde islamique ne fonctionne ou ne doit fonctionner qu'avec ou par la « loi coranique ». Or le Coran n'est ni la « Bible » pour justifier des tabous, ni le Code Napoléon pour qu'on puisse y chercher des articles taillés sur mesure. Le Coran est avant tout une œuvre d'inspiration et de suggestion qui interroge l'homme et l'invite à réfléchir sur son propre destin. Il lui assigne une responsabilité majeure, basée en quelque sorte sur le libre arbitre (qadar). Aussi, grâce à l’ijtihad, les premiers savants de l'Islam ont-ils pu mettre au point toute une méthodologie juridique. Elle a pour support, le Coran, certes, mais aussi le Hadith, le Qîyass et L' ijmaâ , enfin tout ce qui est susceptible de donner au pouvoir islamique une légitimité politique fondée sur l'éthique sociale et la pratique humaniste. Le Coran reste cependant le fondement principal de la Loi islamique. Et aucun Musulman ne peut, ni ne doit se passer de cette source essentielle. Il s'y réfère chaque fois qu'elle est en mesure d'apporter une solution claire et satisfaisante à une situation temporelle donnée et aux exigences de son évolution dans le temps et dans l'espace. Mais les premiers savants de l'Islam s'étaient vite rendu compte, après la mort du Prophète, que le texte coranique n'avait pas toujours prévu des réponses directement applicables aux problèmes complexes qui se posèrent à la nouvelle société musulmane ayant débordé les frontières arabiques.
Après avoir fourni un effort incomparable d'exégèse et d'interprétation du Coran, on en est venu à une deuxième source : le Hadith (ou « Sunna », c'est-à-dire la Tradition du Prophète, ses faits et gestes) pour compléter la source coranique. Tout un travail de recueil de textes est accompli. Il donna lieu à des vérifications rigoureuses qui n'ont rien à envier à celles employées par les méthodes actuelles de recherche en sciences sociales. Si les chiites ont préféré s'en tenir à leur propre version des Hadiths, les sunnites, en revanche, se sont livré à une étude comparative très poussée avant toute authentification. Parmi les recueils les plus cités figurent ceux de deux grands chercheurs : Bokhari (m. 869) et Moslim (m. 874).
Mais, c'est le Qîyass (raisonnement par analogie), considéré par beaucoup de chercheurs comme une troisième source, qui semble avoir ouvert le plus la voie au libéralisme et à l'interprétation personnelle. Il s'agit de rapprocher un problème nouvellement posé, d'un cas semblable déjà résolu, pour trouver une solution adéquate juridiquement fondée. On prête à Bourguiba d'avoir eu recours à cette source pour autoriser en Tunisie la rupture du Ramadan. Il aurait argué que le Prophète avait autorisé les Musulmans à rompre le jeûne dans un combat armé ou « jihad mineur » alors qu'il s'agit aujourd'hui de conserver aux travailleurs leur force physique pour mener à bien le « jihad majeur » ou lutte pour le développement (supra, l.b).
Enfin, il faut insister sur une quatrième source : L’ïjmaâ (ou consensus général) qui présente un intérêt capital pour la jurisprudence islamique. Cette source se distingue tant par le rôle déterminant qu'elle a joué dans le passé que par les perspectives de progrès qu'elle pourrait ouvrir aux pays musulmans. D'autant que l'Ijmaâ est fondé sur un Hadith célèbre du Prophète disant que « ma communauté ne se mettra jamais d'accord sur une erreur ».
L'enjeu est de taille et les difficultés aussi. C'est sans doute à ce titre que les docteurs sunnites se sont toujours posé la question de savoir de quel consensus il s'agit. Est-ce que l'unanimité faite par l'Ijmaâ, autour d'un point donné, en un lieu donné et à une époque donnée, peut ou non engager d'autres générations, dans d'autres lieux et en d'autres temps à venir ? Mais les expériences historiques, l'étendue géographique et la diversité culturelle et ethnique qui prévalent en terre d'Islam semblent avoir jusqu'ici introduit dans les faits une liberté d'appréciation. Arme à double tranchant qui peut tout aussi bien ouvrir la voie au progrès que devenir un instrument redoutable au bénéfice de l'arbitraire. Mais si l'on considère que L’ijmaâ (ou consensus général), aussi bien dans sa forme que dans son contenu, ne peut être déterminé que par l’ijtihad (ou voie de l'effort), on comprend dès lors les perspectives qu'offre une telle procédure. D'autant que l'Ijtihad ne doit pas se pratiquer sans rigueur intellectuelle ni garantie morale et, en tout état de cause, il ne peut l'être que par des chercheurs ou « Ulémas » indépendants du pouvoir politique (supra,
Quoi qu'il en soit, ce sont ces quatre sources — Coran, Hadith, Qîyass et Ijmaâ — qui ont été, pour une grande part, à l'origine de la méthode juridique islamique, notamment sunnite. Elles ont été souvent complétées par des démarches parallèles allant de la raison formelle (âql) à l'appréciation personnelle (ray) en passant par les coutumes populaires (Orf) et des considérations d'intérêt général (maslaha). Le produit de cet effort a donné lieu à quatre grandes Ecoles : Hanifite (d'Abou Hanifa, m. 767), Malikite (de Malik, m. 795), Chafiite (de Chafi'i, m. 819) et Hanbalite (d'Ibn Hanbal, m. 855).
Leur originalité respective réside dans l'emploi plus ou moins fréquent que ces Ecoles font des différentes sources.
Le résultat de ce processus est considéré jusqu'ici comme la Charia alislamiya (légitimité islamique) et la méthodologie employée, comme le Fiqh (jurisprudence). C'est dans cet arsenal juridique que puisent encore la plupart des pays musulmans actuels, à majorité sunnite, en vue de conformer à la légitimité islamique, leur légalité étatique.
II. — LÉGALITÉ ÉTATIQUE
La légitimité islamique dont nous venons de rappeler les fondements n'a qu'un caractère théorique. Elle ne peut donc avoir de sens que dans la mesure où elle se reflète dans une application pratique. Celle-ci doit avoir pour but de « légaliser » la fonction temporelle et spirituelle dans une société politique musulmane. Ce fut le Calife qui, autrefois, incarnait ces hautes charges. Actuellement ce sont des monarques ou présidents qui paraissent, sous des formes diverses, prendre la relève. La théorie du Califat
a longtemps servi, et sert encore dans une certaine mesure, de tremplin aux systèmes politiques islamiques. C'est donc à ses fondements qu'il faudra revenir pour mieux situer la légalité étatique qui en découle. Elle repose essentiellement sur un contrat de pouvoir et la capacité de gouverner. Deux exigences dont les implications actuelles suscitent des interrogations.
a) Le contrat de pouvoir (Mou-Beïa)
Le Calife sunnite est différent de l'Imam chiite, impeccable et infaillible, seul dépositaire de la Loi. En théorie sunnite, le Calife est considéré comme un simple « Substitut » de Dieu et/ou du Prophète sur terre, donc de la Communauté tout entière ( Oumma ). D'où le terme Calife (fondé de pouvoir). Il n'incarne aucun ordre divin, mais il est le Chef spirituel et temporel. Il n'est pas la source de la loi, mais il en est le gardien (amana) : la loi devant être élaborée dans le cadre de la légitimité islamique, comme nous venons de le voir (supra, I). Il est « Préposé » (à la Magistrature suprême) comme pourrait l'être aujourd'hui un monarque, un président ou un chef d'Etat musulman. Il est « délégué » à la gestion des biens de la Communauté au service de la justice sociale et de la sublimation spirituelle. Son accession au pouvoir suppose donc un contrat qui se résume en une élection, suivie d'une investiture que scelle une ratification populaire.
L’élection (ikhtyar) a toujours posé des problèmes pratiques quasi insurmontables. L'un des plus aigus rut en tout lieu, au Maghreb comme au Machrek ou en Asie, la dispersion des Musulmans sur une très grande échelle géographique. Surtout à un moment où les moyens de locomotion et de communication faisaient cruellement défaut. Pour s'en rendre compte, il suffit d'avoir présent à l'esprit le fait de pouvoir actuellement aller d'une contrée à l'autre en l'espace de quelques heures et de recevoir l'information à domicile par l'intermédiaire de la radio et de la télévision, au déjeuner le matin comme au dîner le soir. Parler des élections à l'époque, dans un univers qui n'en connaissait point, relevait donc d'une utopie politique que l'Islam légitimiste acceptait d'assumer, même d'une façon problématique. C'est dire que les électeurs potentiels se réduisaient à trois collèges : les Ulémas (intellectuels et idéologues) et, accessoirement, les Orafas (Experts socio-économiques), enfin les Ahl-Chawka (dépositaires d'un pouvoir coercitif réel); c'est-à-dire les chefs de tribus, eux-mêmes initialement désignés par leurs pairs.
Quant à l’investiture (Be'ia), elle suppose d'abord un recours à la consultation (mouchawara) : la « choura » recommandée par le Coran. Elle réside donc dans la « Beïa » qui n'est pas, comme on a tendance à le croire, une « allégeance » statique. Il s'agit d'une Mou-Beïa selon Ibn Taimiya. C'est-à-dire d'un véritable « contrat de pouvoir » se résumant en un double serment de fidélité liant le Calife à la Oumma (ou peuple). Le premier s'engage ainsi à veiller sur les intérêts matériels et moraux de la Communauté (Al-Amr hil-Maârouj WaNahy an-almounkar). La seconde lui doit, en échange, obéissance et loyauté. Mais, selon les principes de l'Islam, la Oumma ne doit verser ni dans une soumission passive, ni manquer de vigilance, ni renoncer à tout esprit critique.
Pour la jurisprudence musulmane, la conclusion du contrat de pouvoir n'est valide que si dans tout le pays les personnes ayant la maturité nécessaire pour « conclure et résoudre », « faire et défaire » ( Ahl-al-Akd-wal-Hal) y prennent part : de sorte qu'il y ait une expression effective de consentement de tous les « électeurs » et de reconnaissance unanime du Calife. Il s'agit, selon Rachid Rida, d'une véritable manifestation de la souveraineté d'un peuple (sultat al-Oumma).
Aussi une ratification populaire s'avère-t-elle nécessaire. Elle se caractérise par une tournée de grandes mosquées qu'effectue le Calife investi pour présider la prière du vendredi, d'une région à l'autre de la contrée concernée. La présence massive des croyants signifie une approbation populaire, tandis que leur absence indique le contraire. Des exemples historiques, et même contemporains, ont montré l'efficacité d'une telle procédure, dont les sanctions politiques peuvent être redoutables. Mais cette pieuse exigence ne semble plus avoir cours de nos jours. Elle est remplacée dans de nombreux pays musulmans, par un référendum ou consultation populaire (choura) recommandée par le Coran et admise comme Ijmaâ {supra, I.c).
b) La capacité de gouverner (kifaya)
La deuxième condition de la légalité étatique, élaborée par les grandes Ecoles sunnites auxquelles on se réfère encore, est donc la capacité de gouverner Celle-ci ne se limite pas seulement à un profil personnel. Elle s'étend aussi à la délégation des pouvoirs. C'est-à-dire au choix judicieux des collaborateurs. Ils sont, pour tout Préposé à la Magistrature suprême, le prolongement psychologique et social de son image de marque. Ils doivent constituer un rempart contre la dégradation des mœurs politiques ; dégradation susceptible de conduire à la déchéance du Calife dont l'homologue actuel, comme nous l'avons vu, pourrait être un monarque ou un président, ou tout chef d'Etat musulman.
Le profil personnel requiert, selon la théorie califale d'El-Mawerdi (m. 1058), un large éventail d'exigences dont trois essentiellement [1] : physiques, morales et intellectuelles. La capacité physique se résume en « la pleine jouissance des sens de l'ouïe et de la vue, et de don de la parole, tellement qu'ils soient propres à rendre tous les services qu'on en retire habituellement » ainsi que « la santé des membres du corps, tellement qu'ils soient exempts de tous défauts pouvant empêcher la liberté et la promptitude des mouvements ». Quant aux qualités morales, ce sont surtout « la justice dans la plénitude de ses conditions (...), le degré de sagesse nécessaire pour le gouvernement des hommes et la direction des affaires (...), la vaillance et le courage pour protéger la terre de l'Islam ».
Enfin, la troisième et dernière condition à remplir pour être digne de porter la lourde responsabilité qui incombe à cette haute fonction, toujours selon El-Mawerdi, est un grand savoir lié à l'intelligence du coeur et de l'esprit :
« Le degré de science nécessaire pour pratiquer l'ijtihâd en matière de décision à prendre ou de sentences à prononcer. » II s'agit, en l'occurrence, d'être porté à pratiquer un effort constant de recherches personnelles et méthodiques de la « vérité » devant conduire à une complète maîtrise intellectuelle des situations, une grande rigueur de diagnostic, une justesse d'évaluation de tous les aspects qui en découlent et une promptitude de jugement qu'imposent les contingences du pouvoir politique.».
Comme toutes ces qualités ne peuvent être réunies en une seule et même personne, une délégation de pouvoir s'avère donc nécessaire. Elle consiste, selon les théories de la fonction publique d'Ibn Taimiya (m. 1328), à choisir pour chaque fonction l'homme le plus apte à l'exercer [2]. Cette aptitude repose essentiellement sur la « compétence » et la « loyauté ». La compétence (qawa) requiert à la fois une « force » technique et une « force » de caractère. La force technique réside pour un juge, par exemple, dans une connaissance parfaite des sources juridiques et la capacité intellectuelle des les interpréter et de les appliquer ; alors que pour un combattant il suffit d'être brave, expérimenté et habile. Quant à la « force » de caractère, elle réside dans une très grande rigueur d'appréciation théorique, accompagnée d'une certaine souplesse au stade de l'application, car « l'autorité s'obtient tantôt par la contrainte, tantôt par la générosité, mais les deux procédés, dans la réalité, vont ensemble » dit Ibn Taimiya. Pour ce qui est de la loyauté (amana), deuxième condition à remplir dans une fonction publique, elle doit se refléter surtout à travers des qualités humaines intrinsèques, ayant pour corollaire la probité et l'honnêteté intellectuelle et morale. La loyauté peut aussi se matérialiser dans les faits, par le « désintéressement » et le « renoncement ». Le désintéressement est une disposition à se mettre au service d'une fonction et non l'inverse. D'où le renoncement nécessaire du fonctionnaire. Il consiste à défendre la fonction publique contre ses propres caprices et ceux de ses proches afin de ne pas verser dans l'abus de confiance et le népotisme : « Tout homme investi d'une autorité sur les Musulmans qui nomme un fonctionnaire par amitié ou parenté trompe Dieu, son Prophète et les Musulmans » rappelait le Calife Omar à son fils. A ces deux aptitudes, faites de compétences techniques et de qualités humaines, exigées de tous ceux qui ont en charge une fonction d'intérêt général, il faut en ajouter une troisième. Il s'agit de la piété qui, en principe, doit être le propre de tout Musulman le garantissant contre les déviations. Mais celle-ci peut parfois entrer en conflit avec celles-là. Notamment lorsqu'on se trouve devant la difficile alternative de choisir, pour une fonction névralgique, entre un homme capable mais non pratiquant et un autre pieux mais incapable : « Pour ce qui est du premier, il fera profiter tous les Musulmans de son habileté, et il sera seul à souffrir de son impiété. Quant au second il gardera pour lui le bénéfice de sa piété, mais tous les Musulmans auront à souffrir de son incapacité » tranche l'imam Ibn Hanbal, fondateur de l'Ecole qui porte son nom (supra, l.c). Aussi, est-il recommandable de confier une fonction à plusieurs personnes lorsqu'un seul homme est incapable de s'en acquitter utilement, ajoute Ibn Taimiya.
c) Implications actuelles
Cet annonciateur lointain de la séparation des pouvoirs en Islam, que nous venons d'évoquer, ne fait que confirmer une constante de la théorie légitimiste depuis ses origines. Jacques Berque qualifie l'autorité islamique ď « intersectorielle » et montre que la légitimité de « droit divin » est une notion récente, étrangère à l'Islam (infra, III.c-11). Pour Mohammed Arkoun, il s'agit d'une islamologie sommaire qui accrédite l'idée qu'en Islam « le temporel et le spirituel ne sont jamais séparés » (infra, IV. c-16). En fait dans l'histoire islamique sunnite le pouvoir n'a jamais été confié à des « clercs ». Le Calife ou Préposé tel, réunit théoriquement tous les pouvoirs, mais l'exercice fonctionnel s'en trouve séparé dans les faits (supra, II.a-b). Si le « Substitut » suprême garde l'initiative politique, les « Ulémas » (intellectuels et idéologues), en revanche, ont seul le droit de légiférer à condition qu'ils conservent leur indépendance scientifique. Tout comme les « Orafas » (Experts socioéconomiques) sont habilités à proposer des solutions techniques. Des malversations et des subterfuges juridiques semblent, cependant, avoir peu à peu dénaturé le sens du pouvoir en Islam dont les mécanismes de contrôle, il est vrai, ne paraissent pas se distinguer par leur efficacité (infra, III.c).
Qu'en est-il actuellement ? Et en quoi les pouvoirs islamiques contemporains se réfèrent-ils à l'Islam ?
Sur le plan institutionnel, tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que les constitutions de tous les pays musulmans, quelles que soient leur philosophie sociale ou leur option politique, portent encore la marque indélébile de l'Islam. On peut y lire par exemple : Etat musulman, Etat musulman et constitutionnel, Etat musulman et démocratique, Etat musulman et socialiste; mais aussi : la souveraineté appartient à la nation; ou enfin : le Saint Coran est la Loi, et le Pouvoir populaire direct est la base du système politique, etc.
Juridiquement, on se reporte aussi à la légitimité islamique, élaborée par la jurisprudence sunnite ou Fiqh (supra, l.c). Même la Syrie baâthiste s'y réfère en tant que « source principale de la législation ». Pourtant, c'est l'un des rares pays musulmans dont la constitution ne mentionne pas explicitement l'Islam comme religion d'Etat (infra, IV .b). En revanche la Libye kadhafiste, qui se limite au seul Coran, rejette tout le Fiqh avec ses quatre Ecoles; et même le Hadith du Prophète en tant que « Sunna » digne de foi (supra,I.c). Pour Kadhafi, la « légitimité islamique » (Charia al-islamiya) avec ses sources multiples s'oppose à la « légitimité coranique » (Charia al-Corania). Cette dernière, rappelle-t-il, doit être considérée comme la source unique, surtout dans le domaine spirituel. Mais elle doit être prolongée, sur le plan temporel, par un effort populaire d'essence coutumière (Orf), adapté à chaque époque (infra, IV. с). Aussi récuse-t-il catégoriquement la théorie du Califat dont s'inspirent encore, explicitement ou implicitement, d'autres pays musulmans.
Pour lui, elle ne sert plus qu'à « légaliser », voire « légitimer » des pouvoirs contradictoires déjà en place. En fait, des procédures institutionnelles diverses peuvent consacrer aussi bien un monarque qu'un président, dans des systèmes « libéraux » comme dans des systèmes « socialistes », les uns et les autres se réclamant tous de l'Islam.
A ce titre, L’ijmaâ, ou consensus général, apparaît comme une issue providentielle de légitimation de pouvoirs islamiques différents. Il est pourtant contesté par bien des Etats, mais néanmoins admis de façon restrictive qui se limite aux conditions propres à chaque pays. Or, par la transposition référendaire qu'on peut en faire, il entraîne juridiquement des obligations précises. Surtout quand on l'assimile à la « Choura » ou consultation populaire recommandée par le Coran. Il entre ainsi dans l'impressionnant arsenal du Fiqh (supra, I.c). D'où il ressort qu'une légalité étatique doit, pour être conforme à la légitimité islamique, reposer sur un contrat de pouvoir et la capacité de gouverner (supra, II. a-b). Le corollaire en est la sauvegarde de l'intérêt général de toute la Communauté. Dans le cas contraire « le trouble se met dans les affaires », écrit Ibn Taimiya. Il en découle de graves indispositions pour la collectivité et une cause de déchéance pour les gouvernants. La conséquence en est une rupture du contrat de pouvoir largement prévue par toutes les théories politiques islamiques. Notamment, lorsque ceux qui ont en charge de veiller à l'intérêt de la Communauté (Oumma) se complaisent « aux actions blâmables en prenant le désir pour maître et la passion pour guide », écrit El-Mawerdi. C'est à ce niveau que l'Histoire de l'Islam a enregistré des malversations dans les légalités étatiques ayant entraîné des conflits d'appréciation avec la légitimité islamique. Il s'en est suivi parfois de tragiques revirements, mais aussi, selon les circonstances, de réelles résurgences. Ruptures et régulations ont ainsi caractérisé toute l'histoire politique de l'Islam.
a) Le contrat de pouvoir (Mou-Beïa)
Le Calife sunnite est différent de l'Imam chiite, impeccable et infaillible, seul dépositaire de la Loi. En théorie sunnite, le Calife est considéré comme un simple « Substitut » de Dieu et/ou du Prophète sur terre, donc de la Communauté tout entière ( Oumma ). D'où le terme Calife (fondé de pouvoir). Il n'incarne aucun ordre divin, mais il est le Chef spirituel et temporel. Il n'est pas la source de la loi, mais il en est le gardien (amana) : la loi devant être élaborée dans le cadre de la légitimité islamique, comme nous venons de le voir (supra, I). Il est « Préposé » (à la Magistrature suprême) comme pourrait l'être aujourd'hui un monarque, un président ou un chef d'Etat musulman. Il est « délégué » à la gestion des biens de la Communauté au service de la justice sociale et de la sublimation spirituelle. Son accession au pouvoir suppose donc un contrat qui se résume en une élection, suivie d'une investiture que scelle une ratification populaire.
L’élection (ikhtyar) a toujours posé des problèmes pratiques quasi insurmontables. L'un des plus aigus rut en tout lieu, au Maghreb comme au Machrek ou en Asie, la dispersion des Musulmans sur une très grande échelle géographique. Surtout à un moment où les moyens de locomotion et de communication faisaient cruellement défaut. Pour s'en rendre compte, il suffit d'avoir présent à l'esprit le fait de pouvoir actuellement aller d'une contrée à l'autre en l'espace de quelques heures et de recevoir l'information à domicile par l'intermédiaire de la radio et de la télévision, au déjeuner le matin comme au dîner le soir. Parler des élections à l'époque, dans un univers qui n'en connaissait point, relevait donc d'une utopie politique que l'Islam légitimiste acceptait d'assumer, même d'une façon problématique. C'est dire que les électeurs potentiels se réduisaient à trois collèges : les Ulémas (intellectuels et idéologues) et, accessoirement, les Orafas (Experts socio-économiques), enfin les Ahl-Chawka (dépositaires d'un pouvoir coercitif réel); c'est-à-dire les chefs de tribus, eux-mêmes initialement désignés par leurs pairs.
Quant à l’investiture (Be'ia), elle suppose d'abord un recours à la consultation (mouchawara) : la « choura » recommandée par le Coran. Elle réside donc dans la « Beïa » qui n'est pas, comme on a tendance à le croire, une « allégeance » statique. Il s'agit d'une Mou-Beïa selon Ibn Taimiya. C'est-à-dire d'un véritable « contrat de pouvoir » se résumant en un double serment de fidélité liant le Calife à la Oumma (ou peuple). Le premier s'engage ainsi à veiller sur les intérêts matériels et moraux de la Communauté (Al-Amr hil-Maârouj WaNahy an-almounkar). La seconde lui doit, en échange, obéissance et loyauté. Mais, selon les principes de l'Islam, la Oumma ne doit verser ni dans une soumission passive, ni manquer de vigilance, ni renoncer à tout esprit critique.
Pour la jurisprudence musulmane, la conclusion du contrat de pouvoir n'est valide que si dans tout le pays les personnes ayant la maturité nécessaire pour « conclure et résoudre », « faire et défaire » ( Ahl-al-Akd-wal-Hal) y prennent part : de sorte qu'il y ait une expression effective de consentement de tous les « électeurs » et de reconnaissance unanime du Calife. Il s'agit, selon Rachid Rida, d'une véritable manifestation de la souveraineté d'un peuple (sultat al-Oumma).
Aussi une ratification populaire s'avère-t-elle nécessaire. Elle se caractérise par une tournée de grandes mosquées qu'effectue le Calife investi pour présider la prière du vendredi, d'une région à l'autre de la contrée concernée. La présence massive des croyants signifie une approbation populaire, tandis que leur absence indique le contraire. Des exemples historiques, et même contemporains, ont montré l'efficacité d'une telle procédure, dont les sanctions politiques peuvent être redoutables. Mais cette pieuse exigence ne semble plus avoir cours de nos jours. Elle est remplacée dans de nombreux pays musulmans, par un référendum ou consultation populaire (choura) recommandée par le Coran et admise comme Ijmaâ {supra, I.c).
b) La capacité de gouverner (kifaya)
La deuxième condition de la légalité étatique, élaborée par les grandes Ecoles sunnites auxquelles on se réfère encore, est donc la capacité de gouverner Celle-ci ne se limite pas seulement à un profil personnel. Elle s'étend aussi à la délégation des pouvoirs. C'est-à-dire au choix judicieux des collaborateurs. Ils sont, pour tout Préposé à la Magistrature suprême, le prolongement psychologique et social de son image de marque. Ils doivent constituer un rempart contre la dégradation des mœurs politiques ; dégradation susceptible de conduire à la déchéance du Calife dont l'homologue actuel, comme nous l'avons vu, pourrait être un monarque ou un président, ou tout chef d'Etat musulman.
Le profil personnel requiert, selon la théorie califale d'El-Mawerdi (m. 1058), un large éventail d'exigences dont trois essentiellement [1] : physiques, morales et intellectuelles. La capacité physique se résume en « la pleine jouissance des sens de l'ouïe et de la vue, et de don de la parole, tellement qu'ils soient propres à rendre tous les services qu'on en retire habituellement » ainsi que « la santé des membres du corps, tellement qu'ils soient exempts de tous défauts pouvant empêcher la liberté et la promptitude des mouvements ». Quant aux qualités morales, ce sont surtout « la justice dans la plénitude de ses conditions (...), le degré de sagesse nécessaire pour le gouvernement des hommes et la direction des affaires (...), la vaillance et le courage pour protéger la terre de l'Islam ».
Enfin, la troisième et dernière condition à remplir pour être digne de porter la lourde responsabilité qui incombe à cette haute fonction, toujours selon El-Mawerdi, est un grand savoir lié à l'intelligence du coeur et de l'esprit :
« Le degré de science nécessaire pour pratiquer l'ijtihâd en matière de décision à prendre ou de sentences à prononcer. » II s'agit, en l'occurrence, d'être porté à pratiquer un effort constant de recherches personnelles et méthodiques de la « vérité » devant conduire à une complète maîtrise intellectuelle des situations, une grande rigueur de diagnostic, une justesse d'évaluation de tous les aspects qui en découlent et une promptitude de jugement qu'imposent les contingences du pouvoir politique.».
Comme toutes ces qualités ne peuvent être réunies en une seule et même personne, une délégation de pouvoir s'avère donc nécessaire. Elle consiste, selon les théories de la fonction publique d'Ibn Taimiya (m. 1328), à choisir pour chaque fonction l'homme le plus apte à l'exercer [2]. Cette aptitude repose essentiellement sur la « compétence » et la « loyauté ». La compétence (qawa) requiert à la fois une « force » technique et une « force » de caractère. La force technique réside pour un juge, par exemple, dans une connaissance parfaite des sources juridiques et la capacité intellectuelle des les interpréter et de les appliquer ; alors que pour un combattant il suffit d'être brave, expérimenté et habile. Quant à la « force » de caractère, elle réside dans une très grande rigueur d'appréciation théorique, accompagnée d'une certaine souplesse au stade de l'application, car « l'autorité s'obtient tantôt par la contrainte, tantôt par la générosité, mais les deux procédés, dans la réalité, vont ensemble » dit Ibn Taimiya. Pour ce qui est de la loyauté (amana), deuxième condition à remplir dans une fonction publique, elle doit se refléter surtout à travers des qualités humaines intrinsèques, ayant pour corollaire la probité et l'honnêteté intellectuelle et morale. La loyauté peut aussi se matérialiser dans les faits, par le « désintéressement » et le « renoncement ». Le désintéressement est une disposition à se mettre au service d'une fonction et non l'inverse. D'où le renoncement nécessaire du fonctionnaire. Il consiste à défendre la fonction publique contre ses propres caprices et ceux de ses proches afin de ne pas verser dans l'abus de confiance et le népotisme : « Tout homme investi d'une autorité sur les Musulmans qui nomme un fonctionnaire par amitié ou parenté trompe Dieu, son Prophète et les Musulmans » rappelait le Calife Omar à son fils. A ces deux aptitudes, faites de compétences techniques et de qualités humaines, exigées de tous ceux qui ont en charge une fonction d'intérêt général, il faut en ajouter une troisième. Il s'agit de la piété qui, en principe, doit être le propre de tout Musulman le garantissant contre les déviations. Mais celle-ci peut parfois entrer en conflit avec celles-là. Notamment lorsqu'on se trouve devant la difficile alternative de choisir, pour une fonction névralgique, entre un homme capable mais non pratiquant et un autre pieux mais incapable : « Pour ce qui est du premier, il fera profiter tous les Musulmans de son habileté, et il sera seul à souffrir de son impiété. Quant au second il gardera pour lui le bénéfice de sa piété, mais tous les Musulmans auront à souffrir de son incapacité » tranche l'imam Ibn Hanbal, fondateur de l'Ecole qui porte son nom (supra, l.c). Aussi, est-il recommandable de confier une fonction à plusieurs personnes lorsqu'un seul homme est incapable de s'en acquitter utilement, ajoute Ibn Taimiya.
c) Implications actuelles
Cet annonciateur lointain de la séparation des pouvoirs en Islam, que nous venons d'évoquer, ne fait que confirmer une constante de la théorie légitimiste depuis ses origines. Jacques Berque qualifie l'autorité islamique ď « intersectorielle » et montre que la légitimité de « droit divin » est une notion récente, étrangère à l'Islam (infra, III.c-11). Pour Mohammed Arkoun, il s'agit d'une islamologie sommaire qui accrédite l'idée qu'en Islam « le temporel et le spirituel ne sont jamais séparés » (infra, IV. c-16). En fait dans l'histoire islamique sunnite le pouvoir n'a jamais été confié à des « clercs ». Le Calife ou Préposé tel, réunit théoriquement tous les pouvoirs, mais l'exercice fonctionnel s'en trouve séparé dans les faits (supra, II.a-b). Si le « Substitut » suprême garde l'initiative politique, les « Ulémas » (intellectuels et idéologues), en revanche, ont seul le droit de légiférer à condition qu'ils conservent leur indépendance scientifique. Tout comme les « Orafas » (Experts socioéconomiques) sont habilités à proposer des solutions techniques. Des malversations et des subterfuges juridiques semblent, cependant, avoir peu à peu dénaturé le sens du pouvoir en Islam dont les mécanismes de contrôle, il est vrai, ne paraissent pas se distinguer par leur efficacité (infra, III.c).
Qu'en est-il actuellement ? Et en quoi les pouvoirs islamiques contemporains se réfèrent-ils à l'Islam ?
Sur le plan institutionnel, tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que les constitutions de tous les pays musulmans, quelles que soient leur philosophie sociale ou leur option politique, portent encore la marque indélébile de l'Islam. On peut y lire par exemple : Etat musulman, Etat musulman et constitutionnel, Etat musulman et démocratique, Etat musulman et socialiste; mais aussi : la souveraineté appartient à la nation; ou enfin : le Saint Coran est la Loi, et le Pouvoir populaire direct est la base du système politique, etc.
Juridiquement, on se reporte aussi à la légitimité islamique, élaborée par la jurisprudence sunnite ou Fiqh (supra, l.c). Même la Syrie baâthiste s'y réfère en tant que « source principale de la législation ». Pourtant, c'est l'un des rares pays musulmans dont la constitution ne mentionne pas explicitement l'Islam comme religion d'Etat (infra, IV .b). En revanche la Libye kadhafiste, qui se limite au seul Coran, rejette tout le Fiqh avec ses quatre Ecoles; et même le Hadith du Prophète en tant que « Sunna » digne de foi (supra,I.c). Pour Kadhafi, la « légitimité islamique » (Charia al-islamiya) avec ses sources multiples s'oppose à la « légitimité coranique » (Charia al-Corania). Cette dernière, rappelle-t-il, doit être considérée comme la source unique, surtout dans le domaine spirituel. Mais elle doit être prolongée, sur le plan temporel, par un effort populaire d'essence coutumière (Orf), adapté à chaque époque (infra, IV. с). Aussi récuse-t-il catégoriquement la théorie du Califat dont s'inspirent encore, explicitement ou implicitement, d'autres pays musulmans.
Pour lui, elle ne sert plus qu'à « légaliser », voire « légitimer » des pouvoirs contradictoires déjà en place. En fait, des procédures institutionnelles diverses peuvent consacrer aussi bien un monarque qu'un président, dans des systèmes « libéraux » comme dans des systèmes « socialistes », les uns et les autres se réclamant tous de l'Islam.
A ce titre, L’ijmaâ, ou consensus général, apparaît comme une issue providentielle de légitimation de pouvoirs islamiques différents. Il est pourtant contesté par bien des Etats, mais néanmoins admis de façon restrictive qui se limite aux conditions propres à chaque pays. Or, par la transposition référendaire qu'on peut en faire, il entraîne juridiquement des obligations précises. Surtout quand on l'assimile à la « Choura » ou consultation populaire recommandée par le Coran. Il entre ainsi dans l'impressionnant arsenal du Fiqh (supra, I.c). D'où il ressort qu'une légalité étatique doit, pour être conforme à la légitimité islamique, reposer sur un contrat de pouvoir et la capacité de gouverner (supra, II. a-b). Le corollaire en est la sauvegarde de l'intérêt général de toute la Communauté. Dans le cas contraire « le trouble se met dans les affaires », écrit Ibn Taimiya. Il en découle de graves indispositions pour la collectivité et une cause de déchéance pour les gouvernants. La conséquence en est une rupture du contrat de pouvoir largement prévue par toutes les théories politiques islamiques. Notamment, lorsque ceux qui ont en charge de veiller à l'intérêt de la Communauté (Oumma) se complaisent « aux actions blâmables en prenant le désir pour maître et la passion pour guide », écrit El-Mawerdi. C'est à ce niveau que l'Histoire de l'Islam a enregistré des malversations dans les légalités étatiques ayant entraîné des conflits d'appréciation avec la légitimité islamique. Il s'en est suivi parfois de tragiques revirements, mais aussi, selon les circonstances, de réelles résurgences. Ruptures et régulations ont ainsi caractérisé toute l'histoire politique de l'Islam.
__________________
Notes bibliographiques
[1] El-Mawerdi (Abou-1-Hassan), Le Droit du Califat, traduit de l'arabe par Léon Ostrorog, Paris, Ed. Leroux, 1925, in-12, 185 p. (Ed. nouvelle de Langue arabe, Beyrouth, 1978).
[2] Ibn Taimiya (Ahmed), Traité de Droit public (musulman), traduit de l'arabe par Henri Laoust, Beyrouth, 1948, in-8°, 224 p. (Ed. nouvelle de Langue arabe, s.l.n.d.).
Notes bibliographiques
[1] El-Mawerdi (Abou-1-Hassan), Le Droit du Califat, traduit de l'arabe par Léon Ostrorog, Paris, Ed. Leroux, 1925, in-12, 185 p. (Ed. nouvelle de Langue arabe, Beyrouth, 1978).
[2] Ibn Taimiya (Ahmed), Traité de Droit public (musulman), traduit de l'arabe par Henri Laoust, Beyrouth, 1948, in-8°, 224 p. (Ed. nouvelle de Langue arabe, s.l.n.d.).











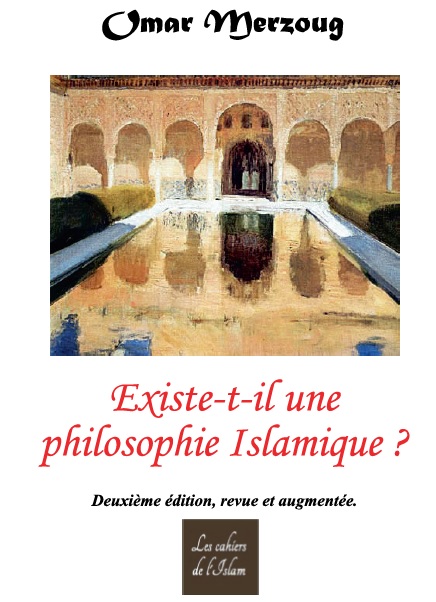












![La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane [Extrait] La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane [Extrait]](https://www.lescahiersdelislam.fr/photo/art/imagette_16_9/87789924-62224472.jpg?v=1746139916)









