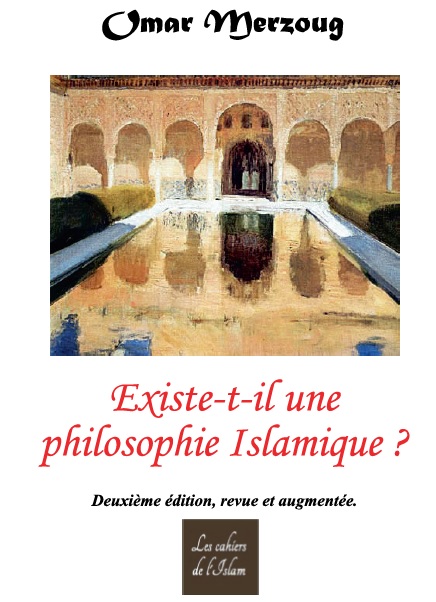La politique américaine peut-elle encore influer sur les enjeux géopolitique, sécuritaire et économique au Moyen-Orient? L'Amérique a-t-elle encore un rôle à jouer dans le conflit Israëlo-Palestiennien et, plus généralement, dans les relations israëlo-arabes? Cette Rencontre avec Mamduh Nayouf tente ainsi de faire le point sur ces questions liées à la politique américaine au Moyen-Orient et s'interroge sur le probable déclin de l'influence des Etats-Unis dans cette partie du monde.

Mamduh NAYOUF
Sociologue et politologue, spécialiste des cultures et sociétés du monde arabo-musulman. Il est l'auteur de Vers le déclin de l'influence américaine au Moyen-Orient ? (L'Harmattant, 2014).
Les Cahiers de l'Islam : Pouvez-vous nous livrer quelques données historiques relatives à l’influence américaine au Moyen-Orient ?
Mamduh Nayouf : L’évolution du Moyen-Orient est historiquement liée à une série d’occupations et d’ingérences politiques et économiques par de grandes puissances dominantes dans les affaires des peuples dominés. Marquée pendant des siècles par l’émergence et le déclin de plusieurs Empires, cette région demeure parmi les plus vitales et les plus déstabilisées dans le monde. Lorsque les États-Unis s’y imposent à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, ils perçoivent cette région du monde a voir sous un angle totalement stratégique : faire face à la menace grandissante de l’URSS et endiguer ses ambitions dans l’ensemble de la région, en Iran et en Turquie en particulier. Il ne faut pas oublier le facteur pétrolier bien évidemment, et particulièrement celui de l’Arabie saoudite qui se situe au centre des intérêts américains. Lorsqu’Ibn Saoud, fondateur de l’Arabie saoudite, décide de compenser la présence britannique par celle des États-Unis, le rapprochement entre le Royaume wahhabite et les Américains à partir des années 1930 se fera au détriment de l’influence anglaise dans la péninsule arabique. En 1933, ils signent un accord historique sur la prospection pétrolière et c’est la compagnie américaine Standard Oil of California (Socal) qui obtient le droit de prospecter la région. La Socal s’associe avec Texaco, donnant naissance au géant pétrolier Arabian-American Oil Company (Aramco). Force est de constater que cet accord ne signifie pas la fin de l’isolement américain dans l’entre-deux-guerres dû au fait que le Congrès américain refuse de ratifier le traité de Versailles du 28 juin 1919, ce qui empêche les États-Unis d’entrer dans la Société des Nations. L’acte du pouvoir législatif américain entrave la politique internationaliste du président Wilson qui a affiché sa sympathie avec les aspirations arabes et leur droit d’autodétermination ; il affirme dans son douzième point qu’aux régions turques de l’Empire ottoman actuel devaient être assurées la souveraineté et la sécurité ; mais aux autres nations qui sont maintenant sous la domination turque on devrait garantir une sécurité absolue de vie et la pleine possibilité de se développer d’une façon autonome. Suite à ce discours, les peuples du Moyen-Orient considèrent d’un œil favorable les États-Unis, puissance anticoloniale, n’ayant aucune visée impérialiste dans la région. Une majorité d’entre eux en Syrie, au Liban et en Palestine exprime son désir devant la commission américaine King-Crane de voir les États-Unis en tant que puissance mandataire qui les aideraient à effectuer la transition avant l’indépendance (The King-Crane Commission Report, 28 août 1919). Finalement, le rapport de la commission sera ignoré, car l’Amérique n’a pas voulu contrecarrer la France et la Grande-Bretagne en quête de contrôler la région.
En l’absence d’une politique américaine officiellement formulée vis-à-vis du Moyen-Orient, tout en maintenant une attitude bien connue - celle de soutenir l’indépendance des pays de la région-, les États-Unis retirent rapidement leurs troupes de la région après la Seconde Guerre. Ils s’opposent au rôle des anciennes puissances coloniales en Libye en 1950-1951, lors de la crise de Suez en 1956, et de la guerre algérienne de libération en 1954-1962. Cependant, il est difficile de placer dans le même cadre le grand appui des dirigeants américains à la création de l’État d’Israël en 1948 (Truman reconnaît Israël le jour de sa déclaration par David Ben Gourion, alors le premier ministre israélien, le 14 mai 1948). Cette décision américaine vient au moment où les États-Unis s’étaient déjà résolus à considérer le Moyen-Orient à travers les lunettes de la guerre froide ; une région dorénavant vitale pour leurs intérêts. Lisons la définition de David S. Painter qui explique la vision américaine fondée substantiellement sur la lutte contre le communisme : Un Moyen-Orient stable, ami des Occidentaux, constitue un môle de protection entre la Russie et les intérêts occidentaux dans la région. Si le Moyen-Orient se tournait vers la l’URSS, la position de la Turquie deviendrait intenable et l’Ouest perdrait le contrôle du pétrole du Moyen-Orient. La volonté des États-Unis d’accroître leur influence dans la région peut être démontrée par les doctrines présidentielles américaines devenant une tradition depuis 1947 : de l’endiguement et de la défense du monde libre de Truman à la théorie des dominos et d’Eisenhower – dont une de ses applications est de combler le vide délaissé par la France et la Grande-Bretagne au Moyen-Orient avant de l’être par l’URSS -, en passant par celle de Carter considérant le Golfe persique comme une zone d’intérêts vitaux pour les États-Unis, et l’Empire du mal de Reagan, toutes avaient pour but de contrer la menace communiste. Dans ce contexte, les États-Unis surveillent le rapprochement entre les pays arabes dirigés par des régimes socialistes comme la Syrie et l’Égypte, ils n’hésitent à venir en aide à leurs alliées comme c’était le cas avec le roi Hussein de Jordanie menacé alors par les Palestiniens soutenus par la Syrie et l’Égypte de Nasser. L’influence américaine semble évidente, voire prédominante pendant et après la guerre froide, au moins en ce qui concerne trois axes prioritaires : le pétrole, la sécurité d’Israël et l’alliance avec les États-clés de la région. À titre d’exemple, en dépit de la structure autoritaire de leurs régimes, les États-Unis considèrent que leurs intérêts stratégiques nécessitent de développer des relations strictes avec les États arabes « modérés » comme l’Arabie saoudite et les pays du Golfe, la Jordanie, le Maroc et l’Égypte d’après Nasser.
À l’issue de la guerre froide, le pouvoir des États-Unis dans le monde et au Moyen-Orient se trouve renforcé. Ils n’ont aucune difficulté à mener en janvier 1991 une coalition de 29 pays sous l’égide de l’ONU afin de chasser du Koweït les troupes irakiennes de Saddam Hussein. Cette guerre va avoir pour conséquences de consolider les intérêts américains dans la région : assurer davantage la distribution internationale de la production pétrolière arabe ; garantir une présence militaire considérable en Arabie saoudite, au Koweït, en Jordanie et aux émirats du Golfe ; améliorer les relations avec des pays problématiques comme la Syrie ; et permettre aux États-Unis de persuader les États arabes, Israël et une délégation palestinienne d’entamer des négociations directes pour résoudre le conflit israélo-arabe. Ceci dit, il faut dire aussi que dans le Nouvel Ordre mondial, les États-Unis sont confrontés à de nouveaux défis dont endiguer les menaces que font les rogue States (l’Iran, l’Iraq et la Libye) ; lutter contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Mamduh Nayouf : L’évolution du Moyen-Orient est historiquement liée à une série d’occupations et d’ingérences politiques et économiques par de grandes puissances dominantes dans les affaires des peuples dominés. Marquée pendant des siècles par l’émergence et le déclin de plusieurs Empires, cette région demeure parmi les plus vitales et les plus déstabilisées dans le monde. Lorsque les États-Unis s’y imposent à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, ils perçoivent cette région du monde a voir sous un angle totalement stratégique : faire face à la menace grandissante de l’URSS et endiguer ses ambitions dans l’ensemble de la région, en Iran et en Turquie en particulier. Il ne faut pas oublier le facteur pétrolier bien évidemment, et particulièrement celui de l’Arabie saoudite qui se situe au centre des intérêts américains. Lorsqu’Ibn Saoud, fondateur de l’Arabie saoudite, décide de compenser la présence britannique par celle des États-Unis, le rapprochement entre le Royaume wahhabite et les Américains à partir des années 1930 se fera au détriment de l’influence anglaise dans la péninsule arabique. En 1933, ils signent un accord historique sur la prospection pétrolière et c’est la compagnie américaine Standard Oil of California (Socal) qui obtient le droit de prospecter la région. La Socal s’associe avec Texaco, donnant naissance au géant pétrolier Arabian-American Oil Company (Aramco). Force est de constater que cet accord ne signifie pas la fin de l’isolement américain dans l’entre-deux-guerres dû au fait que le Congrès américain refuse de ratifier le traité de Versailles du 28 juin 1919, ce qui empêche les États-Unis d’entrer dans la Société des Nations. L’acte du pouvoir législatif américain entrave la politique internationaliste du président Wilson qui a affiché sa sympathie avec les aspirations arabes et leur droit d’autodétermination ; il affirme dans son douzième point qu’aux régions turques de l’Empire ottoman actuel devaient être assurées la souveraineté et la sécurité ; mais aux autres nations qui sont maintenant sous la domination turque on devrait garantir une sécurité absolue de vie et la pleine possibilité de se développer d’une façon autonome. Suite à ce discours, les peuples du Moyen-Orient considèrent d’un œil favorable les États-Unis, puissance anticoloniale, n’ayant aucune visée impérialiste dans la région. Une majorité d’entre eux en Syrie, au Liban et en Palestine exprime son désir devant la commission américaine King-Crane de voir les États-Unis en tant que puissance mandataire qui les aideraient à effectuer la transition avant l’indépendance (The King-Crane Commission Report, 28 août 1919). Finalement, le rapport de la commission sera ignoré, car l’Amérique n’a pas voulu contrecarrer la France et la Grande-Bretagne en quête de contrôler la région.
En l’absence d’une politique américaine officiellement formulée vis-à-vis du Moyen-Orient, tout en maintenant une attitude bien connue - celle de soutenir l’indépendance des pays de la région-, les États-Unis retirent rapidement leurs troupes de la région après la Seconde Guerre. Ils s’opposent au rôle des anciennes puissances coloniales en Libye en 1950-1951, lors de la crise de Suez en 1956, et de la guerre algérienne de libération en 1954-1962. Cependant, il est difficile de placer dans le même cadre le grand appui des dirigeants américains à la création de l’État d’Israël en 1948 (Truman reconnaît Israël le jour de sa déclaration par David Ben Gourion, alors le premier ministre israélien, le 14 mai 1948). Cette décision américaine vient au moment où les États-Unis s’étaient déjà résolus à considérer le Moyen-Orient à travers les lunettes de la guerre froide ; une région dorénavant vitale pour leurs intérêts. Lisons la définition de David S. Painter qui explique la vision américaine fondée substantiellement sur la lutte contre le communisme : Un Moyen-Orient stable, ami des Occidentaux, constitue un môle de protection entre la Russie et les intérêts occidentaux dans la région. Si le Moyen-Orient se tournait vers la l’URSS, la position de la Turquie deviendrait intenable et l’Ouest perdrait le contrôle du pétrole du Moyen-Orient. La volonté des États-Unis d’accroître leur influence dans la région peut être démontrée par les doctrines présidentielles américaines devenant une tradition depuis 1947 : de l’endiguement et de la défense du monde libre de Truman à la théorie des dominos et d’Eisenhower – dont une de ses applications est de combler le vide délaissé par la France et la Grande-Bretagne au Moyen-Orient avant de l’être par l’URSS -, en passant par celle de Carter considérant le Golfe persique comme une zone d’intérêts vitaux pour les États-Unis, et l’Empire du mal de Reagan, toutes avaient pour but de contrer la menace communiste. Dans ce contexte, les États-Unis surveillent le rapprochement entre les pays arabes dirigés par des régimes socialistes comme la Syrie et l’Égypte, ils n’hésitent à venir en aide à leurs alliées comme c’était le cas avec le roi Hussein de Jordanie menacé alors par les Palestiniens soutenus par la Syrie et l’Égypte de Nasser. L’influence américaine semble évidente, voire prédominante pendant et après la guerre froide, au moins en ce qui concerne trois axes prioritaires : le pétrole, la sécurité d’Israël et l’alliance avec les États-clés de la région. À titre d’exemple, en dépit de la structure autoritaire de leurs régimes, les États-Unis considèrent que leurs intérêts stratégiques nécessitent de développer des relations strictes avec les États arabes « modérés » comme l’Arabie saoudite et les pays du Golfe, la Jordanie, le Maroc et l’Égypte d’après Nasser.
À l’issue de la guerre froide, le pouvoir des États-Unis dans le monde et au Moyen-Orient se trouve renforcé. Ils n’ont aucune difficulté à mener en janvier 1991 une coalition de 29 pays sous l’égide de l’ONU afin de chasser du Koweït les troupes irakiennes de Saddam Hussein. Cette guerre va avoir pour conséquences de consolider les intérêts américains dans la région : assurer davantage la distribution internationale de la production pétrolière arabe ; garantir une présence militaire considérable en Arabie saoudite, au Koweït, en Jordanie et aux émirats du Golfe ; améliorer les relations avec des pays problématiques comme la Syrie ; et permettre aux États-Unis de persuader les États arabes, Israël et une délégation palestinienne d’entamer des négociations directes pour résoudre le conflit israélo-arabe. Ceci dit, il faut dire aussi que dans le Nouvel Ordre mondial, les États-Unis sont confrontés à de nouveaux défis dont endiguer les menaces que font les rogue States (l’Iran, l’Iraq et la Libye) ; lutter contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Les Cahiers de l'Islam : Dans votre dernier ouvrage, vous soulevez la question d’un déclin possible de cette influence : comment l’expliquez-vous ? Date-t-il de la présidence Obama ?
Mamduh Nayouf : La question du déclin américain a été évoquée bien avant l’arrivée d’Obama au bureau ovale, même si certains politologues, comme Fareed Zakaria, préfèrent éviter l’emploi du mot « déclin », mais plutôt l’« émergence du reste» (the rise of the rest). Pour d’autres, comme Parag Khanna dans son ouvrage The Second World : Empires and Influence in The Global Order (2008), les États-Unis se battent aujourd’hui (et ils perdent) face aux autres superpuissances mondiales : l’Union européenne et la Chine. Car tels sont les trois Grands de la géopolitique du XXIe siècle : pas la Russie, vaste étendue en voie de dépeuplement rapide ; ni cet Islam incohérent embourbé dans des guerres intestines ; ni l’Inde qui a plusieurs dizaines d’années de retard sur la Chine, tant en termes de développement que d’appétit stratégique. Dans ce sens, les chiffres publiés par le Fonds monétaire international (FMI) montrent que la part de la Chine dans le PIB mondial a augmenté de 5,20 % à 15,82 % dans la période entre 1987 et 2007, alors que celle des États-Unis a diminué de 21,52 % à 19,31 %. Tout cela pour dire que l’on ne peut pas dissocier la question de l’influence mondiale de l’Amérique de celle aux échelles régionales, en l’occurrence, au Moyen-Orient : l’échec du processus de paix, l’intervention militaire en Iraq - l’agenda de la liberté de l’administration Bush, fortement influencée par les néoconservateurs et les nationalistes, entraîne l’armée américaine dans le bourbier irakien, sans tenir compte des complexités sociales et des réalités politiques et religieuses de la région -, la guerre contre le terrorisme perçue comme une guerre contre l’islam, ce sont des raisons qui ont rendu la posture des États-Unis nettement désavantagée. L’exemple irakien nous montre que les néoconservateurs se sont trompés en prédisant que les chiites de ce pays retourneraient contre la théocratie chiite en Iran et qu’un Iraq proaméricain contrebalancerait la République islamique. Dans l’ère d’après Saddam Hussein, l’Iran réussit à y renforcer considérablement son influence. Les chiites s’affirment en tant que dirigeants légitimes du nouvel Iraq - un rôle d’ailleurs non contesté de la part des Américains - alors que l’Iran se considère comme un allié coreligionnaire et un partenaire stratégique. Un rapport publié en 2007 par the Center for Strategic and International Studies (CSIS) constate que l’Amérique n’est plus considérée comme c’était le cas à la fin de la présidence Clinton, comme une garante régionale de la sécurité, un médiateur efficace et un colosse intellectuel. Certes, elle demeure un grand acteur dans les affaires moyen-orientales, mais il faut admettre qu’elle est moins capable d’y imposer sa volonté.
Obama mesure l’ampleur des défis auxquels l’Amérique est confrontée au Moyen-Orient. Il s’agit des problèmes militaires pressants, des engagements politiques, de la dégradation de son image et du déclin de sa puissance, de l’émergence des puissances régionales, et de la perte de l’autorité morale des États-Unis. Il affiche une bonne volonté de renouer avec le monde musulman ; un atout d’une importance stratégique, premièrement dans la guerre contre le terrorisme et, deuxièmement pour regagner les cœurs et les esprits de ses peuples. Sa politique étrangère réaliste qui prétend à des « résultats transformateurs» s’avérera prudente et inefficace. Son bilan semble trop modeste, sans oublier l’existence d’un fossé manifeste entre sa rhétorique et ses actions. Le point focal de ses efforts en vue de parvenir à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens est le gel des colonies juives dans les territoires occupés. L’administration américaine qui se dit contre la colonisation, dans le même temps, n’intensifie pas ses pressions sur le gouvernement Netanyahu pour y mettre fin. Obama s’efforce de concilier l’engagement américain inébranlable envers la sécurité d’Israël avec sa préférence à la solution de deux États, en précisant que les frontières de l’État hébreu et de la Palestine doivent se baser sur les lignes de démarcation de 1967 dans le cadre d’échanges mutuellement agréés. Plus tard, lorsque Netanyahu rejette la mention d’Obama aux frontières de 1967, ce dernier revient sur ses propos en expliquant devant AIPAC qu’il voulait dire par « des échanges mutuellement agréés » que les deux parties concernées elles-mêmes vont négocier une frontière différente de celle qui existait le 4 juin 1967 ! Il condamne d’ailleurs la stratégie de Mahmoud Abbas visant à faire adhérer son pays aux Nations unies. Pour souligner la contradiction dans l’approche du président américain à l’égard de la situation au Moyen-Orient, il suffit de référer à son discours de 2011 devant l’Assemblée générale de l’ONU, lorsqu’il salue le « Printemps arabe », qui incarne, selon lui, « un temps de transformation formidable », mais s’oppose au droit des Palestiniens à l’autodétermination. En réalité, il est difficile d’imaginer comment l’évolution de sa politique pourrait servir les intérêts américains, en sachant que la cause palestinienne constitue un point fondamental sur lequel les peuples dans le monde arabo-musulman jugent la politique étrangère des États-Unis.
Jusqu’à l’éclatement des soulèvements arabes, l’administration Obama opte pour le statu quo, car, à ses yeux, les mouvements islamistes constitueront une fois au pouvoir une menace pour les intérêts nationaux des États-Unis. Une crainte qui s’est avérée inexacte deux ans après l’arrivée des islamistes au pouvoir en Tunisie, en Égypte et en Lybie. Une réalité qui ne doit pas dissimuler que l’administration démocrate n’ait pas envisagé le scénario des révoltes populaires dans le monde arabe. Un officiel américain déclare au New York Times : « Nous avons consacré plusieurs réunions stratégiques, ces deux dernières années, à la paix au Proche-Orient et à l’endiguement de l’Iran. Et combien d’entre elles ont débattu la possibilité d’une déstabilisation en Égypte ? Aucune. » Les États-Unis se trouvent soudainement en train d’observer le changement en Tunisie et les manifestations submergeant les grandes villes de l’Égypte. Le « Printemps arabe » montre les limites de la puissance américaine et de son influence. L’administration américaine va difficilement suivre le rythme extrêmement rapide de l’évolution de la situation et comprendre profondément le message des millions de gens dans la rue. Le président Obama réoriente sa boussole en ce qui concerne la promotion de la démocratie; partagé entre le pragmatisme et l’idéalisme, sa position reflète la diversité au sein de son équipe de politique étrangère sur les impacts des révoltes. La Syrie et l’Iran sont toujours critiqués à cause de la nature répressive de leurs régimes, alors que le Bahreïn subit beaucoup moins de reproches. L’Arabie saoudite a une valeur stratégique cruciale, ce qui empêche Obama de lui adresser le moindre reproche dans son discours consacré aux nouvelles évolutions au Moyen-Orient. Le traitement sur mesure de la situation, c’est-à-dire pays par pays, qui signifie la reconnaissance des spécificités de chacun d’entre eux, et de leur importance par rapport aux intérêts américains, contribue à élargir le fossé entre les États-Unis et les peuples arabes. Cette approche sélective n’empêche pas l’effondrement de la Lybie et de la Syrie. Les militaires en Égypte refusent toute ingérence étrangère dans les affaires internes de leur pays, tandis que l’abandon de Moubarak par les Américains est loin de plaire à certains alliés régionaux de l’Amérique, surtout à l’Arabie saoudite, ainsi qu’à Israël; habitué à compter sur sa coopération pour la continuation du siège de Gaza et l’encerclement de l’Iran, du Hezbollah et du Hamas. En Syrie, plusieurs facteurs sont à l’origine de l’exclusion de l’option militaire par les États-Unis contre le régime de Bachar el-Assad dont le soutien de la Russie et de la Chine au gouvernement syrien, la mise en garde iranienne contre les conséquences dévastatrices d’une action militaire contre la Syrie, l’échec de la stratégie du Nation building en Iraq, la nature hétérogène de l’opposition syrienne et l’opinion publique américaine peu favorable à une nouvelle intervention militaire au Moyen-Orient.
Au sujet des relations américano-iraniennes, la politique de la « main tendue » d’Obama sera rapidement remplacée par une politique de ligne dure basée sur des sanctions économiques et des tentatives diplomatiques dans le but d’approfondir l’isolement de l’Iran à l’échelle internationale. Cela étant dit, plusieurs obstacles peuvent empêcher que les sanctions produisent un véritable changement dans les décisions de Téhéran. Premièrement, l’existence des États qui se conforment aux paquets de sanctions sans être entièrement convaincus. Prenons le cas de la Chine ; ce pays demeure très actif en matière d’exploration du pétrole iranien et l’Iran représente pour lui le troisième plus grand fournisseur de brut, ainsi que le garant de la stabilité des prix. Deuxièmement, bien que l’économie iranienne soit sans doute affectée, ceci renforce paradoxalement le régime iranien dans son prestige et sa détermination, car les difficultés économiques causées par les sanctions ne sont pas un facteur dominant dans le calcul des coûts et des avantages relatifs au programme nucléaire. En outre, les sanctions imposées par l’UE et l’ONU n’ont pas généré les résultats espérés, même dans le cas de pays plus vulnérables économiquement comme la Syrie. Enfin, en termes géopolitiques, les Iraniens croient être en position régionale forte. Ils tirent profit de la situation déstabilisée dans la région en créant une coalition anti statu quo qui inclut à leurs côtés la Syrie, le Hezbollah et le Hamas (avant que le mouvement palestinien soutienne ouvertement l’opposition syrienne soutenue par la Turquie et le Qatar). Les Iraniens savent qu’un affrontement direct avec les États-Unis peut s’avérer douloureux pour leur pays. C’est pourquoi créer des difficultés pour les Américains et suivre une stratégie d’épuisement à leur égard sont les meilleures façons de rivaliser avec les États-Unis. En 2006, l’administration Bush accuse l’Iran de mener une guerre d’ombre contre la présence militaire américaine en Iraq. Pour les Américains, cela représente un conflit entre deux alliances /systèmes : d’un côté, il y a le statu quo sous la conduite de l’Amérique, qui vise à stabiliser la région sous sa propre hégémonie en construisant des systèmes politiques plus consensuels. De l’autre côté, l’alliance anti statu quo, incarnée par l’Iran, cherche constamment à épuiser les efforts américains. En réalité, leur rivalité dans le but de gagner davantage d’influence est devenue asymétrique, même s’ils manifestent actuellement certaines convergences au sujet de l’État islamique qui contrôle une vaste zone de l’Iraq et de la Syrie et menace à la fois le Kurdistan iraquien et le gouvernement central à Bagdad.
Mamduh Nayouf : La question du déclin américain a été évoquée bien avant l’arrivée d’Obama au bureau ovale, même si certains politologues, comme Fareed Zakaria, préfèrent éviter l’emploi du mot « déclin », mais plutôt l’« émergence du reste» (the rise of the rest). Pour d’autres, comme Parag Khanna dans son ouvrage The Second World : Empires and Influence in The Global Order (2008), les États-Unis se battent aujourd’hui (et ils perdent) face aux autres superpuissances mondiales : l’Union européenne et la Chine. Car tels sont les trois Grands de la géopolitique du XXIe siècle : pas la Russie, vaste étendue en voie de dépeuplement rapide ; ni cet Islam incohérent embourbé dans des guerres intestines ; ni l’Inde qui a plusieurs dizaines d’années de retard sur la Chine, tant en termes de développement que d’appétit stratégique. Dans ce sens, les chiffres publiés par le Fonds monétaire international (FMI) montrent que la part de la Chine dans le PIB mondial a augmenté de 5,20 % à 15,82 % dans la période entre 1987 et 2007, alors que celle des États-Unis a diminué de 21,52 % à 19,31 %. Tout cela pour dire que l’on ne peut pas dissocier la question de l’influence mondiale de l’Amérique de celle aux échelles régionales, en l’occurrence, au Moyen-Orient : l’échec du processus de paix, l’intervention militaire en Iraq - l’agenda de la liberté de l’administration Bush, fortement influencée par les néoconservateurs et les nationalistes, entraîne l’armée américaine dans le bourbier irakien, sans tenir compte des complexités sociales et des réalités politiques et religieuses de la région -, la guerre contre le terrorisme perçue comme une guerre contre l’islam, ce sont des raisons qui ont rendu la posture des États-Unis nettement désavantagée. L’exemple irakien nous montre que les néoconservateurs se sont trompés en prédisant que les chiites de ce pays retourneraient contre la théocratie chiite en Iran et qu’un Iraq proaméricain contrebalancerait la République islamique. Dans l’ère d’après Saddam Hussein, l’Iran réussit à y renforcer considérablement son influence. Les chiites s’affirment en tant que dirigeants légitimes du nouvel Iraq - un rôle d’ailleurs non contesté de la part des Américains - alors que l’Iran se considère comme un allié coreligionnaire et un partenaire stratégique. Un rapport publié en 2007 par the Center for Strategic and International Studies (CSIS) constate que l’Amérique n’est plus considérée comme c’était le cas à la fin de la présidence Clinton, comme une garante régionale de la sécurité, un médiateur efficace et un colosse intellectuel. Certes, elle demeure un grand acteur dans les affaires moyen-orientales, mais il faut admettre qu’elle est moins capable d’y imposer sa volonté.
Obama mesure l’ampleur des défis auxquels l’Amérique est confrontée au Moyen-Orient. Il s’agit des problèmes militaires pressants, des engagements politiques, de la dégradation de son image et du déclin de sa puissance, de l’émergence des puissances régionales, et de la perte de l’autorité morale des États-Unis. Il affiche une bonne volonté de renouer avec le monde musulman ; un atout d’une importance stratégique, premièrement dans la guerre contre le terrorisme et, deuxièmement pour regagner les cœurs et les esprits de ses peuples. Sa politique étrangère réaliste qui prétend à des « résultats transformateurs» s’avérera prudente et inefficace. Son bilan semble trop modeste, sans oublier l’existence d’un fossé manifeste entre sa rhétorique et ses actions. Le point focal de ses efforts en vue de parvenir à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens est le gel des colonies juives dans les territoires occupés. L’administration américaine qui se dit contre la colonisation, dans le même temps, n’intensifie pas ses pressions sur le gouvernement Netanyahu pour y mettre fin. Obama s’efforce de concilier l’engagement américain inébranlable envers la sécurité d’Israël avec sa préférence à la solution de deux États, en précisant que les frontières de l’État hébreu et de la Palestine doivent se baser sur les lignes de démarcation de 1967 dans le cadre d’échanges mutuellement agréés. Plus tard, lorsque Netanyahu rejette la mention d’Obama aux frontières de 1967, ce dernier revient sur ses propos en expliquant devant AIPAC qu’il voulait dire par « des échanges mutuellement agréés » que les deux parties concernées elles-mêmes vont négocier une frontière différente de celle qui existait le 4 juin 1967 ! Il condamne d’ailleurs la stratégie de Mahmoud Abbas visant à faire adhérer son pays aux Nations unies. Pour souligner la contradiction dans l’approche du président américain à l’égard de la situation au Moyen-Orient, il suffit de référer à son discours de 2011 devant l’Assemblée générale de l’ONU, lorsqu’il salue le « Printemps arabe », qui incarne, selon lui, « un temps de transformation formidable », mais s’oppose au droit des Palestiniens à l’autodétermination. En réalité, il est difficile d’imaginer comment l’évolution de sa politique pourrait servir les intérêts américains, en sachant que la cause palestinienne constitue un point fondamental sur lequel les peuples dans le monde arabo-musulman jugent la politique étrangère des États-Unis.
Jusqu’à l’éclatement des soulèvements arabes, l’administration Obama opte pour le statu quo, car, à ses yeux, les mouvements islamistes constitueront une fois au pouvoir une menace pour les intérêts nationaux des États-Unis. Une crainte qui s’est avérée inexacte deux ans après l’arrivée des islamistes au pouvoir en Tunisie, en Égypte et en Lybie. Une réalité qui ne doit pas dissimuler que l’administration démocrate n’ait pas envisagé le scénario des révoltes populaires dans le monde arabe. Un officiel américain déclare au New York Times : « Nous avons consacré plusieurs réunions stratégiques, ces deux dernières années, à la paix au Proche-Orient et à l’endiguement de l’Iran. Et combien d’entre elles ont débattu la possibilité d’une déstabilisation en Égypte ? Aucune. » Les États-Unis se trouvent soudainement en train d’observer le changement en Tunisie et les manifestations submergeant les grandes villes de l’Égypte. Le « Printemps arabe » montre les limites de la puissance américaine et de son influence. L’administration américaine va difficilement suivre le rythme extrêmement rapide de l’évolution de la situation et comprendre profondément le message des millions de gens dans la rue. Le président Obama réoriente sa boussole en ce qui concerne la promotion de la démocratie; partagé entre le pragmatisme et l’idéalisme, sa position reflète la diversité au sein de son équipe de politique étrangère sur les impacts des révoltes. La Syrie et l’Iran sont toujours critiqués à cause de la nature répressive de leurs régimes, alors que le Bahreïn subit beaucoup moins de reproches. L’Arabie saoudite a une valeur stratégique cruciale, ce qui empêche Obama de lui adresser le moindre reproche dans son discours consacré aux nouvelles évolutions au Moyen-Orient. Le traitement sur mesure de la situation, c’est-à-dire pays par pays, qui signifie la reconnaissance des spécificités de chacun d’entre eux, et de leur importance par rapport aux intérêts américains, contribue à élargir le fossé entre les États-Unis et les peuples arabes. Cette approche sélective n’empêche pas l’effondrement de la Lybie et de la Syrie. Les militaires en Égypte refusent toute ingérence étrangère dans les affaires internes de leur pays, tandis que l’abandon de Moubarak par les Américains est loin de plaire à certains alliés régionaux de l’Amérique, surtout à l’Arabie saoudite, ainsi qu’à Israël; habitué à compter sur sa coopération pour la continuation du siège de Gaza et l’encerclement de l’Iran, du Hezbollah et du Hamas. En Syrie, plusieurs facteurs sont à l’origine de l’exclusion de l’option militaire par les États-Unis contre le régime de Bachar el-Assad dont le soutien de la Russie et de la Chine au gouvernement syrien, la mise en garde iranienne contre les conséquences dévastatrices d’une action militaire contre la Syrie, l’échec de la stratégie du Nation building en Iraq, la nature hétérogène de l’opposition syrienne et l’opinion publique américaine peu favorable à une nouvelle intervention militaire au Moyen-Orient.
Au sujet des relations américano-iraniennes, la politique de la « main tendue » d’Obama sera rapidement remplacée par une politique de ligne dure basée sur des sanctions économiques et des tentatives diplomatiques dans le but d’approfondir l’isolement de l’Iran à l’échelle internationale. Cela étant dit, plusieurs obstacles peuvent empêcher que les sanctions produisent un véritable changement dans les décisions de Téhéran. Premièrement, l’existence des États qui se conforment aux paquets de sanctions sans être entièrement convaincus. Prenons le cas de la Chine ; ce pays demeure très actif en matière d’exploration du pétrole iranien et l’Iran représente pour lui le troisième plus grand fournisseur de brut, ainsi que le garant de la stabilité des prix. Deuxièmement, bien que l’économie iranienne soit sans doute affectée, ceci renforce paradoxalement le régime iranien dans son prestige et sa détermination, car les difficultés économiques causées par les sanctions ne sont pas un facteur dominant dans le calcul des coûts et des avantages relatifs au programme nucléaire. En outre, les sanctions imposées par l’UE et l’ONU n’ont pas généré les résultats espérés, même dans le cas de pays plus vulnérables économiquement comme la Syrie. Enfin, en termes géopolitiques, les Iraniens croient être en position régionale forte. Ils tirent profit de la situation déstabilisée dans la région en créant une coalition anti statu quo qui inclut à leurs côtés la Syrie, le Hezbollah et le Hamas (avant que le mouvement palestinien soutienne ouvertement l’opposition syrienne soutenue par la Turquie et le Qatar). Les Iraniens savent qu’un affrontement direct avec les États-Unis peut s’avérer douloureux pour leur pays. C’est pourquoi créer des difficultés pour les Américains et suivre une stratégie d’épuisement à leur égard sont les meilleures façons de rivaliser avec les États-Unis. En 2006, l’administration Bush accuse l’Iran de mener une guerre d’ombre contre la présence militaire américaine en Iraq. Pour les Américains, cela représente un conflit entre deux alliances /systèmes : d’un côté, il y a le statu quo sous la conduite de l’Amérique, qui vise à stabiliser la région sous sa propre hégémonie en construisant des systèmes politiques plus consensuels. De l’autre côté, l’alliance anti statu quo, incarnée par l’Iran, cherche constamment à épuiser les efforts américains. En réalité, leur rivalité dans le but de gagner davantage d’influence est devenue asymétrique, même s’ils manifestent actuellement certaines convergences au sujet de l’État islamique qui contrôle une vaste zone de l’Iraq et de la Syrie et menace à la fois le Kurdistan iraquien et le gouvernement central à Bagdad.
Les Cahiers de l'Islam : Concernant le conflit israélo-palestinien, le magazine l’Express posait la question suivante : « Israël – Palestine : mais où est passée la communauté internationale, » Cette absence de la communauté internationale n’est-elle pas d’abord une défection de la diplomatie et de la médiation américaine ?
Mamduh Nayouf : Effectivement, la communauté internationale demeure impuissante à l’égard de ce conflit. Vous savez, elle est loin d’être une entité homogène et unie par les mêmes intérêts, ce qui peut nous expliquer pourquoi elle est plus présente et plus dynamique dans certains dossiers internationaux que dans d’autres. Le cas de l’Union européenne, constituant un acteur principal sur la scène internationale, montre l’absence de politique étrangère commune ou de consensus sur le conflit israélo-palestinien. Permettez-moi de citer la phrase de Pascal Boniface : « l’Allemagne s’interdit de porter tout jugement sur Israël. Au sein de l’UE, il y a plusieurs lignes qui ne sont pas forcément concordantes, certains étant plus solidaires avec Israël, d’autres étant plus critiques du gouvernement israélien. » Cela dit, l’UE joue activement le rôle d’une « association de bienfaisance », puisqu’elle finance régulièrement la reconstruction de l’infrastructure palestinienne détruite par la machine de guerre d’Israël. Quant au rôle du Quartet (ONU, UE, États-Unis et Russie), il est totalement transparent ; le groupe a démontré à plusieurs reprises son incapacité à convaincre les parties antagonistes de signer un accord final.
À l’origine de l’impuissance de la communauté internationale se trouve également l’implication partiale des États-Unis et leur soutien indéfectible à Israël. Ils ont souvent tendance à agir comme seul médiateur entre les parties protagonistes. La diplomatie américaine continue d’être paralysée au fil des décennies par les contraintes de la politique intérieure. Depuis la création de l’État hébreu, les déterminants internes jouent un rôle très influent sur les décisions américaines concernant ce conflit. En tant que président des États-Unis, on est pleinement conscient des coûts politiques élevés inhérents à ce dossier. Les politiciens en général doivent réfléchir à deux fois avant de critiquer Israël, où ils craignent de perdre les voix et l’argent de leurs supporteurs. À cet égard, Obama incarne la règle et non l’exception. Dennis Ross prévient le président avant son discours de 2011 à l’ONU qu’il risque de s’aliéner l’opinion publique israélienne, qu’il doit lui assurer qu’il n’y aura pas de compromis au détriment des intérêts d’Israël. Bien que l’exécutif soit une institution très puissante, il n’en demeure pas moins que le Congrès lie parfois les mains du président et limite ses options. En mars 2010, en contraste avec l’attitude de la Maison-Blanche, le Congrès accueille chaleureusement Netanyahu. Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants, se distancie de son allié Obama et fait part à Netanyahu de l’entier soutien du Congrès. Ce dernier assure le dirigeant israélien que le mémorandum d’accord de 30 milliards de dollars sur dix ans est solide. Les relations constantes entre le gouvernement israélien et le parti républicain, majoritaire dans la Chambre des représentants à la suite des élections de mi-mandat en 2010, ont compliqué les efforts diplomatiques visant à créer un État palestinien, de même qu’elles ont contribué à limiter la capacité d’Obama à exercer une pression sur Netanyahu afin de geler la colonisation. Car la popularité du premier ministre israélien est plus forte que jamais au Congrès. Encore une fois, la continuité structurelle du système politique américain s’affirme comme le facteur qui freine la progression vers la paix et contribue à l’échec de la politique étrangère américaine à l’égard de ce conflit interminable.
Mamduh Nayouf : Effectivement, la communauté internationale demeure impuissante à l’égard de ce conflit. Vous savez, elle est loin d’être une entité homogène et unie par les mêmes intérêts, ce qui peut nous expliquer pourquoi elle est plus présente et plus dynamique dans certains dossiers internationaux que dans d’autres. Le cas de l’Union européenne, constituant un acteur principal sur la scène internationale, montre l’absence de politique étrangère commune ou de consensus sur le conflit israélo-palestinien. Permettez-moi de citer la phrase de Pascal Boniface : « l’Allemagne s’interdit de porter tout jugement sur Israël. Au sein de l’UE, il y a plusieurs lignes qui ne sont pas forcément concordantes, certains étant plus solidaires avec Israël, d’autres étant plus critiques du gouvernement israélien. » Cela dit, l’UE joue activement le rôle d’une « association de bienfaisance », puisqu’elle finance régulièrement la reconstruction de l’infrastructure palestinienne détruite par la machine de guerre d’Israël. Quant au rôle du Quartet (ONU, UE, États-Unis et Russie), il est totalement transparent ; le groupe a démontré à plusieurs reprises son incapacité à convaincre les parties antagonistes de signer un accord final.
À l’origine de l’impuissance de la communauté internationale se trouve également l’implication partiale des États-Unis et leur soutien indéfectible à Israël. Ils ont souvent tendance à agir comme seul médiateur entre les parties protagonistes. La diplomatie américaine continue d’être paralysée au fil des décennies par les contraintes de la politique intérieure. Depuis la création de l’État hébreu, les déterminants internes jouent un rôle très influent sur les décisions américaines concernant ce conflit. En tant que président des États-Unis, on est pleinement conscient des coûts politiques élevés inhérents à ce dossier. Les politiciens en général doivent réfléchir à deux fois avant de critiquer Israël, où ils craignent de perdre les voix et l’argent de leurs supporteurs. À cet égard, Obama incarne la règle et non l’exception. Dennis Ross prévient le président avant son discours de 2011 à l’ONU qu’il risque de s’aliéner l’opinion publique israélienne, qu’il doit lui assurer qu’il n’y aura pas de compromis au détriment des intérêts d’Israël. Bien que l’exécutif soit une institution très puissante, il n’en demeure pas moins que le Congrès lie parfois les mains du président et limite ses options. En mars 2010, en contraste avec l’attitude de la Maison-Blanche, le Congrès accueille chaleureusement Netanyahu. Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants, se distancie de son allié Obama et fait part à Netanyahu de l’entier soutien du Congrès. Ce dernier assure le dirigeant israélien que le mémorandum d’accord de 30 milliards de dollars sur dix ans est solide. Les relations constantes entre le gouvernement israélien et le parti républicain, majoritaire dans la Chambre des représentants à la suite des élections de mi-mandat en 2010, ont compliqué les efforts diplomatiques visant à créer un État palestinien, de même qu’elles ont contribué à limiter la capacité d’Obama à exercer une pression sur Netanyahu afin de geler la colonisation. Car la popularité du premier ministre israélien est plus forte que jamais au Congrès. Encore une fois, la continuité structurelle du système politique américain s’affirme comme le facteur qui freine la progression vers la paix et contribue à l’échec de la politique étrangère américaine à l’égard de ce conflit interminable.
Les Cahiers de l'Islam : L’Amérique ne conserve-t-elle pas, néanmoins, une influence indirecte dans la région via ces alliés (comme l’Arabie Saoudite et l’Égypte) ?
Mamduh Nayouf : Certes, les États-Unis vont continuer à jouer un rôle important dans les affaires du Moyen-Orient, mais leur influence sera réduite en raison de l’impact croissant des contraintes internes et externes, des limites inhérentes à l’affaiblissement de la puissance américaine, et des résultats des choix de leur politique étrangère. Vous avez évoqué le sujet des relations entre l’Amérique et deux pays arabes classés par Washington dans le « camp des modérés ». Concernant l’Arabie saoudite, la place du facteur pétrolier dans le partenariat stratégique entre le royaume wahhabite et les États-Unis est connue et immuable. Car même si les Américains cherchent à diminuer la dépendance de leur pays vis-à-vis du pétrole saoudien, ceci demeure une source vitale pour la sécurisation du marché pétrolier mondial : un pilier de la politique pétrolière internationale des États-Unis. Les administrations américaines ont toujours vu dans l’Arabie saoudite un rempart contre le communisme et contre l’influence iranienne croissante dans la région. Leur alliance a pu survivre même dans le contexte de l’après 11 septembre lorsque celle-ci a été mise en cause à la suite des accusations portées contre la monarchie wahhabite d’être la source ou le berceau du terrorisme, l’inspiratrice idéologique et le soutien financier des réseaux islamistes à travers le monde. Rien n’indique qu’une rupture dans leur partenariat pourrait avoir lieu dans les années à venir, même si leurs relations traversent actuellement une période de tensions en raison de ce que les Saoudiens considèrent une attitude passive et hésitante de l’administration Obama face à certains dossiers régionaux, dont ceux de la guerre en Syrie et du programme nucléaire iranien :
10% seulement de l’aide américaine annuelle à l’Égypte, estimée à 2 milliards de dollars, est consacrée au secteur civil, le reste va au secteur militaire, un pilier fondamental du régime de Moubarak pendant trois décennies, ainsi que de celui de l’après-révolution de 2011. L’armée égyptienne destitue deux présidents de la République entre 2011 et 2013. Le traité de paix israélo-égyptien de 1978 accorde à l’Égypte un statut privilégié dans ses relations avec les États-Unis. Après le 11 septembre, Moubarak rejoint l’administration Bush dans sa guerre contre le terrorisme. Cependant, l’agenda de la démocratie de Bush et ses appels à l’Égypte pour faire des réformes provoquent un net refroidissement dans leurs relations. L’obtention par les Frères musulmans de 20 % de sièges en 2005, et la victoire du Hamas dans les élections palestiniennes en 2006, renforcent à Washington la crainte que les islamistes prennent les choses en main et sabotent les réformes démocratiques. Dans ce contexte, Moubarak considère son régime comme bastion contre l’extrémisme islamiste et un allié de confiance à Washington. Finalement, les pressions américaines sont allégées, même si les relations entre les deux pays demeurent tendues. L’élection de l’islamiste Mohamed Morsi à la tête de l’État égyptien en 2012 ne porte pas atteinte aux intérêts américains, voire son gouvernement exprime son désir de continuer le partenariat stratégique avec les États-Unis. En dépit du refroidissement dans les relations avec Israël et le soutien du gouvernement des Frères musulmans au Hamas, l’accord de paix avec l’État hébreu n’a pas été mis en cause. Il soutient l’intervention de l’OTAN contre Kadhafi. Quant à l’anti-américanisme des Frères musulmans, il est possible de dire que leur pragmatisme est susceptible parfois de trancher sur leur veine idéologique. La destitution de Morsi par l’armée le 3 juillet 2013 et la répression sanglante visant ses partisans entraînent le gel partiel de l’aide américaine au Caire. La question qui se pose : la tension actuelle dans les relations américano-égyptiennes ne risque-t-elle pas de mettre en danger leur partenariat stratégique ? En dénonçant cette « mauvaise décision » de l’administration Obama, le Caire n’a pas manqué de volonté à consolider les liens militaires et économiques avec un autre acteur international incontournable : la Russie. Il s’est retourné vers l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui sont tous les deux hostiles aux Frères musulmans et partisans au futur président Abdel Fattah el-Sissi (en juillet 2013, Riyad et Abu Dhabi avaient annoncé l'octroi d'une aide financière de 12 milliards de dollars au nouveau régime. En octobre, 50 % de l'aide avait été décaissée, sous forme de livraisons de pétrole et de gaz, de dons pour des projets et d'un important dépôt bancaire, Le Point, 10 juin 2014). Cependant, il est défavorable actuellement aux intérêts économiques et sécuritaires de l’Égypte de renoncer à l’aide américaine annuelle. En ce qui concerne les États-Unis, le partenariat avec l’Égypte demeure fondamental pour deux raisons : maintenir le traité de paix entre l’Égypte et Israël et éviter d’aller à l’encontre de la volonté de l’armée américaine très favorable à la poursuite de l’aide militaire.
Mamduh Nayouf : Certes, les États-Unis vont continuer à jouer un rôle important dans les affaires du Moyen-Orient, mais leur influence sera réduite en raison de l’impact croissant des contraintes internes et externes, des limites inhérentes à l’affaiblissement de la puissance américaine, et des résultats des choix de leur politique étrangère. Vous avez évoqué le sujet des relations entre l’Amérique et deux pays arabes classés par Washington dans le « camp des modérés ». Concernant l’Arabie saoudite, la place du facteur pétrolier dans le partenariat stratégique entre le royaume wahhabite et les États-Unis est connue et immuable. Car même si les Américains cherchent à diminuer la dépendance de leur pays vis-à-vis du pétrole saoudien, ceci demeure une source vitale pour la sécurisation du marché pétrolier mondial : un pilier de la politique pétrolière internationale des États-Unis. Les administrations américaines ont toujours vu dans l’Arabie saoudite un rempart contre le communisme et contre l’influence iranienne croissante dans la région. Leur alliance a pu survivre même dans le contexte de l’après 11 septembre lorsque celle-ci a été mise en cause à la suite des accusations portées contre la monarchie wahhabite d’être la source ou le berceau du terrorisme, l’inspiratrice idéologique et le soutien financier des réseaux islamistes à travers le monde. Rien n’indique qu’une rupture dans leur partenariat pourrait avoir lieu dans les années à venir, même si leurs relations traversent actuellement une période de tensions en raison de ce que les Saoudiens considèrent une attitude passive et hésitante de l’administration Obama face à certains dossiers régionaux, dont ceux de la guerre en Syrie et du programme nucléaire iranien :
- Pour eux, la non-intervention militaire américaine contre le régime de Bachar el-Assad ne fait que prolonger la guerre et renforcer la position de l’Iran chiite en Syrie ;
- Ils se montrent peu enthousiastes à accepter la politique de dual-trac d’Obama basée sur une approche alliant le dialogue à la fermeté avec l’Iran, et jugent nécessaire pour les États-Unis de garder l’option militaire sur la table.
10% seulement de l’aide américaine annuelle à l’Égypte, estimée à 2 milliards de dollars, est consacrée au secteur civil, le reste va au secteur militaire, un pilier fondamental du régime de Moubarak pendant trois décennies, ainsi que de celui de l’après-révolution de 2011. L’armée égyptienne destitue deux présidents de la République entre 2011 et 2013. Le traité de paix israélo-égyptien de 1978 accorde à l’Égypte un statut privilégié dans ses relations avec les États-Unis. Après le 11 septembre, Moubarak rejoint l’administration Bush dans sa guerre contre le terrorisme. Cependant, l’agenda de la démocratie de Bush et ses appels à l’Égypte pour faire des réformes provoquent un net refroidissement dans leurs relations. L’obtention par les Frères musulmans de 20 % de sièges en 2005, et la victoire du Hamas dans les élections palestiniennes en 2006, renforcent à Washington la crainte que les islamistes prennent les choses en main et sabotent les réformes démocratiques. Dans ce contexte, Moubarak considère son régime comme bastion contre l’extrémisme islamiste et un allié de confiance à Washington. Finalement, les pressions américaines sont allégées, même si les relations entre les deux pays demeurent tendues. L’élection de l’islamiste Mohamed Morsi à la tête de l’État égyptien en 2012 ne porte pas atteinte aux intérêts américains, voire son gouvernement exprime son désir de continuer le partenariat stratégique avec les États-Unis. En dépit du refroidissement dans les relations avec Israël et le soutien du gouvernement des Frères musulmans au Hamas, l’accord de paix avec l’État hébreu n’a pas été mis en cause. Il soutient l’intervention de l’OTAN contre Kadhafi. Quant à l’anti-américanisme des Frères musulmans, il est possible de dire que leur pragmatisme est susceptible parfois de trancher sur leur veine idéologique. La destitution de Morsi par l’armée le 3 juillet 2013 et la répression sanglante visant ses partisans entraînent le gel partiel de l’aide américaine au Caire. La question qui se pose : la tension actuelle dans les relations américano-égyptiennes ne risque-t-elle pas de mettre en danger leur partenariat stratégique ? En dénonçant cette « mauvaise décision » de l’administration Obama, le Caire n’a pas manqué de volonté à consolider les liens militaires et économiques avec un autre acteur international incontournable : la Russie. Il s’est retourné vers l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui sont tous les deux hostiles aux Frères musulmans et partisans au futur président Abdel Fattah el-Sissi (en juillet 2013, Riyad et Abu Dhabi avaient annoncé l'octroi d'une aide financière de 12 milliards de dollars au nouveau régime. En octobre, 50 % de l'aide avait été décaissée, sous forme de livraisons de pétrole et de gaz, de dons pour des projets et d'un important dépôt bancaire, Le Point, 10 juin 2014). Cependant, il est défavorable actuellement aux intérêts économiques et sécuritaires de l’Égypte de renoncer à l’aide américaine annuelle. En ce qui concerne les États-Unis, le partenariat avec l’Égypte demeure fondamental pour deux raisons : maintenir le traité de paix entre l’Égypte et Israël et éviter d’aller à l’encontre de la volonté de l’armée américaine très favorable à la poursuite de l’aide militaire.