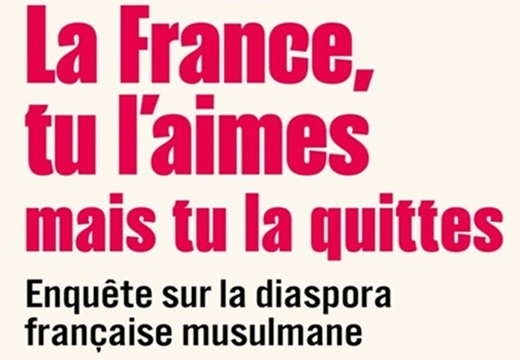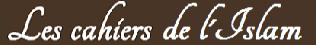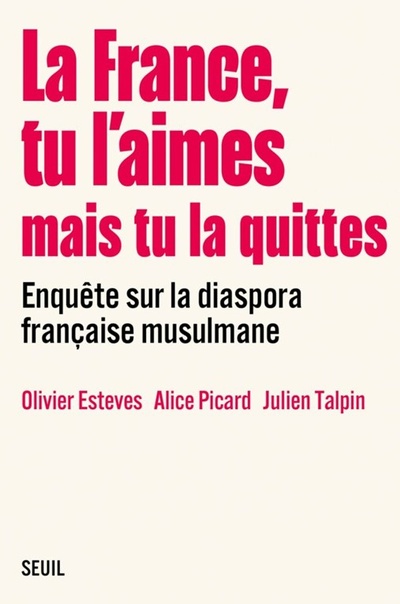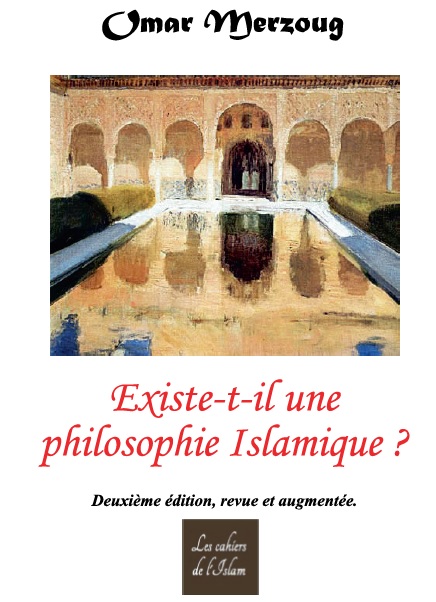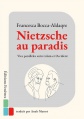Une enquête sociologique sur l'émigration de nombreux jeunes musulmans français, la plupart diplômés, qui ont décidé de quitter la France pour s'installer à Londres, Dubaï, New York, Casablanca ou Bruxelles. Discriminés sur le marché de l'emploi et stigmatisés pour leur religion, leur nom ou leur origine, ils ont trouvé à l'étranger l'ascension sociale qui leur était refusée en France.
©Electre 2024
Publiée en partenariat avec " Liens socio ", Le portail francophone des sciences sociales.
Broché: 320 pages
Editeur : Seuil (26 avril 2024)
Collection : Seuil
Langue : Français
ISBN-13: 978-2021523898
Editeur : Seuil (26 avril 2024)
Collection : Seuil
Langue : Français
ISBN-13: 978-2021523898
Quatrième de couverture
Ils s'appellent Mourad, Samira, Karim, ou bien Sandrine et Vincent.
Ils sont nés et ont grandi partout en France, la plupart sont diplômés de l'enseignement supérieur, mais ils ont décidé de s'installer à Londres, Dubaï, New York, Casablanca, Montréal ou Bruxelles... Discriminés sur le marché de l'emploi et stigmatisés pour leur religion, leur nom ou leur origine, ces Français de culture ou de confession musulmane trouvent à l'étranger l'ascension sociale qui leur était refusée en France, lis y trouvent aussi le « droit à l'indifférence » qui leur permet de se sentir simplement français.
Appuyée sur un échantillon quantitatif de plus de 1 000 personnes et sur 140 entretiens approfondis, cette enquête sociologique sans précédent met au jour pour la première fois un phénomène qui travaille la société française à bas bruit. En interrogeant ces élites minoritaires, elle détaille leur formation, comment elles se sentent et sont perçues comme musulmanes, les raisons de leur départ, le choix des destinations, l'expérience de l'installation et de la vie à l'étranger, le regard qu'elles portent sur la France, leurs perspectives de retour... Ce n'est pas seulement une fuite des cerveaux que l'ouvrage documente : se révèlent en creux les effets délétères de l'islamophobie qui, vue d'ailleurs, semble bel et bien constituer une exception française.
Les auteurs
Olivier Esteves est professeur des universités (université de Lille), spécialiste du monde anglophone, de l'ethnicité et de l'immigration.
Alice Picard est enseignante agrégée de sciences économiques et sociales et chercheuse associée au laboratoire Arènes (UMR 6051).
Julien Talpin est directeur de recherche au CNRS (Ceraps, université de Lille), spécialiste du racisme et de l'engagement dans les quartiers populaires
Alice Picard est enseignante agrégée de sciences économiques et sociales et chercheuse associée au laboratoire Arènes (UMR 6051).
Julien Talpin est directeur de recherche au CNRS (Ceraps, université de Lille), spécialiste du racisme et de l'engagement dans les quartiers populaires
Le lecteur intéressé pourra regarder cette émission de Mediapart "à l'air libre" dans laquelle Olivier Esteves et Julien Talpin présentent leur ouvrage.
Français et musulmans : l'exil comme horizon (https://www.youtube.com/watch?v=EENQttWGylo&t=538s)
Revue de l'ouvrage
Par Anne de Rugy
Devenir français en quittant la France : tel pourrait être le titre de cet ouvrage sociologique qui interroge un phénomène peu étudié et encore moins quantifié, le départ de Français musulmans, envisagé souvent comme durable, vers le Royaume-Uni, le Canada, les Émirats arabes unis, ou encore les États-Unis, l’Europe, le Maghreb ou la Turquie. Un « exode silencieux » titre une émission des Pieds sur terre (France Culture) [1] partant d’un article du New York Times [2] intitulé « The Quiet Flight of Muslims from France » qui faisait état des premiers pas de l’enquête conduite par Olivier Esteves, Alice Picard et Julien Talpin et donnant la parole à quelques-uns de ces émigrés – ou expatriés, car comment les nommer c’est aussi la question. Tiré de cette enquête, le livre se propose de comprendre pourquoi ces Français et Françaises, souvent hautement diplômés, décident, probablement de façon croissante, de quitter leur pays dans une trajectoire d’ascension sociale qui s’apparente à une « fuite des cerveaux » (p. 13).
L’ouvrage vise ainsi à objectiver les raisons de quitter la France et, pour documenter la réalité de cette émigration, s’appuie sur une double enquête composée d’un volet quantitatif et d’un volet qualitatif, conduite entre 2021 et 2023, auprès de musulmans français résidant et travaillant à l’étranger. La difficulté d’une telle enquête tient à l’absence de connaissances préalables sur la population concernée. Aussi, pour atteindre le public cible, les enquêteurs ont lancé en avril 2021 un appel à témoignages, adressé aux Français musulmans partis travailler à l’étranger, conduisant au questionnaire de l’enquête quantitative et, pour celles et ceux qui l’accepteraient, à un possible entretien. L’appel ayant circulé d’abord dans les réseaux militants proches du Collectif contre l’islamophobie en France [3] puis dans des réseaux de Français maghrébins de l’étranger, les répondants ne peuvent être considérés comme un échantillon représentatif de la diaspora musulmane française. Ce biais de sélection contribue sans doute à expliquer que 74 % des répondants, soit nettement plus que pour les musulmans de France de l’enquête Trajectoires et Origines (30 %) [4], considèrent la religion comme un vecteur identitaire (p. 69). Si les résultats de l’enquête quantitative (1 070 répondants) n’autorisent pas de montée en généralité, ils renseignent néanmoins sur les caractéristiques de celles et ceux qui ont été entendus : des Français issus de l’immigration maghrébine majoritairement (68 %), des convertis pour une petite part (17 %), des diplômés du supérieur (81 % ont au moins un diplôme de niveau bac+2 et 54 % de niveau bac+5), des cadres supérieurs pour plus de la moitié (53 %), partis récemment à l’étranger (il y a moins de 5 ans pour 78 %). Ce volet quantitatif est complété par 139 entretiens sur les trajectoires sociales des enquêtés et les motifs de départ.
Les motifs de départ observés mêlent, comme dans tout processus migratoire, des facteurs push et pull (chapitres 2 et 3). Ce qui pousse à partir, c’est d’abord le racisme et les discriminations (71 %) qui se manifestent sous la forme de « micro-agressions » : remarques racistes dès la cour d’école – Khalid, se souvient avoir été traité indifféremment de « sale Arabe », « sale Noir » ou « sale Juif » dans la petite ville du Puy-de-Dôme où il était scolarisé (p. 102) –, blagues qui assignent à la culture du « kebab » (p. 143), rejet (par les voisins ou dans les face-à-face avec l’administration), voire discriminations franches dans le refus de stage ou d’emploi et la « galère de l’embauche » (p. 128) ou encore relégation dans les quartiers les plus pauvres et les établissements scolaires les moins bien dotés. Ces « petits rappels d’altérité » selon l’expression de Choukri Ben Ayed [5] (p. 149) sont vécus comme un « déni de francité » (p. 73) qui empêche de se sentir pleinement à sa place, à l’image de Djamel qui se voit comme « trop arabe pour les blancs » mais « un peu trop francisé pour les Maghrébins et les Noirs » (p. 83). Cette racialisation de la socialisation se conjugue avec ce que les auteurs nomment une « islamophobie d’atmosphère » soit une disqualification des musulmans renvoyés à des caractéristiques négatives (terrorisme, intégrisme, antisémitisme par exemple) étroitement mêlée aux micro-agressions racistes. C’est pour 64 % des enquêtés le deuxième motif de départ : pouvoir vivre sereinement sa religion. Le rejet se traduit dans un climat perçu comme hostile, délétère, malsain, anxiogène, étouffant (autant d’adjectifs qui reviennent dans les entretiens avec les intéressés) à la fois dans les interactions courantes notamment à travers des « blagues » sur le supposé antisémitisme des musulmans, le terrorisme, le ramadan et surtout dans les discours médiatiques et politiques qui nourrissent de continuelles polémiques sur le « problème musulman ». De Brice Hortefeux riant d’« un [arabe], ça va » au projet de déchéance de nationalité du gouvernement Hollande après les attentats de novembre 2015 en passant par les législations sur le voile puis l’abaya, le sentiment qui domine est celui d’être mal aimé, refusé, indésirable et de vivre dans un climat étouffant (p. 256). Face à ces tensions identitaires, une issue : s’en sortir par les études. Ce sont elles qui offrent souvent le premier séjour à l’étranger dans le futur pays d’accueil, sous forme de stage (38 %) ou d’échange Erasmus, autant de contacts préalables au départ (59 % des cas). Là intervient l’effet pull : une embauche facilitée par le profil professionnel de ces diplômes du supérieur, la possibilité d’une « super ligne sur le CV » (p. 135) et de « postes à responsabilités » (p. 52) ou encore d’une expérience anglophone. La mobilité internationale offre la possibilité d’une ascension sociale et d’une mise en adéquation de l’emploi occupé avec les qualifications acquises. La migration est une échappée à l’engluement social (social stuckedness, p. 166) et ouvre une porte de sortie à un avenir perçu comme « confisqué » [6] (p. 164).
Welcome, bienvenue : Nabila, chimiste installée à Montréal, se souvient de l’heureux malentendu lorsqu’une caissière lui dit « bienvenue », une traduction de « you’re welcome », qu’elle prend au pied de la lettre tant elle se sentait bien accueillie au Québec. Le départ change le décor : « enfin je respire », s’intitule le chapitre 4 faisant état d’une « diaspora épanouie » qui vit l’expérience d’une « déstigmatisation » définie par Michèle Lamont [7] comme « le processus par lequel les groupes subalternes ont accès à la reconnaissance et deviennent valorisés dans la société » (cité p. 180). La plus grande facilité à trouver un emploi à la hauteur de ses qualifications ainsi que la plus grande indifférence au fait religieux comme la tolérance à la diversité culturelle sont au cœur de cette expérience qui varie néanmoins fortement selon les pays d’accueil (religion majoritaire, cadre et institutions politiques, langue). Le simple éloignement des polémiques politiques et médiatiques proprement françaises fait effet d’une libération. Mais surtout, la distance géographique modifie le rapport à la nationalité française. Ce rapport ambivalent, vécu comme empêché par le rappel continuel d’une frontière imaginaire entre les « vrais Français » et celles et ceux issus de l’immigration, par la suspicion et les procès en illégitimité se renforce à la fois par le regard de la nouvelle société d’accueil et par l’attachement à un pays qui devient celui de l’enfance, des proches et de la famille. Alors qu’avant le départ, 78 % des enquêtés ne se sentaient pas vus comme français, dans le nouveau pays d’accueil, ils sont renvoyés à cette identité. Ainsi, Fadela dont le nom est ressenti en France comme étant à consonance arabe s’entend dire avec bonheur à Leeds : « Oh, it sounds so French ! » (p. 166). Établie ensuite à Londres et travaillant dans le secteur bancaire, elle se félicite qu’en Angleterre, on lui demande d’apporter fromages et vin sans que le fait qu’elle se contente d’offrir des fromages fasse problème pour quiconque. Imène se réjouit aussi d’être identifiée par ses collègues de Birmingham comme « la Française » et non plus la « femme au foulard » (p. 266). Ce renvoi vécu comme positif à la culture française vaut aussi pour la langue et l’éventuel accent français, qui fait oublier les codes de langage nationaux et le stigmate du supposé « accent de banlieue ». La distance révèle aussi l’attachement à une socialisation française, à une langue, à un climat, en un mot à un pays où résident encore famille, proches et amis – une séparation qui, comme dans toute migration, a un coût. Cet attachement à la France vaut aussi reconnaissance de ce que la France a permis, l’accès aux études supérieures et plus généralement à des services publics de qualité. Le renvoi à l’identité française comme l’éloignement conduisent à la reconstruction d’un lien symbolique positif avec la France. « On n’est jamais autant Français que quand on a quitté la France » (p. 267) affirme Nassim, ingénieur établi à Leicester au Royaume-Uni. Le départ produit paradoxalement une « réconciliation avec la France » (p. 271) et l’impression de devenir « Français à part entière » (p. 213).
Au terme de cet ouvrage qui livre un portrait nuancé de la diaspora française musulmane, on peut interroger la pertinence de l’entrée par la variable religieuse plutôt que par la trajectoire migratoire à la lumière même des résultats de l’enquête qui montrent que le motif religieux, loin d’être central, s’articule avec celui des discriminations et avec la possibilité d’une ascension sociale facilitée. Le parti pris d’une étude de la diaspora musulmane conduit à y inclure une part non négligeable de musulmans convertis (17 %) issus de la population majoritaire pour reprendre la terminologie de l’enquête TeO. Leur inclusion montre d’ailleurs à quel point racialisation des rapports sociaux et islamophobie sont liées puisque leur conversion les renvoie, dans les interactions quotidiennes, au stigmate religieux mais aussi à une arabisation identitaire qui leur fait perdre leur perception sociale comme « blanc ». Elle gomme néanmoins la possibilité d’une étude fine, intergénérationnelle, des trajectoires migratoires des enquêtés. Une entrée dans l’enquête par la trajectoire migratoire permettrait d’envisager plus clairement la possibilité d’une seconde migration ou expatriation des Français issus de l’immigration (ici principalement nord-africaine). En articulant cette dimension migratoire à la dimension de classe, il deviendrait alors possible de compléter ce premier tableau et d’affiner la définition d’une forme française de racialisation des rapports sociaux dans laquelle le rejet de la religion musulmane se conjugue au racisme post-colonial ordinaire. Les ambiguïtés de cette nouvelle émigration en sont le produit tout comme le rapport ambivalent à la France. Enfin, il est une dimension effleurée qui demanderait à être approfondie : le rapport au politique de cette diaspora et le sens politique de cette émigration. La migration constitue un exit par excellence (p. 16). Quel est le sens de ces défections individuelles et comment s’articulent-elles avec une certaine loyauté (notamment à travers la méritocratie et le partage de valeurs managériales, voire libérales) et une prise de parole collective jugée inefficace ? Ces questions, esquissées, ouvrent la possibilité de nouvelles enquêtes.
L’ouvrage vise ainsi à objectiver les raisons de quitter la France et, pour documenter la réalité de cette émigration, s’appuie sur une double enquête composée d’un volet quantitatif et d’un volet qualitatif, conduite entre 2021 et 2023, auprès de musulmans français résidant et travaillant à l’étranger. La difficulté d’une telle enquête tient à l’absence de connaissances préalables sur la population concernée. Aussi, pour atteindre le public cible, les enquêteurs ont lancé en avril 2021 un appel à témoignages, adressé aux Français musulmans partis travailler à l’étranger, conduisant au questionnaire de l’enquête quantitative et, pour celles et ceux qui l’accepteraient, à un possible entretien. L’appel ayant circulé d’abord dans les réseaux militants proches du Collectif contre l’islamophobie en France [3] puis dans des réseaux de Français maghrébins de l’étranger, les répondants ne peuvent être considérés comme un échantillon représentatif de la diaspora musulmane française. Ce biais de sélection contribue sans doute à expliquer que 74 % des répondants, soit nettement plus que pour les musulmans de France de l’enquête Trajectoires et Origines (30 %) [4], considèrent la religion comme un vecteur identitaire (p. 69). Si les résultats de l’enquête quantitative (1 070 répondants) n’autorisent pas de montée en généralité, ils renseignent néanmoins sur les caractéristiques de celles et ceux qui ont été entendus : des Français issus de l’immigration maghrébine majoritairement (68 %), des convertis pour une petite part (17 %), des diplômés du supérieur (81 % ont au moins un diplôme de niveau bac+2 et 54 % de niveau bac+5), des cadres supérieurs pour plus de la moitié (53 %), partis récemment à l’étranger (il y a moins de 5 ans pour 78 %). Ce volet quantitatif est complété par 139 entretiens sur les trajectoires sociales des enquêtés et les motifs de départ.
Les motifs de départ observés mêlent, comme dans tout processus migratoire, des facteurs push et pull (chapitres 2 et 3). Ce qui pousse à partir, c’est d’abord le racisme et les discriminations (71 %) qui se manifestent sous la forme de « micro-agressions » : remarques racistes dès la cour d’école – Khalid, se souvient avoir été traité indifféremment de « sale Arabe », « sale Noir » ou « sale Juif » dans la petite ville du Puy-de-Dôme où il était scolarisé (p. 102) –, blagues qui assignent à la culture du « kebab » (p. 143), rejet (par les voisins ou dans les face-à-face avec l’administration), voire discriminations franches dans le refus de stage ou d’emploi et la « galère de l’embauche » (p. 128) ou encore relégation dans les quartiers les plus pauvres et les établissements scolaires les moins bien dotés. Ces « petits rappels d’altérité » selon l’expression de Choukri Ben Ayed [5] (p. 149) sont vécus comme un « déni de francité » (p. 73) qui empêche de se sentir pleinement à sa place, à l’image de Djamel qui se voit comme « trop arabe pour les blancs » mais « un peu trop francisé pour les Maghrébins et les Noirs » (p. 83). Cette racialisation de la socialisation se conjugue avec ce que les auteurs nomment une « islamophobie d’atmosphère » soit une disqualification des musulmans renvoyés à des caractéristiques négatives (terrorisme, intégrisme, antisémitisme par exemple) étroitement mêlée aux micro-agressions racistes. C’est pour 64 % des enquêtés le deuxième motif de départ : pouvoir vivre sereinement sa religion. Le rejet se traduit dans un climat perçu comme hostile, délétère, malsain, anxiogène, étouffant (autant d’adjectifs qui reviennent dans les entretiens avec les intéressés) à la fois dans les interactions courantes notamment à travers des « blagues » sur le supposé antisémitisme des musulmans, le terrorisme, le ramadan et surtout dans les discours médiatiques et politiques qui nourrissent de continuelles polémiques sur le « problème musulman ». De Brice Hortefeux riant d’« un [arabe], ça va » au projet de déchéance de nationalité du gouvernement Hollande après les attentats de novembre 2015 en passant par les législations sur le voile puis l’abaya, le sentiment qui domine est celui d’être mal aimé, refusé, indésirable et de vivre dans un climat étouffant (p. 256). Face à ces tensions identitaires, une issue : s’en sortir par les études. Ce sont elles qui offrent souvent le premier séjour à l’étranger dans le futur pays d’accueil, sous forme de stage (38 %) ou d’échange Erasmus, autant de contacts préalables au départ (59 % des cas). Là intervient l’effet pull : une embauche facilitée par le profil professionnel de ces diplômes du supérieur, la possibilité d’une « super ligne sur le CV » (p. 135) et de « postes à responsabilités » (p. 52) ou encore d’une expérience anglophone. La mobilité internationale offre la possibilité d’une ascension sociale et d’une mise en adéquation de l’emploi occupé avec les qualifications acquises. La migration est une échappée à l’engluement social (social stuckedness, p. 166) et ouvre une porte de sortie à un avenir perçu comme « confisqué » [6] (p. 164).
Welcome, bienvenue : Nabila, chimiste installée à Montréal, se souvient de l’heureux malentendu lorsqu’une caissière lui dit « bienvenue », une traduction de « you’re welcome », qu’elle prend au pied de la lettre tant elle se sentait bien accueillie au Québec. Le départ change le décor : « enfin je respire », s’intitule le chapitre 4 faisant état d’une « diaspora épanouie » qui vit l’expérience d’une « déstigmatisation » définie par Michèle Lamont [7] comme « le processus par lequel les groupes subalternes ont accès à la reconnaissance et deviennent valorisés dans la société » (cité p. 180). La plus grande facilité à trouver un emploi à la hauteur de ses qualifications ainsi que la plus grande indifférence au fait religieux comme la tolérance à la diversité culturelle sont au cœur de cette expérience qui varie néanmoins fortement selon les pays d’accueil (religion majoritaire, cadre et institutions politiques, langue). Le simple éloignement des polémiques politiques et médiatiques proprement françaises fait effet d’une libération. Mais surtout, la distance géographique modifie le rapport à la nationalité française. Ce rapport ambivalent, vécu comme empêché par le rappel continuel d’une frontière imaginaire entre les « vrais Français » et celles et ceux issus de l’immigration, par la suspicion et les procès en illégitimité se renforce à la fois par le regard de la nouvelle société d’accueil et par l’attachement à un pays qui devient celui de l’enfance, des proches et de la famille. Alors qu’avant le départ, 78 % des enquêtés ne se sentaient pas vus comme français, dans le nouveau pays d’accueil, ils sont renvoyés à cette identité. Ainsi, Fadela dont le nom est ressenti en France comme étant à consonance arabe s’entend dire avec bonheur à Leeds : « Oh, it sounds so French ! » (p. 166). Établie ensuite à Londres et travaillant dans le secteur bancaire, elle se félicite qu’en Angleterre, on lui demande d’apporter fromages et vin sans que le fait qu’elle se contente d’offrir des fromages fasse problème pour quiconque. Imène se réjouit aussi d’être identifiée par ses collègues de Birmingham comme « la Française » et non plus la « femme au foulard » (p. 266). Ce renvoi vécu comme positif à la culture française vaut aussi pour la langue et l’éventuel accent français, qui fait oublier les codes de langage nationaux et le stigmate du supposé « accent de banlieue ». La distance révèle aussi l’attachement à une socialisation française, à une langue, à un climat, en un mot à un pays où résident encore famille, proches et amis – une séparation qui, comme dans toute migration, a un coût. Cet attachement à la France vaut aussi reconnaissance de ce que la France a permis, l’accès aux études supérieures et plus généralement à des services publics de qualité. Le renvoi à l’identité française comme l’éloignement conduisent à la reconstruction d’un lien symbolique positif avec la France. « On n’est jamais autant Français que quand on a quitté la France » (p. 267) affirme Nassim, ingénieur établi à Leicester au Royaume-Uni. Le départ produit paradoxalement une « réconciliation avec la France » (p. 271) et l’impression de devenir « Français à part entière » (p. 213).
Au terme de cet ouvrage qui livre un portrait nuancé de la diaspora française musulmane, on peut interroger la pertinence de l’entrée par la variable religieuse plutôt que par la trajectoire migratoire à la lumière même des résultats de l’enquête qui montrent que le motif religieux, loin d’être central, s’articule avec celui des discriminations et avec la possibilité d’une ascension sociale facilitée. Le parti pris d’une étude de la diaspora musulmane conduit à y inclure une part non négligeable de musulmans convertis (17 %) issus de la population majoritaire pour reprendre la terminologie de l’enquête TeO. Leur inclusion montre d’ailleurs à quel point racialisation des rapports sociaux et islamophobie sont liées puisque leur conversion les renvoie, dans les interactions quotidiennes, au stigmate religieux mais aussi à une arabisation identitaire qui leur fait perdre leur perception sociale comme « blanc ». Elle gomme néanmoins la possibilité d’une étude fine, intergénérationnelle, des trajectoires migratoires des enquêtés. Une entrée dans l’enquête par la trajectoire migratoire permettrait d’envisager plus clairement la possibilité d’une seconde migration ou expatriation des Français issus de l’immigration (ici principalement nord-africaine). En articulant cette dimension migratoire à la dimension de classe, il deviendrait alors possible de compléter ce premier tableau et d’affiner la définition d’une forme française de racialisation des rapports sociaux dans laquelle le rejet de la religion musulmane se conjugue au racisme post-colonial ordinaire. Les ambiguïtés de cette nouvelle émigration en sont le produit tout comme le rapport ambivalent à la France. Enfin, il est une dimension effleurée qui demanderait à être approfondie : le rapport au politique de cette diaspora et le sens politique de cette émigration. La migration constitue un exit par excellence (p. 16). Quel est le sens de ces défections individuelles et comment s’articulent-elles avec une certaine loyauté (notamment à travers la méritocratie et le partage de valeurs managériales, voire libérales) et une prise de parole collective jugée inefficace ? Ces questions, esquissées, ouvrent la possibilité de nouvelles enquêtes.
Anne de Rugy, « Olivier Esteves, Alice Picard, Julien Talpin, La France, tu l’aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 13 décembre 2024, consulté le 08 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org.janus.bis-sorbonne.fr/lectures/66293 ; DOI : https://doi-org.janus.bis-sorbonne.fr/10.4000/12xch
Bibliographie
_____________________
[1] Sonia Kronlund, « L’exode silencieux des Français musulmans », Les pieds sur terre, France Culture, 29 mars 2022 : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/l-exode-silencieux-des-francais-musulmans-8808565
[2] Norimitsu Onishi, Aida Alami, « The Quiet Flight of Muslimas from France », The New York Times, 13 février 2022, disponible à l’adresse suivante: https://www.nytimes.com/2022/02/13/world/europe/france-election-muslims-islam-macron-zemmour-le-pen-pecresse.html
[3] Collectif dissout par le ministre Gérald Darmanin en septembre 2020 et finalement auto-dissout en octobre 2020.
[4] Enquête Trajectoires et Origines, conduite par l’INSEE et l’INED : les données mentionnées dans l’ouvrage concernent TeO1 (2008-2009), les résultats de TeO2 (2019-2020) n’étant pas encore publiés au moment de sa rédaction.
[5] Choukri Ben Ayed, L’école discrimine-t-elle ? Le cas des descendants de l’immigration nord-africaine, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2023.
[6] Nicolas Duvoux, L’Avenir confisqué, Paris, PUF, 2023.
[7] Michèle Lamont, « Addressing Recognition Gaps: Destigmatization and the Reduction of Inequality », American Sociological Review, vol. 83, n° 3, 2018, p .419-444, citation p. 420.
[1] Sonia Kronlund, « L’exode silencieux des Français musulmans », Les pieds sur terre, France Culture, 29 mars 2022 : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/l-exode-silencieux-des-francais-musulmans-8808565
[2] Norimitsu Onishi, Aida Alami, « The Quiet Flight of Muslimas from France », The New York Times, 13 février 2022, disponible à l’adresse suivante: https://www.nytimes.com/2022/02/13/world/europe/france-election-muslims-islam-macron-zemmour-le-pen-pecresse.html
[3] Collectif dissout par le ministre Gérald Darmanin en septembre 2020 et finalement auto-dissout en octobre 2020.
[4] Enquête Trajectoires et Origines, conduite par l’INSEE et l’INED : les données mentionnées dans l’ouvrage concernent TeO1 (2008-2009), les résultats de TeO2 (2019-2020) n’étant pas encore publiés au moment de sa rédaction.
[5] Choukri Ben Ayed, L’école discrimine-t-elle ? Le cas des descendants de l’immigration nord-africaine, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2023.
[6] Nicolas Duvoux, L’Avenir confisqué, Paris, PUF, 2023.
[7] Michèle Lamont, « Addressing Recognition Gaps: Destigmatization and the Reduction of Inequality », American Sociological Review, vol. 83, n° 3, 2018, p .419-444, citation p. 420.