J. Michot propose une synthèse d’une rigueur et d’une exhaustivité exemplaires conduisant à des conclusions précises qui permettent à leur tour de jeter sur la pensée avicennienne un éclairage nouveau et fécond. Convaincu de l’unité réelle de cette philosophie — tout en admettant une évolution doctrinale, p. 24 s. — J.M. rejette la distinction entre traités « ésotériques » d’une part, et le Šifāʾ ou la Naǧāt de l’autre, et donne la démonstration qu’une doctrine avicennienne cohérente sur l’eschatologie peut être mise en relief, malgré les silences et les hésitations d’un traité à un autre.
Pierre Lory
À l'occasion de la disparition du professeur Jean Yahya Michot, nous proposons ici la recension de l'un de ses premiers ouvrages, tiré de sa thèse, traitant de l'eschatologie chez Ibn Sīnā (m. 1037, l'avicenne des latins) et nous semblant toujours d'actualité.
Cette recension a déjà fait l'objet d'une publication dans le Bulletin critique des Annales islamologiques sous licence Creative Commons (BY-NC-SA ).
Cette recension a déjà fait l'objet d'une publication dans le Bulletin critique des Annales islamologiques sous licence Creative Commons (BY-NC-SA ).
Broché: 288 pages
Editeur : Vrin (Janvier 1970)
Collection : Études musulmanes
Langue : Français
ISBN-13: 978-90-6831-071-9
Editeur : Vrin (Janvier 1970)
Collection : Études musulmanes
Langue : Français
ISBN-13: 978-90-6831-071-9
Par Pierre Lory
Pierre Lory
La pensée d’Avicenne a fait l’objet d’études déjà fort nombreuses, en marge ou à l’occasion de(s) millénaire(s) consacré(s) à sa personne et à son œuvre. Mais tous les aspects de cet édifice intellectuel géant n’ont cependant pas été épuisés pour autant. Jean Michot s’est attaqué dans le présent ouvrage à l’un des principaux points controversés de cette philosophie : la conception qu’avait Avicenne de la vie humaine post mortem. Le problème est de taille, c’est d’ailleurs le point litigieux auquel Ġazālī a consacré la XXe question du Tahāfut al-falāsifa. Une simple lecture des textes qu’Avicenne a consacrés à la question du ma' ad montre une large diversité d’affirmations. Tantôt (Šifāʾ, Naǧāt) il accepte l’idée d’une 'forme de résurrection corporelle sur la foi de la révélation prophétique venant combler ici les insuffisances de la raison; ailleurs (al-Risāla al-aḍḥawiyya fi amr al-maʿād) il semble tout simplement nier cette éventualité. Dans une troisième série de textes, il cite la possibilité d’une certaine survie corporelle dans une dimension activée par l’imagination. Faut-il discerner chez cet auteur une évolution doctrinale marquée au cours de sa vie? Ou admettre un décalage entre des textes destinées au grand public et mis en harmonie avec l’orthodoxie sunnite, et des traités plus franchement ésotériques destinés à des disciples philosophes mûrs? Plusieurs chercheurs s’étaient déjà attachés à éclaircir ces différents points (cf. notamment G.C. Anawati, dans Etudes de philosophie musulmane, Vrin, 1974, p. 263-289; et L. Gardet, La pensée religieuse d’Avicenne, Vrin, 1951, p. 86-105). Ici, J. Michot propose une synthèse d’une rigueur et d’une exhaustivité exemplaires conduisant à des conclusions précises qui permettent à leur tour de jeter sur la pensée avicennienne un éclairage nouveau et fécond. Convaincu de l’unité réelle de cette philosophie — tout en admettant une évolution doctrinale, p. 24 s. — J.M. rejette la distinction entre traités « ésotériques » d’une part, et le Šifāʾ ou la Naǧāt de l’autre, et donne la démonstration qu’une doctrine avicennienne cohérente sur l’eschatologie peut être mise en relief, malgré les silences et les hésitations d’un traité à un autre.
Certes, les traités avicenniens consacrés au sort de la personne dans l’au-delà affirment nettement que l’âme est incorruptible, spirituelle, émanant de l’Intellect. Le corps ne lui est qu’un simple support, un instrument destiné à l’accomplissement de son individuation. Et l’âme du philosophe, de l’homme qui a accompli dans le monde sublunaire l’éveil à sa nature réelle, ira tout naturellement rejoindre le monde de l’Intellect pour y connaître une béatitude insurpassable : rien de corporel ne pourra donc lui être utile après sa mort. Mais précisément, souligne J.M., la grande majorité des êtres humains ne sont pas philosophes. Quel sera le destin de cette autre humanité restée accrochée aux représentations matérielles et continuant d’identifier le réel au sensible ? Les joies corporelles que le Coran promet aux bienheureux sont-elles une simple allégorie destinée au vulgaire, et à la limite une duperie à leur endroit (p. 30 s.)? J.M. donne d’emblée la clé de la réponse avicennienne à ces interrogations. Les êtres humains non philosophes revivront dans un monde formel : non plus un monde de formes corporelles grossières de type terrestre toutefois, mais une dimension animée par les formes mêmes de leur ẖayāl — un monde imaginal.
Imaginal et non imaginaire, souligne J.M., qui situe avec rigueur et précision ces données dans la noétique propre à Avicenne. Le replaçant fort opportunément dans la vision de la création comme une descente des épiphanies (taǧalliyāt) comparées à un jeu de miroirs (p. 88 s.), il rappelle qu’il n’y a pas lieu d’opposer un monde sensible sublunaire « réel » à une dimension imaginaire, celle des visions p. ex. : le niveau épiphanique est différent, non le degré de réalité. La matière en elle-même étant inerte, son degré de réalité dépend en fait plutôt de sa conformité aux forces supérieures qui se manifestent par elle. En ce sens, la dimension visionnaire possède même pour celui qui en fait l’expérience un coefficient de réalité supérieur à celle du monde terrestre proprement dit. J.M. consacre ici deux parties (III et IV) au rôle des facultés de la conscience — estimative, imaginative, intellect — notamment chez les prophètes et les visionnaires, dont l’activité permet d’expliciter la nature de ce monde imaginai qu’Avicenne entrevoyait pour la masse des mortels. Les visions des prophètes sont réelles, non illusoires, puisqu’en définitive la perception et l’activité de la conscience ne sont pas fondées uniquement sur la perception des particuliers sensibles, mais sur l’effusion de l’Intellect Agent. Les bienheureux qui verront, entendront, sentiront les objets de joie auxquels ils ont aspiré sur la foi du Coran et de la Sunna, ne seront pas trompés par une illusion semblable au rêve, mais vivront une réalité conforme à l’éveil de leur propre conscience.
Reste la question de la corporéité dévolue aux êtres humains dans leur survie après la mort. J.M. rappelle qu’Avicenne a refusé l’idée d’une nouvelle création sur la base des éléments terrestres, de même qu’il a écarté le rôle joué selon certaines théories par des corps subtils. Il affirme cependant que l’imagination a de quelque manière besoin d’un support corporel. Sans doute a-t-il adhéré à l’idée que ce support pouvait être fourni par des corps célestes (p. 26, 180 s.) tout en se gardant de trancher de façon péremptoire cette délicate question. J.M. précise enfin (p. 198 s.) qu’Avicenne n’avait pas conçu cet au-delà imaginai comme un lieu de séjour définitif pour les pieux croyants non philosophes, mais qu’il pouvait être pour eux l’occasion de se débarrasser de leurs illusions et ignorances sur leur propre nature spirituelle, et ainsi d’accéder à la suprême félicité de l’union à l’Intellect.
Il serait impossible d’évoquer, même succinctement, la richesse des démonstrations de ce livre. (Il s’agit, signalons-le, d’un travail de type doctoral abordant directement la question à un niveau élevé de spécialisation : le lecteur est supposé connaître déjà l’essentiel des données sur la falsafa, sur la vie et sur l’œuvre d’Avicenne.) L’annotation très abondante renvoie principalement aux passages du corpus avicennien concernés, et permet de se rendre compte de l’unité de la pensée étudiée. Ce livre représente en fait une véritable enquête : à partir de passages sibyllins, vagues et dispersés, il reconstitue une eschatologie avicennienne en accord avec l’ensemble de l’œuvre, de la métaphysique à la psychologie. Elle permet du même coup de mieux cerner ce que l’orthodoxie musulmane pouvait reprocher au philosophe. Celui-ci admettait certes la véracité des descriptions coraniques de l’au-delà, et n’en faisait aucunement une allégorie abstraite. En cela, il n’entendait gommer en rien le rôle religieux et historique des prophètes et de Muhammad en particulier. Mais il n’en demeure pas moins que cet au-delà imaginai reste très inférieur à celui qu’atteint le philosophe, dépouillé de toute attache corporelle qui rejoint son pur principe spirituel, dans le sens plein du mot maʿād. Du même coup, la révélation coranique apparaît comme un message utile à son niveau, orientant l’humanité vers l’ordre et le Bien; mais la quête du Vrai reste, elle, l’apanage de la philosophie.
Certes, les traités avicenniens consacrés au sort de la personne dans l’au-delà affirment nettement que l’âme est incorruptible, spirituelle, émanant de l’Intellect. Le corps ne lui est qu’un simple support, un instrument destiné à l’accomplissement de son individuation. Et l’âme du philosophe, de l’homme qui a accompli dans le monde sublunaire l’éveil à sa nature réelle, ira tout naturellement rejoindre le monde de l’Intellect pour y connaître une béatitude insurpassable : rien de corporel ne pourra donc lui être utile après sa mort. Mais précisément, souligne J.M., la grande majorité des êtres humains ne sont pas philosophes. Quel sera le destin de cette autre humanité restée accrochée aux représentations matérielles et continuant d’identifier le réel au sensible ? Les joies corporelles que le Coran promet aux bienheureux sont-elles une simple allégorie destinée au vulgaire, et à la limite une duperie à leur endroit (p. 30 s.)? J.M. donne d’emblée la clé de la réponse avicennienne à ces interrogations. Les êtres humains non philosophes revivront dans un monde formel : non plus un monde de formes corporelles grossières de type terrestre toutefois, mais une dimension animée par les formes mêmes de leur ẖayāl — un monde imaginal.
Imaginal et non imaginaire, souligne J.M., qui situe avec rigueur et précision ces données dans la noétique propre à Avicenne. Le replaçant fort opportunément dans la vision de la création comme une descente des épiphanies (taǧalliyāt) comparées à un jeu de miroirs (p. 88 s.), il rappelle qu’il n’y a pas lieu d’opposer un monde sensible sublunaire « réel » à une dimension imaginaire, celle des visions p. ex. : le niveau épiphanique est différent, non le degré de réalité. La matière en elle-même étant inerte, son degré de réalité dépend en fait plutôt de sa conformité aux forces supérieures qui se manifestent par elle. En ce sens, la dimension visionnaire possède même pour celui qui en fait l’expérience un coefficient de réalité supérieur à celle du monde terrestre proprement dit. J.M. consacre ici deux parties (III et IV) au rôle des facultés de la conscience — estimative, imaginative, intellect — notamment chez les prophètes et les visionnaires, dont l’activité permet d’expliciter la nature de ce monde imaginai qu’Avicenne entrevoyait pour la masse des mortels. Les visions des prophètes sont réelles, non illusoires, puisqu’en définitive la perception et l’activité de la conscience ne sont pas fondées uniquement sur la perception des particuliers sensibles, mais sur l’effusion de l’Intellect Agent. Les bienheureux qui verront, entendront, sentiront les objets de joie auxquels ils ont aspiré sur la foi du Coran et de la Sunna, ne seront pas trompés par une illusion semblable au rêve, mais vivront une réalité conforme à l’éveil de leur propre conscience.
Reste la question de la corporéité dévolue aux êtres humains dans leur survie après la mort. J.M. rappelle qu’Avicenne a refusé l’idée d’une nouvelle création sur la base des éléments terrestres, de même qu’il a écarté le rôle joué selon certaines théories par des corps subtils. Il affirme cependant que l’imagination a de quelque manière besoin d’un support corporel. Sans doute a-t-il adhéré à l’idée que ce support pouvait être fourni par des corps célestes (p. 26, 180 s.) tout en se gardant de trancher de façon péremptoire cette délicate question. J.M. précise enfin (p. 198 s.) qu’Avicenne n’avait pas conçu cet au-delà imaginai comme un lieu de séjour définitif pour les pieux croyants non philosophes, mais qu’il pouvait être pour eux l’occasion de se débarrasser de leurs illusions et ignorances sur leur propre nature spirituelle, et ainsi d’accéder à la suprême félicité de l’union à l’Intellect.
Il serait impossible d’évoquer, même succinctement, la richesse des démonstrations de ce livre. (Il s’agit, signalons-le, d’un travail de type doctoral abordant directement la question à un niveau élevé de spécialisation : le lecteur est supposé connaître déjà l’essentiel des données sur la falsafa, sur la vie et sur l’œuvre d’Avicenne.) L’annotation très abondante renvoie principalement aux passages du corpus avicennien concernés, et permet de se rendre compte de l’unité de la pensée étudiée. Ce livre représente en fait une véritable enquête : à partir de passages sibyllins, vagues et dispersés, il reconstitue une eschatologie avicennienne en accord avec l’ensemble de l’œuvre, de la métaphysique à la psychologie. Elle permet du même coup de mieux cerner ce que l’orthodoxie musulmane pouvait reprocher au philosophe. Celui-ci admettait certes la véracité des descriptions coraniques de l’au-delà, et n’en faisait aucunement une allégorie abstraite. En cela, il n’entendait gommer en rien le rôle religieux et historique des prophètes et de Muhammad en particulier. Mais il n’en demeure pas moins que cet au-delà imaginai reste très inférieur à celui qu’atteint le philosophe, dépouillé de toute attache corporelle qui rejoint son pur principe spirituel, dans le sens plein du mot maʿād. Du même coup, la révélation coranique apparaît comme un message utile à son niveau, orientant l’humanité vers l’ordre et le Bien; mais la quête du Vrai reste, elle, l’apanage de la philosophie.
Pierre Lory
(Université de Bordeaux III)
Pierre Lory est actuellement Directeur d'études émérite à l'EPHE où il a enseigné la mystique et l'ésotérisme médiéval en Islam, membre du Laboratoire d'études sur les monothéismes du CNRS
Pierre Lory est actuellement Directeur d'études émérite à l'EPHE où il a enseigné la mystique et l'ésotérisme médiéval en Islam, membre du Laboratoire d'études sur les monothéismes du CNRS
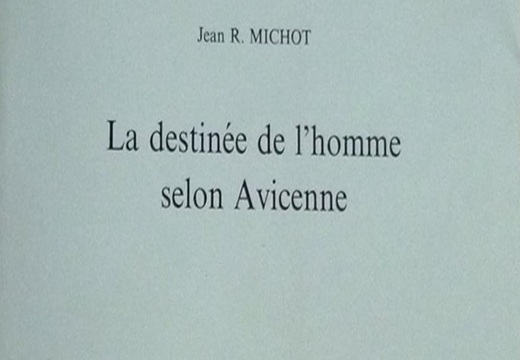
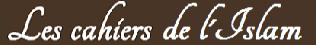


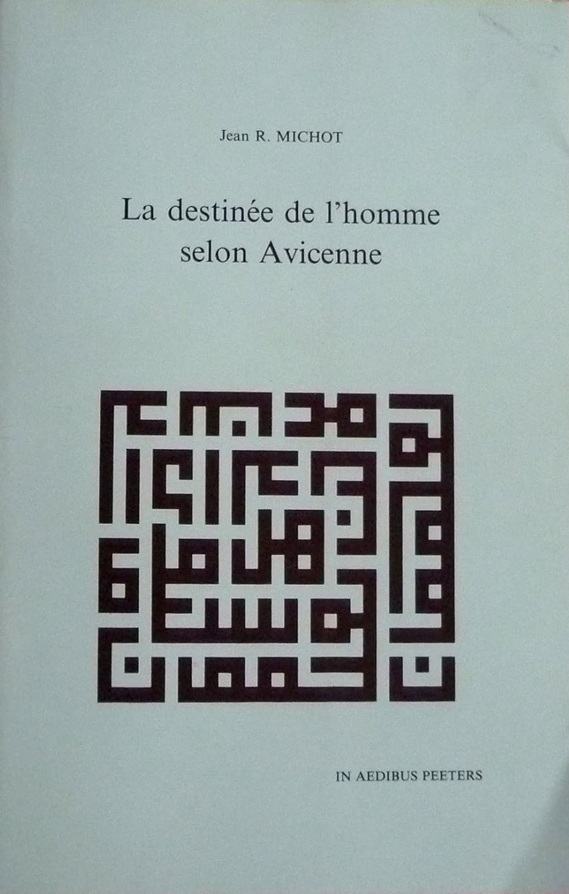
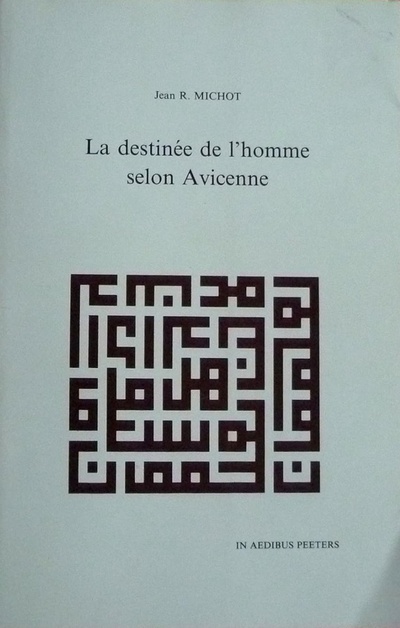
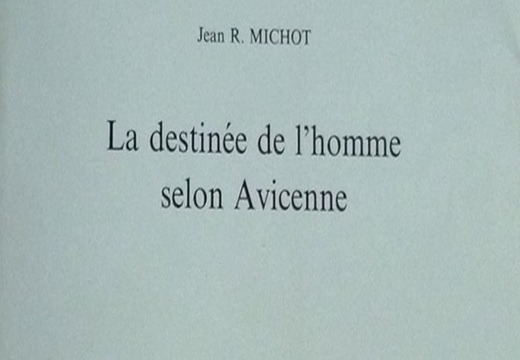









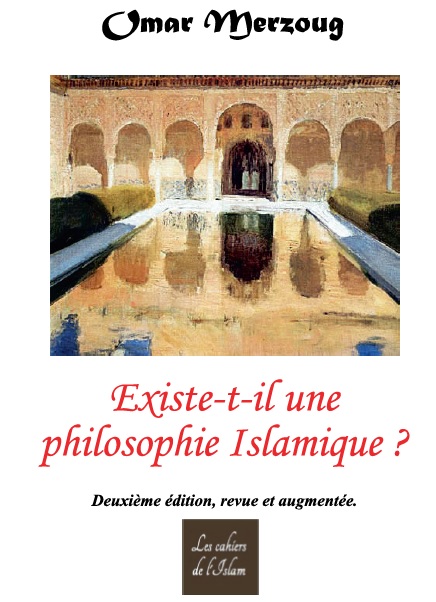



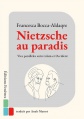








![La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane [Extrait] La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane [Extrait]](https://www.lescahiersdelislam.fr/photo/art/imagette_16_9/87789924-62224472.jpg?v=1746139916)









