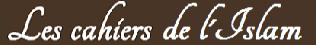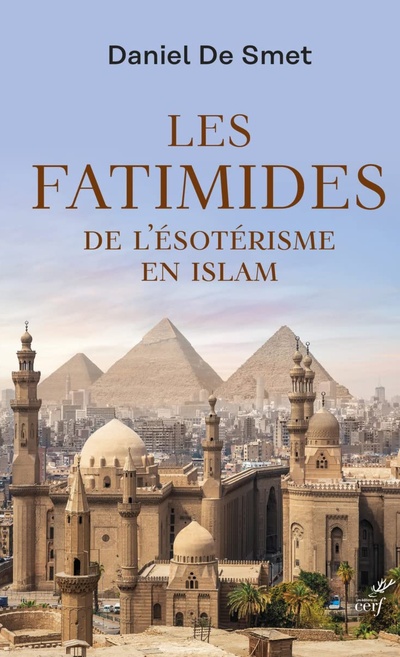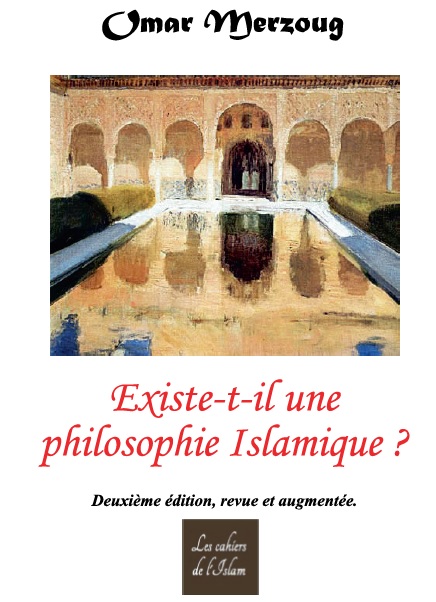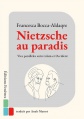Contrairement à ce que le titre laisse penser, la période étudiée déborde largement l’époque du règne de la dynastie shiite ismaélienne fatimide, qui débute en Ifriqiya en 909 et se termine au Caire en 1171,... [...] ...nous ne pouvons que saluer, encore une fois, la rigueur scientifique avec laquelle Daniel De Smet a conduit ses enquêtes dans son travail. On a là un superbe ouvrage, tant par sa facture matérielle, la richesse documentaire des textes commentés et par le soin et l’érudition mis au service des dites enquêtes.
Aziz Hilal
Cette recension a déjà fait l'objet d'une publication dans la Revue MIDEO [En ligne] , 39|2024 sous licence Creative Commons (BY NC ND).
Broché: 265 pages
Editeur : Les éditions du Cerf (1 septembre 2022)
Langue : Français
ISBN-13: 978-2204151535
Editeur : Les éditions du Cerf (1 septembre 2022)
Langue : Français
ISBN-13: 978-2204151535
Quatrième de couverture
Du grand califat shiite et ismaélien qui régna autour de l'an mil de l'Orient à la Sicile, nous ignorons l'essentiel. À savoir son étonnante actualité pour aujourd'hui et pour le renouveau du dialogue des civilisations. Un grand livre d'histoire passée et pourtant contemporaine.
À la fois imam ismaélien, calife fatimide, divinité druze sur terre, la personnalité singulière d'al-Hakim bi-amr Allah (985-1021), véritable personnage de roman, déroule le fil rouge qui relie ismaéliens, Fatimides et Druzes.
Hétérodoxes, situés aux marges de l'islam, prônant la discipline de l'arcane (la taqiyya), forts de leurs rites, ces trois courants ont nourri l'imaginaire, engendré bien des mythes et suscité bien des légendes, dont celle des Assassins, introduite en Occident par les croisés.
Dans cette première grande synthèse en langue française, Daniel De Smet, spécialiste de l'ismaélisme, tente de démêler la réalité historique du merveilleux. Un grand livre d'histoire passée et pourtant contemporaine.
Daniel de Smet est directeur de Recherche au CNRS, Membre statutaire du Laboratoire d’Études sur les Monothéismes, Groupe du Centre d’études des religions du Livre (CERL). Responsable de l’équipe 1, “Livres sacrés : Canons et Hétérodoxies” ses domaines de recherche porte sur la transmission, réception et assimilation de la philosophie grecque tardo-antique dans la pensée arabo-musulmane, en particulier dans le chiisme ismaélien des X e et XI e siècles ainsi que sur la philosophie arabe : noétique et théories de la connaissance ; exégèse philosophique du Coran.
À la fois imam ismaélien, calife fatimide, divinité druze sur terre, la personnalité singulière d'al-Hakim bi-amr Allah (985-1021), véritable personnage de roman, déroule le fil rouge qui relie ismaéliens, Fatimides et Druzes.
Hétérodoxes, situés aux marges de l'islam, prônant la discipline de l'arcane (la taqiyya), forts de leurs rites, ces trois courants ont nourri l'imaginaire, engendré bien des mythes et suscité bien des légendes, dont celle des Assassins, introduite en Occident par les croisés.
Dans cette première grande synthèse en langue française, Daniel De Smet, spécialiste de l'ismaélisme, tente de démêler la réalité historique du merveilleux. Un grand livre d'histoire passée et pourtant contemporaine.
Daniel de Smet est directeur de Recherche au CNRS, Membre statutaire du Laboratoire d’Études sur les Monothéismes, Groupe du Centre d’études des religions du Livre (CERL). Responsable de l’équipe 1, “Livres sacrés : Canons et Hétérodoxies” ses domaines de recherche porte sur la transmission, réception et assimilation de la philosophie grecque tardo-antique dans la pensée arabo-musulmane, en particulier dans le chiisme ismaélien des X e et XI e siècles ainsi que sur la philosophie arabe : noétique et théories de la connaissance ; exégèse philosophique du Coran.
Daniel de Smet tente de répondre à la question "Qu'est ce que l'Ismaélisme ?" pour le Campus Lumières d'Islam
Recension
Par Aziz Hilal
Cet intéressant ouvrage comprend onze chapitres qui sont basés sur onze articles publiés antérieurement, mais revus et remaniés, comme le précise l’auteur (p. 8). Contrairement à ce que le titre laisse penser, la période étudiée déborde largement l’époque du règne de la dynastie shiite ismaélienne fatimide, qui débute en Ifriqiya en 909 et se termine au Caire en 1171, puisque quatre de ces chapitres (8, 9, 10 et 11) portent sur cette postérité spirituelle fatimide qu’est la religion druze. Il faut souligner la diversité des thèmes abordés dans ce recueil. L’élément religieux y domine avec six chapitres (4, 5, 6, 7, 8 et 9), suivi de l’élément historique avec trois chapitres (1, 10 et 11) et enfin de l’élément social avec deux chapitres (2 et 3).
L’A. souligne dans l’introduction (p. 11-30) trois moments propres à la naissance de la dynastie fatimide. Le premier moment, qu’il appelle « une origine nimbée de légendes », reprend les grandes lignes d’une étude antérieure de l’A.[1] et évoque les débuts douloureux de la daʿwa fatimide, très souvent placée sous le signe de la taqiyya (dissimulation), ce « qui explique le manque cruel de sources fiables sur les débuts du mouvement ismaélien » (p. 11). La source principale de l’A. pour évoquer le début de cette daʿwa est un pamphlet rédigé à Damas en 372/982 par un dénommé Aḫū Muḥsin. Ce pamphlet est plus que troublant, vu qu’il présente les Fatimides comme des imposteurs qui descendent non de ʿAlī et de Fāṭima, mais d’un « occultiste » iranien nommé ʿAbd Allāh, fils de Maymūn al-Qaḍḍāḥ, disciple de l’hérésiarque Bardésane et proche de l’ultra-shiite Abū al-Ḫaṭṭāb[2]. Curieusement, les Fatimides ont intégré le nom de ce ʿAbd Allāh, fils de Maymūn al-Qaḍḍāḥ, dans leur tradition. Par mesure de sécurité et pour masquer leur véritable identité, les ancêtres des Fatimides ont toujours adopté des pseudonymes : Maymūn al-Qaḍḍāḥ ne serait en fait que le petit-fils de l’imam éponyme des ismaéliens Ǧaʿfar al-Ṣādiq. Son fils ʿAbd Allāh, qui sera le premier calife fatimide, porte le pseudonyme de Saʿīd et tous les missionnaires qu’il envoie aux quatre coins du monde portent des pseudonymes propres à brouiller toutes les pistes et à dérouter le plus aguerri des historiens.
Plus importante est la fondation, sur la côte tunisienne, de la première capitale fatimide, Mahdiyya. Cette fondation a été vécue comme un événement messianique marquant un tournant radical dans l’histoire de l’islam, depuis la mort du Prophète. ʿAbd Allāh al-Mahdī, après moult pérégrinations qui le conduisent de Salamiyya à la Tunisie en passant par Siǧilmāsa, a pu venir à bout de la « trahison » des trois premiers califes, ainsi que du régime usurpateur des Omeyyades et des Abbasides ; ces derniers avaient forcé les imams et leurs fidèles à adopter la taqiyya. La fondation de Mahdiyya est considérée comme un événement messianique parce qu’il signe, en premier lieu, la fin de la clandestinité et le moment de l’apparition du « maître de la manifestation » (ṣāḥib al-ẓuhūr) qui devient à la fois imam et calife.
Cette fondation ne réglera en rien le problème principal de la dynastie, à savoir sa généalogie. Le flou artistique qui entoure son ascendance a toujours attiré les railleries de toute part, y compris de la part des Carmathes, les frères ennemis des Fatimides. Le travail des théologiens fatimides, comme al-Kirmānī (m. vers 411/1020), ou les fondateurs du droit fatimide, comme al-Qāḍī al-Nuʿmān (m. 363/974), consistait principalement à trouver la parade pour reléguer au second plan ces incertitudes et, surtout, pour parer la dynastie fatimide d’une légitimité religieuse. L’A. donne, à ce propos, deux exemples, dont le premier est tiré du Kitāb al-Maṣābīḥ d’al- Kirmānī qui compare l’histoire des imams cachés au récit coranique des « Gens de la caverne » (Ahl al-Kahf)[3]. Dans ce dernier récit, des jeunes gens, cherchant à fuir les tyrans mécréants qui gouvernaient leur pays, se sont réfugiés dans une caverne où ils dormirent 309 ans. Selon al-Kirmānī, les successeurs du premier imam caché ont subi le même sort. À cause de la tyrannie et de la répression, ces derniers ont été obligés de se retirer dans la clandestinité pendant 309 années et en 309 (?)[4], ʿAbd Allāh al-Mahdī sort de la clandestinité, selon al-Kirmānī, pour fonder l’État fatimide.
Le deuxième exemple est tiré de Taʾwīl al-daʿāʾim d’al-Qāḍī al-Nuʿmān qui reconnaît dans les événements marquant l’avènement des Fatimides, le sens ésotérique (bāṭin) des prescriptions coraniques relatives au jeûne de ramadan[5]. Al-Nuʿmān signale qu’en arabe le mot ṣawm (jeûne) est synonyme de ṣamt (silence), ce qui serait, selon lui, confirmé par un verset du Coran où est évoqué le jeûne et le silence de Marie[6]. Al-Nuʿmān n’explique à aucun moment ce verset, mais s’empresse de déclarer que « le jeûne ésotérique » (ṣawm al-bāṭin) renvoie au kitmān, le fait de tenir secret la science du bāṭin envers les « exotéristes » (ahl al-ẓāhir). Ṣawm al-bāṭin est le fait de ne pas révéler la science et la sagesse transmises par les imams et symbolisées par les nourritures et les boissons dans la version coranique en question. Une fois posée cette correspondance entre le ṣamt et le ṣawm, al-Nuʿmān entreprend d’élucider le sens caché du mois de ramadan présenté comme un long taʾwīl (interprétation ésotérique) du C. al-Baqara II, 183-185. Le taʾwīl se déploie sur différents niveaux. Nous nous contentons de signaler le premier niveau donné par al-Nuʿmān.
Dans le cycle de Muḥammad, le mois de ramadan correspond à ʿAlī et aux imams de sa descendance, chargés d’organiser la daʿwa cachée (al-daʿwa al-mastūra) et de préserver la science du taʾwīl : « Le mois compte 29 jours et s’achève par le trentième » (p. 22)[7]. Entre ʿAlī et le Mahdī, il y a dix imams, dix « preuves » (ḥuǧaǧ) et dix « portes » (abwāb), le tout correspond aux trente jours de ramadan. Jeûner pendant le mois de ramadan implique l’obligation de garder secret tout ce qui concerne les imams et l’organisation de la daʿwa. Rompre le jeûne correspond, par conséquent, au jour de l’avènement du Mahdī et à l’abrogation partielle de la taqiyya. Il va sans dire que le Mahdī dont il est question ici n’est autre que ʿAbd Allāh al-Mahdī, le onzième imam selon la généalogie officielle des Fatimides. En prenant le pouvoir en Tunisie en 909 et en fondant Mahdiyya pour capitale, l’imam sort de la clandestinité et devient le dirigeant politique d’un État.
Pourquoi l’abrogation de la taqiyya est-elle qualifiée de “partielle” par al- Nuʿmān ? Il est clair que la fondation de Mahdiyya signe la fin de la clandestinité et de la disparition du voile de la peur (ḥiǧāb al-ḫawf), mais elle ne signe pas la fin de la distinction entre le ẓāhir et le bāṭin. L’abolition de cette distinction ne se produira qu’avec al-Qāʾim (le Sauveur) qui permettra à l’humanité d’entrer dans un nouveau « cycle de manifestation » (dawr al-kašf) durant lequel la connaissance salvatrice sera directement accessible, sans loi, sans rite et sans religion établie. Les théologiens ismaéliens au service des Fatimides, comme al-Kirmānī et al-Nuʿmān, ont tout fait pour faire durer les attentes messianiques en les repoussant vers un avenir de plus en plus lointain. D’ailleurs, on le voit bien avec les surnoms des imams : si les deux premiers imams-califes fatimides portent encore des surnoms messianiques (al-Mahdī al-Qāʾim), leurs successeurs se contentent des noms plus neutres tels que al-Manṣūr, al-Muʿizz, al-ʿAzīz, etc. Ce revirement était loin de plaire aux autres ismaéliens, en particulier les Carmathes, qui ont fini par accuser les Fatimides d’être des imposteurs.
Dans le deuxième moment de son introduction, intitulé « L’imam fatimide comme philosophe néoplatonicien », l’A. revient sur l’appel à la modération que fait al-Kirmānī et qui « a tant exaspéré les extrémistes carmathes et druzes » (p. 25). Pour que l’âme devienne vertueuse, elle ne peut que respecter la loi du ẓāhir, en premier lieu les lois du Coran dans leur sens littéral. Seuls les initiés peuvent s’ouvrir à la science du bāṭin. Nous retrouvons avec al-Kirmānī la vraie réalité politico-religieuse de l’Empire fatimide : obligation est faite à tous les musulmans de respecter la lettre de la loi. Quant à son esprit, il est réservé aux initiés ismaéliens. L’influence de la philosophie néoplatonicienne sur la science ésotérique dont parle al-Kirmānī, entre autres, se fait encore sentir à cette époque – d’où le titre donné à la section –, même si les auteurs ismaéliens évitent d’en parler et vont même jusqu’à adopter une attitude hostile envers le savoir philosophique. C’est une attitude ambiguë en effet : al-Kirmānī s’appuie bien sur les écrits des philosophes comme al-Fārābī ou al-Kindī, mais il s’arrange toujours pour ne pas les citer nommément et va même jusqu’à les accuser d’impiété. Les philosophes sont, dans le meilleur des cas, des voleurs, comme c’est le cas chez le dāʿī contemporain d’al-Kirmānī, Aḥmad al-Naysābūrī, car ils n’ont pas hésité à voler certaines de leurs idées philosophiques aux prophètes et à ceux qui « détiennent la vérité » (ahl al-ḥaqāʾiq), à savoir les imams[8] ; dans le pire des cas, ce sont des athées, surtout quand il s’agit des philosophes grecs traduits en arabe, c’est le cas chez Abū Yaʿqūb al-Siǧistānī (m. vers 361/971)[9].
Le troisième moment de cette introduction est intitulé « La révolte druze », menée par Ḥamza ibn ʿAlī et Naštakīn al-Darazī : cette réaction à l’ismaélisme modéré professe qu’al-Ḥākim était l’ultime manifestation de la divinité sous une forme humaine et qu’il aurait déclaré l’avènement du dawr al-kašf, le cycle de la manifestation, ce qui implique l’abrogation de toutes les religions antérieures et la fin de tout écrit ou loi révélée. C’est un dépassement de tous les sens du texte coranique, qu’il s’agisse du sens littéral ou caché. L’A. signale cependant que, malgré les pires accusations dont les Druzes étaient victimes, « on cherchera en vain de tels excès dans les livres religieux druzes » (p. 30).
On ne pourra pas rendre compte ici de la richesse de cet ouvrage qui deviendra, à n’en pas douter, une référence incontournable des études fatimides.
Le chapitre 1 (« La prédication shi’ite ismaélienne en Égypte fatimide : ses aspects ésotériques et exotériques ») montre l’importance des sermons et des prêches dans les tentatives de consolidation d’un État shiite. En effet, le problème majeur des Fatimides renvoie à ce que Henry Corbin appela leur « paradoxe » ou « drame » : « Dans quelle mesure une sodalité ésotérique était-elle compatible avec l’organisation officielle d’un État ?[10]. » Le souverain fatimide était un imam ismaélien pour la minorité ismaélienne, mais également un calife pour la majorité des musulmans sunnites. Comment alors maintenir l’équilibre entre ces deux tendances ? Les sermons et les prêches, auxquels il faut ajouter les maǧālis al-ḥikma, les séances de la sagesse, illustrent bien la bipolarité de cet État. Les souverains veillaient à ce que les prêches et les sermons assurent une prédication externe ou « exotérique » adressée à l’ensemble des musulmans, et que les maǧālis al-ḥikma maintiennent une prédication interne ou « ésotérique », destinées aux seuls initiés de l’ismaélisme.
Le chapitre 2 (« Les fêtes shi’ites en Égypte Fatimide ») montre comment les Fatimides ont progressivement réussi à introduire les fêtes shiites en Égypte sunnite. Il s’agit en premier lieu des fêtes de ʿĀšūrāʾ, le martyr d’al-Ḥusayn, que les shiites égyptiens célébraient discrètement avant l’arrivée des Fatimides. Ceux-ci ont fini par l’institutionnaliser tout en évitant les débordements incontrôlables d’ardeur religieuse et les affrontements parfois violents qui opposaient les shiites à la majorité sunnite. On célébrait aussi la fête de Ġadīr Ḫumm officialisée par le calife al-Muʿizz en 362/972. Cette fête, qu’on célèbre le 18 du onzième mois, ḏū al-ḥiǧǧa, et qui marque le jour où le prophète de l’islam aurait proclamé son cousin et gendre ʿAlī comme mawlā (seigneur) des musulmans, causait beaucoup de troubles au Caire, d’où son interdiction par le calife al-Ḥākim, en 399/1009.
Le chapitre 3 (« Jeux, sport et plaisanterie, témoins d’une sagesse divine ») étudie la réhabilitation des fêtes profanes, foires et autres frivolités (hazl) par les Fatimides. Souvent, ce hazl n’était pas du goût de l’islam rigoriste qui lui opposait le ǧidd (le sérieux) : « Le jeu, nous dit al-Šāfiʿī, n’appartient pas à la pratique de l’homme religieux et est contraire à la virilité[11]. » Cela n’a jamais empêché les musulmans d’apprécier les foires et les frivolités, et l’époque mamelouk et ottomane ne manque pas de documentation relative aux jeux, ce qui est loin d’être le cas pour l’époque fatimide. Néanmoins, on dispose d’un fragment de la Chronique fatimide d’al-Musabbiḥī, cité par al-Maqrīzī, qui décrit une fête dans un lieu appelé « Prison de Joseph » à Gizeh : al-Maqrīzī nous raconte que le calife al-Ẓāhir, successeur d’al-Ḥākim, assista lui-même à cette fête où pendant deux semaines des bohémiens (ramādiyya) faisaient des plaisanteries et des boniments de tout genre[12]. Pour l’époque d’al-Ḥākim elle-même, l’A. se réfère à un témoignage druze, « passé largement inaperçu dans les études consacrées au Caire fatimide » (p. 70). Il s’agit de la onzième épître des Rasāʾil al-ḥikma intitulée : Kitāb fīhi ḥaqāʾiq mā yaẓhar quddāma mawlānā ǧalla ḏikruhu min al-hazl (« Écrit exposant le vrai sens des badinages qui se font devant Notre Seigneur, que sa mémoire soit exaltée »)[13]. Ce traité nous dit que malgré l’interdiction par al-Ḥākim de toute sorte d’amusement, on le voyait souvent lui-même transgresser ses propres édits et continuer à fréquenter les foires, où la charia était transgressée (ce qui renvoie à la mission même d’al-Ḥākim : l’abrogation de cette charia, ainsi que toutes ses interprétations ésotériques).
Le chapitre 4 (« Comment déterminer le début et la fin du jeûne de ramadan ? ») analyse ce « point de discorde entre sunnites et ismaéliens en Égypte fatimide », comme l’indique le sous-titre. Selon l’A., bien que les Fatimides se soient toujours abstenus de convertir massivement les Égyptiens au shiisme ismaélien, cela ne les a pas empêchés de leur imposer la manière ismaélienne d’accomplir les obligations religieuses. L’exemple le plus parlant est la définition divergente du calendrier de ramadan, ce qui générait souvent des troubles et des tentatives de rébellion. D’après le traité d’al-Kirmānī intitulé al-Risāla al-lāzima fī ṣawm šahr ramaḍān[14] qui serait, selon l’A., le premier traité ismaélien à s’intéresser, de manière technique et avec des arguments philosophiques au calcul astronomique (ḥisāb). Le jeûne du ramadan est basé sur la ruʾyat al-hilāl (la vision du croissant). La plupart des sunnites soutient qu’il s’agit d’une vision opérée par l’œil, tandis qu’al-Kirmānī, fidèle à sa conception ismaélienne, parle d’une vision spirituelle basée sur le ḥisāb : le mois commence lorsque la lune quitte sa conjonction avec le soleil et se sépare de lui. Ce calcul est une critique à peine voilée de la conception sunnite de la nature, surtout dans l’acharisme où les lois de la nature ne seraient qu’une fiction inventée par l’homme. En effet, grâce à une sorte de création continuée, Dieu crée à chaque moment chaque phénomène ; rien ne garantit, par exemple, qu’il fasse en sorte que la lune se sépare du soleil ou que les mouvements des corps célestes fonctionnent avec la même régularité. Il est donc nécessaire de s’appuyer sur une observation continuelle et à l’œil nu, sans ruʾyat al-hilāl ni certitude sur le calendrier ou sur les fêtes religieuses. Pour al-Kirmānī, un tel calendrier peut être rendu impossible par les conditions météorologique ou astronomique ; il est donc imparfait et ne peut être recommandé, ni par Dieu, ni par le prophète, ni par l’imam.
Au chapitre 5 (« Invention et translation de la tête d’al-Ḥusayn [raʾs al-Ḥusayn] au Caire sous les Fatimides »), l’A. revient sur le culte shiite d’al-Ḥusayn, sayyid al-šuhadāʾ (prince des martyrs), qui serait, selon Ignaz Goldziher et Bernardus D. Eerdmans, une islamisation du culte babylonien de Tammūz-Adonis[15]. Cette thèse est contestée par certains shiites qui trouvent plutôt des similitudes entre la passion d’al-Ḥusayn et la passion du Christ. Mais l’intérêt de l’A. se porte sur les raisons du transfert de la tête d’al-Ḥusayn, au Caire après un passage mouvementé par Damas. Ce pourrait refléter la volonté des Fatimides de faire du Caire une vraie capitale du monde musulman et un centre de pèlerinage pour tous les shiites. Or, la tête d’al-Ḥusayn n’a été intégrée dans le culte officiel des Fatimides que tardivement dans leur histoire, à peu près dix-huit ans avant que Saladin ne détrône le dernier calife fatimide. En se référant aux travaux de Paula Sanders et de Caroline Williams16, l’A. explique ce retard par la progressive importance donnée au culte des saints shiites face aux défaites militaires (p. 110). Pour ne pas perdre le soutien de la population égyptienne, le pouvoir fatimide lui concède des célébrations de ce genre, « dont l’origine shi’ite était plus ou moins oubliée par la masse sunnite » (p. 110). À cela s’ajoute les tentatives de « dé-ismaélisation » de l’État fatimide entreprises par certains vizirs étrangers, tels que l’arménien Badr al-Ǧamālī, pour sauver l’empire de la ruine et le rendre plus attrayant à la majorité sunnite.
Au chapitre 6 (« Le calife fatimide al-Ḥākim a-t-il voulu s’emparer des reliques du prophète Muhammad ? »), l’A. revient sur un épisode audacieux de la vie d’al-Ḥākim. On sait que le culte des reliques de l’islam a une grande importance pour la plupart des musulmans ; l’on n’a qu’à observer les touristes musulmans se précipiter à la salle des reliques (Has Oda) du palais de Topkapi à Istanbul pour s’en convaincre. Déjà en 1888, Goldziher remarquait que ce culte ne cessait de croître dans l’islam classique (vie-viie/xiie-xviiie s.) à mesure que se développait le culte du Prophète[17]. Malgré l’opposition des rigoristes de tout bord, qui ne cessent de traiter ce culte de bidʿa (innovation blâmable), celui-ci demeure un phénomène universel dans l’islam, aussi bien chez les shiites que chez les sunnites. Al-Maqrīzī nous raconte qu’en 704/1304, le théologien rigoriste Ibn Taymiyya (m. 728/1328) a failli être lynché par la foule lorsqu’il essaya de briser, dans une mosquée de Damas, une empreinte du pied du Prophète (p. 119)[18]. Les Wahhabites détruisent au xixe siècle d’innombrables tombeaux et reliques dans les lieux saints même de l’islam, à la Mecque et à Médine. Malgré toutes ces oppositions, la vénération des reliques n’a jamais cessé, bien au contraire, le shiisme a même étendu le culte du Prophète à celui de l’imam ʿAlī et à tous les imams qui, à leurs yeux, sont les seuls successeurs légitimes de Muḥammad[19]. Cela apparaît clairement dans l’histoire des Fatimides et de la pérégrination de la tête d’al-Ḥusayn. Le « plan rocambolesque » d’al-Ḥākim qui consiste à exhumer le prophète et les deux premiers califes de leurs tombes à Médine et à transférer leurs restes au Caire, est-il un fait historique ou d’une légende forgée de toute pièce ? À première vue, tout indique que cette histoire doit être classée parmi les nombreuses légendes auxquelles la singulière personnalité d’al-Ḥākim a donné lieu. Ce qui plaide en ce sens, c’est que ce récit ne figure dans aucune des sources habituelles de l’histoire fatimide relatives à cette époque : elle ne figure ni dans les chroniques de Yaḥyā ibn Saʿīd al-Anṭākī[20], ni dans celles d’al-Maqrīzī[21]. Mais on le trouve chez des auteurs bien postérieurs à cette époque, usant de sources inconnues ou perdues, tels que le géographe andalou al-Bakrī (m. 487/1094), le biographe de l᾽émir de la Mecque al-Fāsī (m. 833/1429) ou l’historien persan Mīrkhwānd (m. 904/1498)[22]. L’enquête de l’A. aboutit tout d’abord à l’idée que la violation et le pillage de la tombe vénérée du Prophète et des premiers califes est un lieu commun dans la littérature arabe (p. 124). C’est le symbole d’un sacrilège suprême perpétré par les pires ennemis de l’islam orthodoxe : les shiites, en particulier les ismaéliens, ou les chrétiens, associés aux croisés. Mais il y a un fait troublant, confirmé par plusieurs sources (p. 125), qui nous oblige à ne pas nous en tenir à ce lieu commun : al-Bakrī rapporte qu’en 461/1068 (c’est-à-dire moins de cinquante ans après la mort d’al-Ḥākim), ce dernier a fait construire sur la route menant du Caire à Fusṭāṭ, trois mausolées ou mašāhid, qui seraient destinés à abriter les restes du Prophète et des deux premiers califes, transférés de Médine. Le mausolée de gauche a été démoli à l’époque ottomane ; celui du milieu, le plus grand des trois, connu sous le nom de la mosquée de Muḥammad al-Anwar, existe toujours bien qu’il ait été rebâti au xviiie siècle. Quant au mausolée de droite, il aurait disparu à une époque indéterminée. Dès lors, l’information d’al-Bakrī n’a rien d’improbable, et il est donc légitime de se demander pourquoi al-Ḥākim, le plus illustre des ismaéliens, aurait donné une nouvelle sépulture à Abū Bakr et à ʿUmar, les deux califes haïs par les shiites pour avoir volé le pouvoir à l’imam ʿAlī, d’autant plus que ce calife les a fait maudire en public à plusieurs reprises[23] ? On a là un mystère de l’histoire qui demande à être élucidé.
Le chapitre 7 a pour titre « Les interdictions alimentaires du calife fatimide al-Ḥākim. Marque de folie ou annonce d’un règne messianique ? » Le désir d’al-Ḥākim de voler les restes du prophète de l’islam et de le transférer au Caire fut souvent taxé de folie par plusieurs historiens. Il en va de même des interdictions alimentaires insolites que ce calife imposa aux musulmans de son empire : certains aliments et boissons prohibées par la charia d’abord, animaux marins, en particulier les poissons sans écailles ensuite. Leur interdiction paraît s’opposer à ce qui dit le Coran[24], mais certains fuqahāʾ et certains juristes de tendance hanbalite semblent, sinon les interdire, du moins les déconseiller. Al-Qāḍī al-Nuʿmān interdit catégoriquement les poissons sans écailles dans son Daʿāʾim al-islām, manuel du fiqh de référence pour les ismaéliens[25]. La troisième catégorie de ces interdictions est beaucoup plus étrange : elle frappe en effet la vente et la consommation de la mulūḫiyya (variété de mauve commune au Proche-Orient), la roquette (ǧarǧīr), les lupins (tirmis) et la mutawakkiliyya (peut-être une sorte de laitue ?). Sans aucun fondement dans la loi musulmane, elles rappellent celles, antiques, associées à la doctrine de Pythagore. Celui-ci avait banni la mauve, ou corète, parce qu’elle est, nous dit Jamblique, « le premier messager et le premier indice de la sympathie entre ce qu’il y a dans les cieux et ce qui se trouve sur terre[26] ». L’interdiction de manger la mauve serait alors due à son caractère d’intermédiaire entre le ciel et la terre : grâce à ses feuilles, elle se saisit de l’influx céleste et ses racines se chargent ensuite de le transmettre à la terre. De même, ses racines vont capter les âmes des morts pour les acheminer vers le soleil. Par ces mouvements, la mauve inscrit en son sein l’unité du monde et de l’existence telle qu’elle est décrite par la philosophie néoplatonicienne. Pour l’A., c’est une raison sérieuse qui expliquerait mieux l’interdiction faite par le calife, que celle de sa prétendue folie ou du fait que ces aliments étaient appréciés des ennemis de ʿAlī (p. 146). La vraie motivation serait d’origine pythagoricienne : il serait interdit de consommer des plantes qui permettent aux âmes de remonter vers les cieux et de communiquer avec le monde céleste, au risque de corrompre le processus sotériologique et de rompre toute communication entre les âmes des défunts avec le monde céleste (p. 147).
Le chapitre 8 (« La khalwa druze. Lieu de culte ou assemblée profane ? ») est d’une grande originalité. Il s’agit d’une enquête qui cherche à définir la nature des cultes pratiqués par les Druzes. Il faut préciser à ce propos que le shiisme a été souvent « exposé à la tentation d’abolir la charia en l’allégorisant » (p. 153). Le vrai initié, celui qui connaît le sens caché des textes sacrés, n’a pas besoin de pratiquer des cultes jugés parfois absurdes. Dans l’histoire du shiisme, plusieurs mouvements comme les Carmathes, les « Assassins » de ʿAlamūt, les Nuṣayrīs et autres mouvements ultra-shiites dits ġulāt, ont soutenu le fait que les initiés sont automatiquement dispensés de pratiquer l’aspect extérieur des prescriptions légales. Mais d’autres théologiens shiites modérés, duodécimains ou ismaéliens, insistent fortement sur la parfaite complémentarité du ẓāhir et du bāṭin. L’ismaélisme fatimide, on l’a vu avec al-Kirmānī, refuse d’entériner les tendances extrémistes du mouvement shiite initial, en ce qu’elles menaceraient la stabilité du régime. Al-Kirmānī professe plutôt le strict équilibre entre « le culte par la pratique » (al-ʿibāda al-ʿamaliyya) et « le culte par la connaissance » (al-ʿibāda al-ʿilmiyya). Mais cela ne l’empêche pas de déclarer que les actions rituelles imposées par le Coran, privées de leur signification cachée et, par conséquent, de leur légitimité « rationnelle », sont insensées, nulles et non avenues. Il en va ainsi du pèlerinage à la Mecque, le ḥaǧǧ : il ne sert à rien d’entreprendre un long voyage dans le seul but est de tourner autour d’une pierre banale car s’il est dépourvu du bāṭin, le ẓāhir du ḥaǧǧ serait absurde[27]. L’essentiel pour al-Kirmānī est d’observer un certain équilibre entre l’esprit et la lettre des textes sacrés et de ne pas tomber dans les travers des mouvements antinomistes propres à menacer les bases politiques des Fatimides. En effet, à cette époque et tout particulièrement en 408/1017, apparaît le traité al-Naqḍ al-ḫafī (« L’Abrogation cachée ») de Ḥamza ibn ʿAlī, l’un des initiateurs de ce mouvement antinomiste qui deviendra la religion druze. Les propos de son traité sont à mille lieux des propos modérés de son contemporain al-Kirmānī car il y démontre comment le calife fatimide al-Ḥākim, considéré comme la dernière manifestation de la divinité dans une enveloppe charnelle, a abrogé les « piliers de l’islam ». Bien plus, après avoir révélé le caractère polythéiste de la profession de foi, la šahāda, Ḥamza ibn ʿAlī prétend qu’al-Ḥākim a rompu le jeûne en plein ramadan dans la mosquée al-Azhar, libéré le peuple de l’aumône légale, n’observait plus l’obligation de la prière, etc. Bref, al-Ḥākim n’hésitait jamais, selon Ḥamza ibn ʿAlī, à entreprendre toute action propre à manifester son rejet de l’aspect extérieur (ẓāhir) de la charia. Ḥamza ibn ʿAlī va même jusqu’à décrire al-Bayt al-Ḥarām à la Mecque comme un asile d’aliénés et de son revêtement par la fameuse kiswa qui, chaque année, était offerte en grande pompe par les califes d’Égypte. D’ailleurs, en traitant les maǧālis al-ḥikma (les assemblées de la sagesse) où les initiés ismaéliens expliquaient ésotériquement les rites de l’islam, d’« enfantillages » (p. 155), Ḥamza ibn ʿAlī déclare qu’avec la manifestation de la divinité en al-Ḥākim, l’islam a été abrogé non seulement en son sens exotérique, mais aussi ésotérique. À la place des « piliers de l’islam », Ḥamza ibn ʿAlī propose aux Druzes de les remplacer par les « vertus unitaires religieuses » (ḫiṣāl tawḥīdiyya dīniyya), à savoir « la véracité (al-ṣidq) du langage la protection (ḥifẓ) des frères, l’abandon (tark) de tous les cultes antérieurs, la libération (barʾa) des forces du mal et de l’oppression, la profession de l’unicité (tawḥīd) de Notre-Seigneur, la satisfaction (al-riḍā) envers ses actions et la soumission (al-taslīm) à ses commandements » (p. 156). À les examiner de près, on remarque qu’il s’agit là plutôt de vertus morales que de rites bien déterminés. Et l’on cherche en vain dans les écrits de cette nouvelle religion prêchée par Ḥamza ibn ʿAlī et ses successeurs un culte spécifique ou une pratique rituelle qui remplacerait les rites musulmans. D’où la question de l’A. : « Les Druzes suivent-ils un rituel religieux ou sont-ils les adeptes d’une sorte d’école philosophique, voire d’un mouvement à vocation essentiellement politique et sociale ? » (p. 158). Quoi qu’en disent certains Druzes contemporains, il est impossible d’affirmer qu’un système purement « spirituel » et philosophique, basé sur de simples prescriptions morales, ait pu construire et maintenir une communauté, telle que celle que l’on connaît aujourd’hui, d’autant plus que la majorité était de simples paysans illettrés. Les écrits sur cette communauté sont certes rares et souvent contradictoires, mais ceux dont on dispose parlent des rituels des maǧālis et des ḫalawāt (réunions hebdomadaires, tous les jeudis) : un témoignage digne de foi sur ces réunions, est celui d’un Druze converti au christianisme et publié, en traduction allemande, dans les Reisen im Orient de Julius Petermann[28]. L’auteur y parle de ces réunions tenues chaque jeudi soir, où les initiés (ʿuqqāl) du village se réunissent en un endroit nommé maǧlis ou ḫalwa. Les non-initiés (ǧuhhāl) en sont exclus. Dans ces maǧālis, on psalmodie des textes tirés du Canon, comme font les musulmans avec le Coran, on les explique, les commente et on récite des poèmes du genre ʿaskariyyāt, poèmes militaires glorifiant la parousie d’al-Ḥākim et le triomphe final de la religion druze. Après ces rituels, toutes les femmes et les hommes se retirent et ne restent que les initiés du plus haut rang (appelé aǧāwīd), qui continuent la séance. Que se passe dans les ḫalwa des aǧāwīd ? Aucune information fiable ne semble disponible quant au contenu du cérémonial pratiqué par les initiés des grades supérieurs. Les résultats de l’enquête passionnante de l’A. nous conduisent finalement à conclure que le druzisme est loin de constituer une « religion philosophique » sans culte et que, séparé de la terre natale égyptienne, il a pu opérer un rapprochement avec la plupart des pratiques populaires musulmanes. Cette nouvelle religion a même développé une organisation des cultes et une vie spirituelle qui doivent beaucoup au soufisme.
Le chapitre 9 (« Le culte du veau d’or chez les Druzes ») revient sur l’une des nombreuses accusations d’extravagances ou de perversions (dont l’inceste) qui composent la propagande anti-druze. Ces derniers adoreraient dans le secret de leur ḫalwa, leur divinité, le sixième calife fatimide, al-Ḥākim, sous la figure d’une idole en or ou en argent, qui aurait la forme d’un veau. Dès le xviie siècle, plusieurs voyageurs parcourant les montagnes de Syrie et du Liban, ainsi que des missionnaires – des Jésuites dans leur majorité – opérant parmi les maronites de la région, ont rapporté en Occident cette rumeur. Après une longue vérification sur l’origine et l’étendue de cette rumeur, l’A. aboutit aux résultats suivants : dans les écrits de Ḥamza ibn ʿAlī, le veau est toujours mentionné en un sens péjoratif, ce qui s’oppose à toute idée d’associer cet animal à un éventuel culte d’al-Ḥākim. En réalité, Ḥamza ne fait que reprendre une longue tradition shiite qui voit dans le récit coranique de l’adoration du veau d’or – considérablement grossi par une multitude de détails relevant des qiṣaṣ al-anbiyāʾ – une préfiguration de la trahison dont étaient victimes ʿAlī et tous les imams shiites : au lieu de reconnaître le vrai successeur du Prophète, la majorité des musulmans « ont adoré le veau d’or » et se sont éloignés de la bonne voie du Prophète Muḥammad. Il serait donc absurde d’associer al-Ḥākim au symbole du veau. L’A. se demande ensuite s’il ne s’agit pas finalement alors d’une innovation postérieure à Ḥamza, mais son enquête concernant la postérité de Ḥamza ne trouve rien de convaincant qui associerait al-Ḥākim au symbole du veau. Il s’agit finalement d’un mythe de plus qui a alimenté le phantasme de certains orientalistes et amateurs d’arts européens, mais qui ne correspond à rien de convaincant.
Le chapitre 10 (« Les prétendues origines druzes de la franc-maçonnerie. Naissance et persistance d’un mythe ») examine un autre mythe forgé de toute pièce par des études scientifiques portant sur l’ismaélisme et le druzisme. Curieusement, la prétendue origine druze de la franc-maçonnerie a été adopté par certains druzes tels que Kemal Joumblatt qui déclarait un jour qu’un druze est « un croyant de toutes les religions du monde… un peu à la manière des rose-croix, qui sont les adeptes de toutes les religions, et d’ailleurs prétendent être les druzes de l’Occident[29] ». S’agit-il d’une forme de taqiyya ? En tout cas, précise l’A., Joumblatt faisait partie des ǧuhhāl, donc était loin d’être initié aux arcanes du druzisme.
Le dernier chapitre (« La théorie des Trois Imposteurs et ses origines islamiques ») revient sur une histoire dont on trouve des traces chez Gérard de Nerval. Un des passages de son Voyage en Orient fait allusion aux Trois Imposteurs (Moïse, Jésus et Muḥammad)[30], thème en vogue au milieu du xixe siècle. Ernest Renan l’évoque dans son Averroès et l’Averroïsme en en situant la naissance dans la cour de Frédéric II, grand admirateur des Arabes dont l’esprit « représentait à ses yeux la liberté de penser et la science rationnelle [31] ». Depuis le Moyen-Âge, l’on parle d’un soi-disant livre intitulé les Trois Imposteurs, en fait, ce Liber de Tribus Impostoribus n’a été rédigé qu’au xviie siècle en Allemagne, dans un milieu spinoziste. Renan en voit l’origine dans l’islam puisqu’il développe une conception de la prophétie étrangère au judaïsme et au christianisme. Qui plus est, la thèse selon laquelle les prophètes ne sont que des imposteurs est défendue dans la philosophie arabe par Ibn Rāwandī et par Abū Bakr al-Rāzī. Louis Massignon, quant à lui, croit avoir trouvé l’origine des Trois Imposteurs chez les Carmathes. Cela revient à donner raison à de Nerval qui avait vu juste en situant d’une façon intuitive la théorie des Trois Imposteurs en milieu ismaélien.
Au terme de cette lecture, nous ne pouvons que saluer, encore une fois, la rigueur scientifique avec laquelle Daniel De Smet a conduit ses enquêtes dans son travail. On a là un superbe ouvrage, tant par sa facture matérielle, la richesse documentaire des textes commentés et par le soin et l’érudition mis au service des dites enquêtes.
L’A. souligne dans l’introduction (p. 11-30) trois moments propres à la naissance de la dynastie fatimide. Le premier moment, qu’il appelle « une origine nimbée de légendes », reprend les grandes lignes d’une étude antérieure de l’A.[1] et évoque les débuts douloureux de la daʿwa fatimide, très souvent placée sous le signe de la taqiyya (dissimulation), ce « qui explique le manque cruel de sources fiables sur les débuts du mouvement ismaélien » (p. 11). La source principale de l’A. pour évoquer le début de cette daʿwa est un pamphlet rédigé à Damas en 372/982 par un dénommé Aḫū Muḥsin. Ce pamphlet est plus que troublant, vu qu’il présente les Fatimides comme des imposteurs qui descendent non de ʿAlī et de Fāṭima, mais d’un « occultiste » iranien nommé ʿAbd Allāh, fils de Maymūn al-Qaḍḍāḥ, disciple de l’hérésiarque Bardésane et proche de l’ultra-shiite Abū al-Ḫaṭṭāb[2]. Curieusement, les Fatimides ont intégré le nom de ce ʿAbd Allāh, fils de Maymūn al-Qaḍḍāḥ, dans leur tradition. Par mesure de sécurité et pour masquer leur véritable identité, les ancêtres des Fatimides ont toujours adopté des pseudonymes : Maymūn al-Qaḍḍāḥ ne serait en fait que le petit-fils de l’imam éponyme des ismaéliens Ǧaʿfar al-Ṣādiq. Son fils ʿAbd Allāh, qui sera le premier calife fatimide, porte le pseudonyme de Saʿīd et tous les missionnaires qu’il envoie aux quatre coins du monde portent des pseudonymes propres à brouiller toutes les pistes et à dérouter le plus aguerri des historiens.
Plus importante est la fondation, sur la côte tunisienne, de la première capitale fatimide, Mahdiyya. Cette fondation a été vécue comme un événement messianique marquant un tournant radical dans l’histoire de l’islam, depuis la mort du Prophète. ʿAbd Allāh al-Mahdī, après moult pérégrinations qui le conduisent de Salamiyya à la Tunisie en passant par Siǧilmāsa, a pu venir à bout de la « trahison » des trois premiers califes, ainsi que du régime usurpateur des Omeyyades et des Abbasides ; ces derniers avaient forcé les imams et leurs fidèles à adopter la taqiyya. La fondation de Mahdiyya est considérée comme un événement messianique parce qu’il signe, en premier lieu, la fin de la clandestinité et le moment de l’apparition du « maître de la manifestation » (ṣāḥib al-ẓuhūr) qui devient à la fois imam et calife.
Cette fondation ne réglera en rien le problème principal de la dynastie, à savoir sa généalogie. Le flou artistique qui entoure son ascendance a toujours attiré les railleries de toute part, y compris de la part des Carmathes, les frères ennemis des Fatimides. Le travail des théologiens fatimides, comme al-Kirmānī (m. vers 411/1020), ou les fondateurs du droit fatimide, comme al-Qāḍī al-Nuʿmān (m. 363/974), consistait principalement à trouver la parade pour reléguer au second plan ces incertitudes et, surtout, pour parer la dynastie fatimide d’une légitimité religieuse. L’A. donne, à ce propos, deux exemples, dont le premier est tiré du Kitāb al-Maṣābīḥ d’al- Kirmānī qui compare l’histoire des imams cachés au récit coranique des « Gens de la caverne » (Ahl al-Kahf)[3]. Dans ce dernier récit, des jeunes gens, cherchant à fuir les tyrans mécréants qui gouvernaient leur pays, se sont réfugiés dans une caverne où ils dormirent 309 ans. Selon al-Kirmānī, les successeurs du premier imam caché ont subi le même sort. À cause de la tyrannie et de la répression, ces derniers ont été obligés de se retirer dans la clandestinité pendant 309 années et en 309 (?)[4], ʿAbd Allāh al-Mahdī sort de la clandestinité, selon al-Kirmānī, pour fonder l’État fatimide.
Le deuxième exemple est tiré de Taʾwīl al-daʿāʾim d’al-Qāḍī al-Nuʿmān qui reconnaît dans les événements marquant l’avènement des Fatimides, le sens ésotérique (bāṭin) des prescriptions coraniques relatives au jeûne de ramadan[5]. Al-Nuʿmān signale qu’en arabe le mot ṣawm (jeûne) est synonyme de ṣamt (silence), ce qui serait, selon lui, confirmé par un verset du Coran où est évoqué le jeûne et le silence de Marie[6]. Al-Nuʿmān n’explique à aucun moment ce verset, mais s’empresse de déclarer que « le jeûne ésotérique » (ṣawm al-bāṭin) renvoie au kitmān, le fait de tenir secret la science du bāṭin envers les « exotéristes » (ahl al-ẓāhir). Ṣawm al-bāṭin est le fait de ne pas révéler la science et la sagesse transmises par les imams et symbolisées par les nourritures et les boissons dans la version coranique en question. Une fois posée cette correspondance entre le ṣamt et le ṣawm, al-Nuʿmān entreprend d’élucider le sens caché du mois de ramadan présenté comme un long taʾwīl (interprétation ésotérique) du C. al-Baqara II, 183-185. Le taʾwīl se déploie sur différents niveaux. Nous nous contentons de signaler le premier niveau donné par al-Nuʿmān.
Dans le cycle de Muḥammad, le mois de ramadan correspond à ʿAlī et aux imams de sa descendance, chargés d’organiser la daʿwa cachée (al-daʿwa al-mastūra) et de préserver la science du taʾwīl : « Le mois compte 29 jours et s’achève par le trentième » (p. 22)[7]. Entre ʿAlī et le Mahdī, il y a dix imams, dix « preuves » (ḥuǧaǧ) et dix « portes » (abwāb), le tout correspond aux trente jours de ramadan. Jeûner pendant le mois de ramadan implique l’obligation de garder secret tout ce qui concerne les imams et l’organisation de la daʿwa. Rompre le jeûne correspond, par conséquent, au jour de l’avènement du Mahdī et à l’abrogation partielle de la taqiyya. Il va sans dire que le Mahdī dont il est question ici n’est autre que ʿAbd Allāh al-Mahdī, le onzième imam selon la généalogie officielle des Fatimides. En prenant le pouvoir en Tunisie en 909 et en fondant Mahdiyya pour capitale, l’imam sort de la clandestinité et devient le dirigeant politique d’un État.
Pourquoi l’abrogation de la taqiyya est-elle qualifiée de “partielle” par al- Nuʿmān ? Il est clair que la fondation de Mahdiyya signe la fin de la clandestinité et de la disparition du voile de la peur (ḥiǧāb al-ḫawf), mais elle ne signe pas la fin de la distinction entre le ẓāhir et le bāṭin. L’abolition de cette distinction ne se produira qu’avec al-Qāʾim (le Sauveur) qui permettra à l’humanité d’entrer dans un nouveau « cycle de manifestation » (dawr al-kašf) durant lequel la connaissance salvatrice sera directement accessible, sans loi, sans rite et sans religion établie. Les théologiens ismaéliens au service des Fatimides, comme al-Kirmānī et al-Nuʿmān, ont tout fait pour faire durer les attentes messianiques en les repoussant vers un avenir de plus en plus lointain. D’ailleurs, on le voit bien avec les surnoms des imams : si les deux premiers imams-califes fatimides portent encore des surnoms messianiques (al-Mahdī al-Qāʾim), leurs successeurs se contentent des noms plus neutres tels que al-Manṣūr, al-Muʿizz, al-ʿAzīz, etc. Ce revirement était loin de plaire aux autres ismaéliens, en particulier les Carmathes, qui ont fini par accuser les Fatimides d’être des imposteurs.
Dans le deuxième moment de son introduction, intitulé « L’imam fatimide comme philosophe néoplatonicien », l’A. revient sur l’appel à la modération que fait al-Kirmānī et qui « a tant exaspéré les extrémistes carmathes et druzes » (p. 25). Pour que l’âme devienne vertueuse, elle ne peut que respecter la loi du ẓāhir, en premier lieu les lois du Coran dans leur sens littéral. Seuls les initiés peuvent s’ouvrir à la science du bāṭin. Nous retrouvons avec al-Kirmānī la vraie réalité politico-religieuse de l’Empire fatimide : obligation est faite à tous les musulmans de respecter la lettre de la loi. Quant à son esprit, il est réservé aux initiés ismaéliens. L’influence de la philosophie néoplatonicienne sur la science ésotérique dont parle al-Kirmānī, entre autres, se fait encore sentir à cette époque – d’où le titre donné à la section –, même si les auteurs ismaéliens évitent d’en parler et vont même jusqu’à adopter une attitude hostile envers le savoir philosophique. C’est une attitude ambiguë en effet : al-Kirmānī s’appuie bien sur les écrits des philosophes comme al-Fārābī ou al-Kindī, mais il s’arrange toujours pour ne pas les citer nommément et va même jusqu’à les accuser d’impiété. Les philosophes sont, dans le meilleur des cas, des voleurs, comme c’est le cas chez le dāʿī contemporain d’al-Kirmānī, Aḥmad al-Naysābūrī, car ils n’ont pas hésité à voler certaines de leurs idées philosophiques aux prophètes et à ceux qui « détiennent la vérité » (ahl al-ḥaqāʾiq), à savoir les imams[8] ; dans le pire des cas, ce sont des athées, surtout quand il s’agit des philosophes grecs traduits en arabe, c’est le cas chez Abū Yaʿqūb al-Siǧistānī (m. vers 361/971)[9].
Le troisième moment de cette introduction est intitulé « La révolte druze », menée par Ḥamza ibn ʿAlī et Naštakīn al-Darazī : cette réaction à l’ismaélisme modéré professe qu’al-Ḥākim était l’ultime manifestation de la divinité sous une forme humaine et qu’il aurait déclaré l’avènement du dawr al-kašf, le cycle de la manifestation, ce qui implique l’abrogation de toutes les religions antérieures et la fin de tout écrit ou loi révélée. C’est un dépassement de tous les sens du texte coranique, qu’il s’agisse du sens littéral ou caché. L’A. signale cependant que, malgré les pires accusations dont les Druzes étaient victimes, « on cherchera en vain de tels excès dans les livres religieux druzes » (p. 30).
On ne pourra pas rendre compte ici de la richesse de cet ouvrage qui deviendra, à n’en pas douter, une référence incontournable des études fatimides.
Le chapitre 1 (« La prédication shi’ite ismaélienne en Égypte fatimide : ses aspects ésotériques et exotériques ») montre l’importance des sermons et des prêches dans les tentatives de consolidation d’un État shiite. En effet, le problème majeur des Fatimides renvoie à ce que Henry Corbin appela leur « paradoxe » ou « drame » : « Dans quelle mesure une sodalité ésotérique était-elle compatible avec l’organisation officielle d’un État ?[10]. » Le souverain fatimide était un imam ismaélien pour la minorité ismaélienne, mais également un calife pour la majorité des musulmans sunnites. Comment alors maintenir l’équilibre entre ces deux tendances ? Les sermons et les prêches, auxquels il faut ajouter les maǧālis al-ḥikma, les séances de la sagesse, illustrent bien la bipolarité de cet État. Les souverains veillaient à ce que les prêches et les sermons assurent une prédication externe ou « exotérique » adressée à l’ensemble des musulmans, et que les maǧālis al-ḥikma maintiennent une prédication interne ou « ésotérique », destinées aux seuls initiés de l’ismaélisme.
Le chapitre 2 (« Les fêtes shi’ites en Égypte Fatimide ») montre comment les Fatimides ont progressivement réussi à introduire les fêtes shiites en Égypte sunnite. Il s’agit en premier lieu des fêtes de ʿĀšūrāʾ, le martyr d’al-Ḥusayn, que les shiites égyptiens célébraient discrètement avant l’arrivée des Fatimides. Ceux-ci ont fini par l’institutionnaliser tout en évitant les débordements incontrôlables d’ardeur religieuse et les affrontements parfois violents qui opposaient les shiites à la majorité sunnite. On célébrait aussi la fête de Ġadīr Ḫumm officialisée par le calife al-Muʿizz en 362/972. Cette fête, qu’on célèbre le 18 du onzième mois, ḏū al-ḥiǧǧa, et qui marque le jour où le prophète de l’islam aurait proclamé son cousin et gendre ʿAlī comme mawlā (seigneur) des musulmans, causait beaucoup de troubles au Caire, d’où son interdiction par le calife al-Ḥākim, en 399/1009.
Le chapitre 3 (« Jeux, sport et plaisanterie, témoins d’une sagesse divine ») étudie la réhabilitation des fêtes profanes, foires et autres frivolités (hazl) par les Fatimides. Souvent, ce hazl n’était pas du goût de l’islam rigoriste qui lui opposait le ǧidd (le sérieux) : « Le jeu, nous dit al-Šāfiʿī, n’appartient pas à la pratique de l’homme religieux et est contraire à la virilité[11]. » Cela n’a jamais empêché les musulmans d’apprécier les foires et les frivolités, et l’époque mamelouk et ottomane ne manque pas de documentation relative aux jeux, ce qui est loin d’être le cas pour l’époque fatimide. Néanmoins, on dispose d’un fragment de la Chronique fatimide d’al-Musabbiḥī, cité par al-Maqrīzī, qui décrit une fête dans un lieu appelé « Prison de Joseph » à Gizeh : al-Maqrīzī nous raconte que le calife al-Ẓāhir, successeur d’al-Ḥākim, assista lui-même à cette fête où pendant deux semaines des bohémiens (ramādiyya) faisaient des plaisanteries et des boniments de tout genre[12]. Pour l’époque d’al-Ḥākim elle-même, l’A. se réfère à un témoignage druze, « passé largement inaperçu dans les études consacrées au Caire fatimide » (p. 70). Il s’agit de la onzième épître des Rasāʾil al-ḥikma intitulée : Kitāb fīhi ḥaqāʾiq mā yaẓhar quddāma mawlānā ǧalla ḏikruhu min al-hazl (« Écrit exposant le vrai sens des badinages qui se font devant Notre Seigneur, que sa mémoire soit exaltée »)[13]. Ce traité nous dit que malgré l’interdiction par al-Ḥākim de toute sorte d’amusement, on le voyait souvent lui-même transgresser ses propres édits et continuer à fréquenter les foires, où la charia était transgressée (ce qui renvoie à la mission même d’al-Ḥākim : l’abrogation de cette charia, ainsi que toutes ses interprétations ésotériques).
Le chapitre 4 (« Comment déterminer le début et la fin du jeûne de ramadan ? ») analyse ce « point de discorde entre sunnites et ismaéliens en Égypte fatimide », comme l’indique le sous-titre. Selon l’A., bien que les Fatimides se soient toujours abstenus de convertir massivement les Égyptiens au shiisme ismaélien, cela ne les a pas empêchés de leur imposer la manière ismaélienne d’accomplir les obligations religieuses. L’exemple le plus parlant est la définition divergente du calendrier de ramadan, ce qui générait souvent des troubles et des tentatives de rébellion. D’après le traité d’al-Kirmānī intitulé al-Risāla al-lāzima fī ṣawm šahr ramaḍān[14] qui serait, selon l’A., le premier traité ismaélien à s’intéresser, de manière technique et avec des arguments philosophiques au calcul astronomique (ḥisāb). Le jeûne du ramadan est basé sur la ruʾyat al-hilāl (la vision du croissant). La plupart des sunnites soutient qu’il s’agit d’une vision opérée par l’œil, tandis qu’al-Kirmānī, fidèle à sa conception ismaélienne, parle d’une vision spirituelle basée sur le ḥisāb : le mois commence lorsque la lune quitte sa conjonction avec le soleil et se sépare de lui. Ce calcul est une critique à peine voilée de la conception sunnite de la nature, surtout dans l’acharisme où les lois de la nature ne seraient qu’une fiction inventée par l’homme. En effet, grâce à une sorte de création continuée, Dieu crée à chaque moment chaque phénomène ; rien ne garantit, par exemple, qu’il fasse en sorte que la lune se sépare du soleil ou que les mouvements des corps célestes fonctionnent avec la même régularité. Il est donc nécessaire de s’appuyer sur une observation continuelle et à l’œil nu, sans ruʾyat al-hilāl ni certitude sur le calendrier ou sur les fêtes religieuses. Pour al-Kirmānī, un tel calendrier peut être rendu impossible par les conditions météorologique ou astronomique ; il est donc imparfait et ne peut être recommandé, ni par Dieu, ni par le prophète, ni par l’imam.
Au chapitre 5 (« Invention et translation de la tête d’al-Ḥusayn [raʾs al-Ḥusayn] au Caire sous les Fatimides »), l’A. revient sur le culte shiite d’al-Ḥusayn, sayyid al-šuhadāʾ (prince des martyrs), qui serait, selon Ignaz Goldziher et Bernardus D. Eerdmans, une islamisation du culte babylonien de Tammūz-Adonis[15]. Cette thèse est contestée par certains shiites qui trouvent plutôt des similitudes entre la passion d’al-Ḥusayn et la passion du Christ. Mais l’intérêt de l’A. se porte sur les raisons du transfert de la tête d’al-Ḥusayn, au Caire après un passage mouvementé par Damas. Ce pourrait refléter la volonté des Fatimides de faire du Caire une vraie capitale du monde musulman et un centre de pèlerinage pour tous les shiites. Or, la tête d’al-Ḥusayn n’a été intégrée dans le culte officiel des Fatimides que tardivement dans leur histoire, à peu près dix-huit ans avant que Saladin ne détrône le dernier calife fatimide. En se référant aux travaux de Paula Sanders et de Caroline Williams16, l’A. explique ce retard par la progressive importance donnée au culte des saints shiites face aux défaites militaires (p. 110). Pour ne pas perdre le soutien de la population égyptienne, le pouvoir fatimide lui concède des célébrations de ce genre, « dont l’origine shi’ite était plus ou moins oubliée par la masse sunnite » (p. 110). À cela s’ajoute les tentatives de « dé-ismaélisation » de l’État fatimide entreprises par certains vizirs étrangers, tels que l’arménien Badr al-Ǧamālī, pour sauver l’empire de la ruine et le rendre plus attrayant à la majorité sunnite.
Au chapitre 6 (« Le calife fatimide al-Ḥākim a-t-il voulu s’emparer des reliques du prophète Muhammad ? »), l’A. revient sur un épisode audacieux de la vie d’al-Ḥākim. On sait que le culte des reliques de l’islam a une grande importance pour la plupart des musulmans ; l’on n’a qu’à observer les touristes musulmans se précipiter à la salle des reliques (Has Oda) du palais de Topkapi à Istanbul pour s’en convaincre. Déjà en 1888, Goldziher remarquait que ce culte ne cessait de croître dans l’islam classique (vie-viie/xiie-xviiie s.) à mesure que se développait le culte du Prophète[17]. Malgré l’opposition des rigoristes de tout bord, qui ne cessent de traiter ce culte de bidʿa (innovation blâmable), celui-ci demeure un phénomène universel dans l’islam, aussi bien chez les shiites que chez les sunnites. Al-Maqrīzī nous raconte qu’en 704/1304, le théologien rigoriste Ibn Taymiyya (m. 728/1328) a failli être lynché par la foule lorsqu’il essaya de briser, dans une mosquée de Damas, une empreinte du pied du Prophète (p. 119)[18]. Les Wahhabites détruisent au xixe siècle d’innombrables tombeaux et reliques dans les lieux saints même de l’islam, à la Mecque et à Médine. Malgré toutes ces oppositions, la vénération des reliques n’a jamais cessé, bien au contraire, le shiisme a même étendu le culte du Prophète à celui de l’imam ʿAlī et à tous les imams qui, à leurs yeux, sont les seuls successeurs légitimes de Muḥammad[19]. Cela apparaît clairement dans l’histoire des Fatimides et de la pérégrination de la tête d’al-Ḥusayn. Le « plan rocambolesque » d’al-Ḥākim qui consiste à exhumer le prophète et les deux premiers califes de leurs tombes à Médine et à transférer leurs restes au Caire, est-il un fait historique ou d’une légende forgée de toute pièce ? À première vue, tout indique que cette histoire doit être classée parmi les nombreuses légendes auxquelles la singulière personnalité d’al-Ḥākim a donné lieu. Ce qui plaide en ce sens, c’est que ce récit ne figure dans aucune des sources habituelles de l’histoire fatimide relatives à cette époque : elle ne figure ni dans les chroniques de Yaḥyā ibn Saʿīd al-Anṭākī[20], ni dans celles d’al-Maqrīzī[21]. Mais on le trouve chez des auteurs bien postérieurs à cette époque, usant de sources inconnues ou perdues, tels que le géographe andalou al-Bakrī (m. 487/1094), le biographe de l᾽émir de la Mecque al-Fāsī (m. 833/1429) ou l’historien persan Mīrkhwānd (m. 904/1498)[22]. L’enquête de l’A. aboutit tout d’abord à l’idée que la violation et le pillage de la tombe vénérée du Prophète et des premiers califes est un lieu commun dans la littérature arabe (p. 124). C’est le symbole d’un sacrilège suprême perpétré par les pires ennemis de l’islam orthodoxe : les shiites, en particulier les ismaéliens, ou les chrétiens, associés aux croisés. Mais il y a un fait troublant, confirmé par plusieurs sources (p. 125), qui nous oblige à ne pas nous en tenir à ce lieu commun : al-Bakrī rapporte qu’en 461/1068 (c’est-à-dire moins de cinquante ans après la mort d’al-Ḥākim), ce dernier a fait construire sur la route menant du Caire à Fusṭāṭ, trois mausolées ou mašāhid, qui seraient destinés à abriter les restes du Prophète et des deux premiers califes, transférés de Médine. Le mausolée de gauche a été démoli à l’époque ottomane ; celui du milieu, le plus grand des trois, connu sous le nom de la mosquée de Muḥammad al-Anwar, existe toujours bien qu’il ait été rebâti au xviiie siècle. Quant au mausolée de droite, il aurait disparu à une époque indéterminée. Dès lors, l’information d’al-Bakrī n’a rien d’improbable, et il est donc légitime de se demander pourquoi al-Ḥākim, le plus illustre des ismaéliens, aurait donné une nouvelle sépulture à Abū Bakr et à ʿUmar, les deux califes haïs par les shiites pour avoir volé le pouvoir à l’imam ʿAlī, d’autant plus que ce calife les a fait maudire en public à plusieurs reprises[23] ? On a là un mystère de l’histoire qui demande à être élucidé.
Le chapitre 7 a pour titre « Les interdictions alimentaires du calife fatimide al-Ḥākim. Marque de folie ou annonce d’un règne messianique ? » Le désir d’al-Ḥākim de voler les restes du prophète de l’islam et de le transférer au Caire fut souvent taxé de folie par plusieurs historiens. Il en va de même des interdictions alimentaires insolites que ce calife imposa aux musulmans de son empire : certains aliments et boissons prohibées par la charia d’abord, animaux marins, en particulier les poissons sans écailles ensuite. Leur interdiction paraît s’opposer à ce qui dit le Coran[24], mais certains fuqahāʾ et certains juristes de tendance hanbalite semblent, sinon les interdire, du moins les déconseiller. Al-Qāḍī al-Nuʿmān interdit catégoriquement les poissons sans écailles dans son Daʿāʾim al-islām, manuel du fiqh de référence pour les ismaéliens[25]. La troisième catégorie de ces interdictions est beaucoup plus étrange : elle frappe en effet la vente et la consommation de la mulūḫiyya (variété de mauve commune au Proche-Orient), la roquette (ǧarǧīr), les lupins (tirmis) et la mutawakkiliyya (peut-être une sorte de laitue ?). Sans aucun fondement dans la loi musulmane, elles rappellent celles, antiques, associées à la doctrine de Pythagore. Celui-ci avait banni la mauve, ou corète, parce qu’elle est, nous dit Jamblique, « le premier messager et le premier indice de la sympathie entre ce qu’il y a dans les cieux et ce qui se trouve sur terre[26] ». L’interdiction de manger la mauve serait alors due à son caractère d’intermédiaire entre le ciel et la terre : grâce à ses feuilles, elle se saisit de l’influx céleste et ses racines se chargent ensuite de le transmettre à la terre. De même, ses racines vont capter les âmes des morts pour les acheminer vers le soleil. Par ces mouvements, la mauve inscrit en son sein l’unité du monde et de l’existence telle qu’elle est décrite par la philosophie néoplatonicienne. Pour l’A., c’est une raison sérieuse qui expliquerait mieux l’interdiction faite par le calife, que celle de sa prétendue folie ou du fait que ces aliments étaient appréciés des ennemis de ʿAlī (p. 146). La vraie motivation serait d’origine pythagoricienne : il serait interdit de consommer des plantes qui permettent aux âmes de remonter vers les cieux et de communiquer avec le monde céleste, au risque de corrompre le processus sotériologique et de rompre toute communication entre les âmes des défunts avec le monde céleste (p. 147).
Le chapitre 8 (« La khalwa druze. Lieu de culte ou assemblée profane ? ») est d’une grande originalité. Il s’agit d’une enquête qui cherche à définir la nature des cultes pratiqués par les Druzes. Il faut préciser à ce propos que le shiisme a été souvent « exposé à la tentation d’abolir la charia en l’allégorisant » (p. 153). Le vrai initié, celui qui connaît le sens caché des textes sacrés, n’a pas besoin de pratiquer des cultes jugés parfois absurdes. Dans l’histoire du shiisme, plusieurs mouvements comme les Carmathes, les « Assassins » de ʿAlamūt, les Nuṣayrīs et autres mouvements ultra-shiites dits ġulāt, ont soutenu le fait que les initiés sont automatiquement dispensés de pratiquer l’aspect extérieur des prescriptions légales. Mais d’autres théologiens shiites modérés, duodécimains ou ismaéliens, insistent fortement sur la parfaite complémentarité du ẓāhir et du bāṭin. L’ismaélisme fatimide, on l’a vu avec al-Kirmānī, refuse d’entériner les tendances extrémistes du mouvement shiite initial, en ce qu’elles menaceraient la stabilité du régime. Al-Kirmānī professe plutôt le strict équilibre entre « le culte par la pratique » (al-ʿibāda al-ʿamaliyya) et « le culte par la connaissance » (al-ʿibāda al-ʿilmiyya). Mais cela ne l’empêche pas de déclarer que les actions rituelles imposées par le Coran, privées de leur signification cachée et, par conséquent, de leur légitimité « rationnelle », sont insensées, nulles et non avenues. Il en va ainsi du pèlerinage à la Mecque, le ḥaǧǧ : il ne sert à rien d’entreprendre un long voyage dans le seul but est de tourner autour d’une pierre banale car s’il est dépourvu du bāṭin, le ẓāhir du ḥaǧǧ serait absurde[27]. L’essentiel pour al-Kirmānī est d’observer un certain équilibre entre l’esprit et la lettre des textes sacrés et de ne pas tomber dans les travers des mouvements antinomistes propres à menacer les bases politiques des Fatimides. En effet, à cette époque et tout particulièrement en 408/1017, apparaît le traité al-Naqḍ al-ḫafī (« L’Abrogation cachée ») de Ḥamza ibn ʿAlī, l’un des initiateurs de ce mouvement antinomiste qui deviendra la religion druze. Les propos de son traité sont à mille lieux des propos modérés de son contemporain al-Kirmānī car il y démontre comment le calife fatimide al-Ḥākim, considéré comme la dernière manifestation de la divinité dans une enveloppe charnelle, a abrogé les « piliers de l’islam ». Bien plus, après avoir révélé le caractère polythéiste de la profession de foi, la šahāda, Ḥamza ibn ʿAlī prétend qu’al-Ḥākim a rompu le jeûne en plein ramadan dans la mosquée al-Azhar, libéré le peuple de l’aumône légale, n’observait plus l’obligation de la prière, etc. Bref, al-Ḥākim n’hésitait jamais, selon Ḥamza ibn ʿAlī, à entreprendre toute action propre à manifester son rejet de l’aspect extérieur (ẓāhir) de la charia. Ḥamza ibn ʿAlī va même jusqu’à décrire al-Bayt al-Ḥarām à la Mecque comme un asile d’aliénés et de son revêtement par la fameuse kiswa qui, chaque année, était offerte en grande pompe par les califes d’Égypte. D’ailleurs, en traitant les maǧālis al-ḥikma (les assemblées de la sagesse) où les initiés ismaéliens expliquaient ésotériquement les rites de l’islam, d’« enfantillages » (p. 155), Ḥamza ibn ʿAlī déclare qu’avec la manifestation de la divinité en al-Ḥākim, l’islam a été abrogé non seulement en son sens exotérique, mais aussi ésotérique. À la place des « piliers de l’islam », Ḥamza ibn ʿAlī propose aux Druzes de les remplacer par les « vertus unitaires religieuses » (ḫiṣāl tawḥīdiyya dīniyya), à savoir « la véracité (al-ṣidq) du langage la protection (ḥifẓ) des frères, l’abandon (tark) de tous les cultes antérieurs, la libération (barʾa) des forces du mal et de l’oppression, la profession de l’unicité (tawḥīd) de Notre-Seigneur, la satisfaction (al-riḍā) envers ses actions et la soumission (al-taslīm) à ses commandements » (p. 156). À les examiner de près, on remarque qu’il s’agit là plutôt de vertus morales que de rites bien déterminés. Et l’on cherche en vain dans les écrits de cette nouvelle religion prêchée par Ḥamza ibn ʿAlī et ses successeurs un culte spécifique ou une pratique rituelle qui remplacerait les rites musulmans. D’où la question de l’A. : « Les Druzes suivent-ils un rituel religieux ou sont-ils les adeptes d’une sorte d’école philosophique, voire d’un mouvement à vocation essentiellement politique et sociale ? » (p. 158). Quoi qu’en disent certains Druzes contemporains, il est impossible d’affirmer qu’un système purement « spirituel » et philosophique, basé sur de simples prescriptions morales, ait pu construire et maintenir une communauté, telle que celle que l’on connaît aujourd’hui, d’autant plus que la majorité était de simples paysans illettrés. Les écrits sur cette communauté sont certes rares et souvent contradictoires, mais ceux dont on dispose parlent des rituels des maǧālis et des ḫalawāt (réunions hebdomadaires, tous les jeudis) : un témoignage digne de foi sur ces réunions, est celui d’un Druze converti au christianisme et publié, en traduction allemande, dans les Reisen im Orient de Julius Petermann[28]. L’auteur y parle de ces réunions tenues chaque jeudi soir, où les initiés (ʿuqqāl) du village se réunissent en un endroit nommé maǧlis ou ḫalwa. Les non-initiés (ǧuhhāl) en sont exclus. Dans ces maǧālis, on psalmodie des textes tirés du Canon, comme font les musulmans avec le Coran, on les explique, les commente et on récite des poèmes du genre ʿaskariyyāt, poèmes militaires glorifiant la parousie d’al-Ḥākim et le triomphe final de la religion druze. Après ces rituels, toutes les femmes et les hommes se retirent et ne restent que les initiés du plus haut rang (appelé aǧāwīd), qui continuent la séance. Que se passe dans les ḫalwa des aǧāwīd ? Aucune information fiable ne semble disponible quant au contenu du cérémonial pratiqué par les initiés des grades supérieurs. Les résultats de l’enquête passionnante de l’A. nous conduisent finalement à conclure que le druzisme est loin de constituer une « religion philosophique » sans culte et que, séparé de la terre natale égyptienne, il a pu opérer un rapprochement avec la plupart des pratiques populaires musulmanes. Cette nouvelle religion a même développé une organisation des cultes et une vie spirituelle qui doivent beaucoup au soufisme.
Le chapitre 9 (« Le culte du veau d’or chez les Druzes ») revient sur l’une des nombreuses accusations d’extravagances ou de perversions (dont l’inceste) qui composent la propagande anti-druze. Ces derniers adoreraient dans le secret de leur ḫalwa, leur divinité, le sixième calife fatimide, al-Ḥākim, sous la figure d’une idole en or ou en argent, qui aurait la forme d’un veau. Dès le xviie siècle, plusieurs voyageurs parcourant les montagnes de Syrie et du Liban, ainsi que des missionnaires – des Jésuites dans leur majorité – opérant parmi les maronites de la région, ont rapporté en Occident cette rumeur. Après une longue vérification sur l’origine et l’étendue de cette rumeur, l’A. aboutit aux résultats suivants : dans les écrits de Ḥamza ibn ʿAlī, le veau est toujours mentionné en un sens péjoratif, ce qui s’oppose à toute idée d’associer cet animal à un éventuel culte d’al-Ḥākim. En réalité, Ḥamza ne fait que reprendre une longue tradition shiite qui voit dans le récit coranique de l’adoration du veau d’or – considérablement grossi par une multitude de détails relevant des qiṣaṣ al-anbiyāʾ – une préfiguration de la trahison dont étaient victimes ʿAlī et tous les imams shiites : au lieu de reconnaître le vrai successeur du Prophète, la majorité des musulmans « ont adoré le veau d’or » et se sont éloignés de la bonne voie du Prophète Muḥammad. Il serait donc absurde d’associer al-Ḥākim au symbole du veau. L’A. se demande ensuite s’il ne s’agit pas finalement alors d’une innovation postérieure à Ḥamza, mais son enquête concernant la postérité de Ḥamza ne trouve rien de convaincant qui associerait al-Ḥākim au symbole du veau. Il s’agit finalement d’un mythe de plus qui a alimenté le phantasme de certains orientalistes et amateurs d’arts européens, mais qui ne correspond à rien de convaincant.
Le chapitre 10 (« Les prétendues origines druzes de la franc-maçonnerie. Naissance et persistance d’un mythe ») examine un autre mythe forgé de toute pièce par des études scientifiques portant sur l’ismaélisme et le druzisme. Curieusement, la prétendue origine druze de la franc-maçonnerie a été adopté par certains druzes tels que Kemal Joumblatt qui déclarait un jour qu’un druze est « un croyant de toutes les religions du monde… un peu à la manière des rose-croix, qui sont les adeptes de toutes les religions, et d’ailleurs prétendent être les druzes de l’Occident[29] ». S’agit-il d’une forme de taqiyya ? En tout cas, précise l’A., Joumblatt faisait partie des ǧuhhāl, donc était loin d’être initié aux arcanes du druzisme.
Le dernier chapitre (« La théorie des Trois Imposteurs et ses origines islamiques ») revient sur une histoire dont on trouve des traces chez Gérard de Nerval. Un des passages de son Voyage en Orient fait allusion aux Trois Imposteurs (Moïse, Jésus et Muḥammad)[30], thème en vogue au milieu du xixe siècle. Ernest Renan l’évoque dans son Averroès et l’Averroïsme en en situant la naissance dans la cour de Frédéric II, grand admirateur des Arabes dont l’esprit « représentait à ses yeux la liberté de penser et la science rationnelle [31] ». Depuis le Moyen-Âge, l’on parle d’un soi-disant livre intitulé les Trois Imposteurs, en fait, ce Liber de Tribus Impostoribus n’a été rédigé qu’au xviie siècle en Allemagne, dans un milieu spinoziste. Renan en voit l’origine dans l’islam puisqu’il développe une conception de la prophétie étrangère au judaïsme et au christianisme. Qui plus est, la thèse selon laquelle les prophètes ne sont que des imposteurs est défendue dans la philosophie arabe par Ibn Rāwandī et par Abū Bakr al-Rāzī. Louis Massignon, quant à lui, croit avoir trouvé l’origine des Trois Imposteurs chez les Carmathes. Cela revient à donner raison à de Nerval qui avait vu juste en situant d’une façon intuitive la théorie des Trois Imposteurs en milieu ismaélien.
Au terme de cette lecture, nous ne pouvons que saluer, encore une fois, la rigueur scientifique avec laquelle Daniel De Smet a conduit ses enquêtes dans son travail. On a là un superbe ouvrage, tant par sa facture matérielle, la richesse documentaire des textes commentés et par le soin et l’érudition mis au service des dites enquêtes.
Notes
_____________________
[1] De Smet, Daniel, « Les hérétiques musulmans : un Lumpenprolétariat au ban de la société ? », Acta Orientalia Belgica 34, 2021, p. 304-310.
[2] Sur Abū al-Ḫaṭṭāb, voir l’excellente étude de Heinz Halm, Die islamische Gnosis. Die extreme Schia und die ʿAlawiten, Zürich-München, Artemis, 1982, p. 199-206.
[3] Al-Kirmānī, Ḥamīd al-Dīn, Kitāb al-Maṣābīḥ fī iṯbāt al-imāma, Paul E. Walker (éd. et trad.), Master of Age. An Islamic Treatise on the Necessity of the Imamate, London-New York, Tauris, The Institute of Ismaili Studies, 2007, p. 80 du texte arabe.
[4] Cette date ne correspond en aucun cas à l’avènement d’al-Mahdī. Pour ce problème de datation, voir p. 21, n. 1 du livre de De Smet.
[5] Al-Qāḍī al-Nuʿmān, Taʾwīl daʿāʾim al-islām, Muḥammad al-Aʿẓamī (éd.), al-Qāhira, Dār al-Maʿārif, 1967-1972, vol. 3, p. 107-142.
[6] « Mange, bois et rends la fraîcheur à tes yeux. Dès que tu vois quelque homme, dis : “J’ai voué un jeûne au Miséricordieux ; je ne parlerai ce jour à personne !” » (C. Maryam XIX, 26), c’est nous qui traduisons.
[7] La phrase est ambiguë et nous ne pouvons pas deviner dans quel sens De Smet l’entend. Le mois de ramadan est de 29 ou de 30 jours et cela c’est la vision du croissant (ruʾyat al-hilāl) qui le détermine.
[8] Al-Naysābūrī, Aḥmad ibn Ibrāhīm, Kitāb iṯbāt al-imāma, Arzina R. Lalani (éd. et trad.), Degrees of Excellence: A Fatimid Treatise on Leadership in Islam, London-New York, Tauris, The Institute of Ismaili Studies, 2010, p. 110 (éd.), p. 83 (trad.).
[9] Al-Siǧistānī, Abū Yaʿqūb, Kitāb iṯbāt al-nubuwwāt, ʿᾹrif Tāmir (éd.), Bayrūt, Dār al-Mašriq, 1982.
[10] Corbin, Henry, Histoire de la philosophie islamique, vol. 1 : Des origines jusqu’à la mort d’Averroès, Paris, Gallimard, 1964, p. 138.
[11] Al-Imām al-Šāfiʿī, Kitāb al-Umm, Bayrūt, Dār al-Fikr, 1980, vol. 6, p. 224.
[12] Al-Maqrīzī, Aḥmad, Kitāb al-Khiṭaṭ al-Maqrīziyya, Bulāq, Maṭbaʿat al-Nīl, 1906, vol. 1, p. 207.
[13] Daniel De Smet, Les Épîtres sacrées des Druzes, Rasā᾽il al-Ḥikma, Louvain, Peeters, 2007, p. 225-241, 536-550.
[14] Muṣṭafā Ġālib (éd.), Maǧmūʿat Rasāʾil al-Kirmānī, Bayrūt, al-Muʾassasa al-Ǧāmiʿiyya li-l-Dirāsāt wa-l-Našr wa-l-Tawzīʿ, 1987.
[15] Goldziher, Ignaz, Mohammedanische Studien, Halle/Saale, Max Niemeyer, 1889, vol. 2, p. 331 ; Eerdmans, Bernardus D., « Der Ursprung der Ceremonien des Hosen-Festes », Zeitschrift für Assyriologie 9, 1894, p. 280-307.
[16] Sanders, Paula, « Claiming the Past: Ghadīr Khumm and the Rise of Ḥāfizī Historiography in Late Fatimid Egypt », Studia Islamica 75, 1992, p. 81-104 ; Williams, Caroline, « The Cult of ʿAlid Saints in Fatimid Monuments of Cairo. Part I: The Mosque of al-Aqmar », Muqarnas 1, 1983, p. 37-52.
[17] Goldziher, Mohammedanische Studien, vol. 2, p. 356-358, 366.
[18] Voir les propos d’al-Maqrīzī dans Rudolph Hartmann, « Al-Ḳadam bei Damaskus », Orientalistische Literaturzeitung 16, 1913, p. 115-118, ici 117.
[19] Amir-Moezzi, Mohammad Ali, Ali, le secret bien gardé. Figures du premier Maître en spiritualité shi’ite, Paris, CNRS, 2020, surtout le chapitre intitulé « Entre le divin et l’humain », p. 145-248 ; voir la recension de l’ouvrage dans MIDÉO 38, 2023.
[20] Al-Anṭākī, Yaḥyā ibn Saʿīd, Tārīḫ, Louis Cheikho (éd.), Beyrouth, Paris, Imprimerie catholique, 1909, ou l’édition et traduction par Ignace Kratchkovsky & Alexandr Vasiliev, Paris, Firmin Didot, 1932.
[21] Al-Maqrīzī, Aḥmad, Kitāb al-Khiṭaṭ al-Maqrīziyya ; Ittiʿāẓ al-ḥunafāʾ, vol. 1, Ǧamāl al-Dīn al-Šayyāl (éd.), al-Qāhira, Dār al-Maʿārif, 1967 ; vol. 2 et 3, Muḥammad Ḥilmī & Muḥammad Aḥmad (éd.), al-Qāhira, al-Maǧlis al-Aʿlā li-l-Šuʿūn al-Islāmiyya, 1971-1973.
[22] Al-Bakrī, Abū ʿUbayd, al-Masālik wa-l-mamālik, Adrian Van Leeuwen & André Ferré (éd.), Carthage, Bayt al-Ḥikma, 1992, vol. 2, p. 609-610 (n° 1015) ; Taqī al-Dīn al-Fāsī, al-ʿIqd al-ṯamīn fī taʾrīḫ al-balad al-amīn, Fuʾād Sayyid (éd.), Bayrūt, Muʾassasat al-Risāla, 1986, vol. 4, p. 77-78 ; Mīrkhwānd, Rawḍat al-ṣafāʾ, Bombay, 1847, p. 58.
[23] Allusion à sabb al-salaf, voir Ḥamza ibn ʿAlī, al-Naqḍ al-ḫafī, éd. et trad. dans De Smet, Les Epîtres sacrées des Druzes, p. 177-178.
[24] C. al-Māʾida V, 96.
[25] Al-Qāḍī al-Nuʿmān, Taʾwīl daʿāʾim al-islām, § 433, p. 123.
[26] Jamblique, Vie de Pythagore, introd., trad. et notes par Luc Brisson & Alain-Philippe Segonds, Paris, Les Belles Lettres, 1996, p. 63.
[27] Al-Kirmānī, Maṣābīḥ, p. 29-30 (éd.), p. 64 (trad.). Ibn Sabʿīn, le philosophe mystique andalou, va même jusqu’à qualifier les musulmans qui effectuent le ṭawāf autour de la Kaʿba de ḥumur al-madār (des ânes qui tournent autour du puits) : voir p. 154, n. 1 du livre de De Smet.
[28] Petermann, Julius H., Reisen im Orient. Zweite Ausgabe, Leipzig, Veit & Comp., 1856.
[29] Joumblatt, Kemal, Pour le Liban. Propos recueillis par Philippe Lapousterle, Paris, Stock, 1978, p. 72, 75, 77-80.
[30] De Nerval, Gérard, Voyage en Orient, Paris, La Pléiade, 1984, p. 532.
[31] Renan, Ernest, Averroès et l’Averroïsme, 3e éd., Paris, Michel Lévy, 1866, p. 287.
[1] De Smet, Daniel, « Les hérétiques musulmans : un Lumpenprolétariat au ban de la société ? », Acta Orientalia Belgica 34, 2021, p. 304-310.
[2] Sur Abū al-Ḫaṭṭāb, voir l’excellente étude de Heinz Halm, Die islamische Gnosis. Die extreme Schia und die ʿAlawiten, Zürich-München, Artemis, 1982, p. 199-206.
[3] Al-Kirmānī, Ḥamīd al-Dīn, Kitāb al-Maṣābīḥ fī iṯbāt al-imāma, Paul E. Walker (éd. et trad.), Master of Age. An Islamic Treatise on the Necessity of the Imamate, London-New York, Tauris, The Institute of Ismaili Studies, 2007, p. 80 du texte arabe.
[4] Cette date ne correspond en aucun cas à l’avènement d’al-Mahdī. Pour ce problème de datation, voir p. 21, n. 1 du livre de De Smet.
[5] Al-Qāḍī al-Nuʿmān, Taʾwīl daʿāʾim al-islām, Muḥammad al-Aʿẓamī (éd.), al-Qāhira, Dār al-Maʿārif, 1967-1972, vol. 3, p. 107-142.
[6] « Mange, bois et rends la fraîcheur à tes yeux. Dès que tu vois quelque homme, dis : “J’ai voué un jeûne au Miséricordieux ; je ne parlerai ce jour à personne !” » (C. Maryam XIX, 26), c’est nous qui traduisons.
[7] La phrase est ambiguë et nous ne pouvons pas deviner dans quel sens De Smet l’entend. Le mois de ramadan est de 29 ou de 30 jours et cela c’est la vision du croissant (ruʾyat al-hilāl) qui le détermine.
[8] Al-Naysābūrī, Aḥmad ibn Ibrāhīm, Kitāb iṯbāt al-imāma, Arzina R. Lalani (éd. et trad.), Degrees of Excellence: A Fatimid Treatise on Leadership in Islam, London-New York, Tauris, The Institute of Ismaili Studies, 2010, p. 110 (éd.), p. 83 (trad.).
[9] Al-Siǧistānī, Abū Yaʿqūb, Kitāb iṯbāt al-nubuwwāt, ʿᾹrif Tāmir (éd.), Bayrūt, Dār al-Mašriq, 1982.
[10] Corbin, Henry, Histoire de la philosophie islamique, vol. 1 : Des origines jusqu’à la mort d’Averroès, Paris, Gallimard, 1964, p. 138.
[11] Al-Imām al-Šāfiʿī, Kitāb al-Umm, Bayrūt, Dār al-Fikr, 1980, vol. 6, p. 224.
[12] Al-Maqrīzī, Aḥmad, Kitāb al-Khiṭaṭ al-Maqrīziyya, Bulāq, Maṭbaʿat al-Nīl, 1906, vol. 1, p. 207.
[13] Daniel De Smet, Les Épîtres sacrées des Druzes, Rasā᾽il al-Ḥikma, Louvain, Peeters, 2007, p. 225-241, 536-550.
[14] Muṣṭafā Ġālib (éd.), Maǧmūʿat Rasāʾil al-Kirmānī, Bayrūt, al-Muʾassasa al-Ǧāmiʿiyya li-l-Dirāsāt wa-l-Našr wa-l-Tawzīʿ, 1987.
[15] Goldziher, Ignaz, Mohammedanische Studien, Halle/Saale, Max Niemeyer, 1889, vol. 2, p. 331 ; Eerdmans, Bernardus D., « Der Ursprung der Ceremonien des Hosen-Festes », Zeitschrift für Assyriologie 9, 1894, p. 280-307.
[16] Sanders, Paula, « Claiming the Past: Ghadīr Khumm and the Rise of Ḥāfizī Historiography in Late Fatimid Egypt », Studia Islamica 75, 1992, p. 81-104 ; Williams, Caroline, « The Cult of ʿAlid Saints in Fatimid Monuments of Cairo. Part I: The Mosque of al-Aqmar », Muqarnas 1, 1983, p. 37-52.
[17] Goldziher, Mohammedanische Studien, vol. 2, p. 356-358, 366.
[18] Voir les propos d’al-Maqrīzī dans Rudolph Hartmann, « Al-Ḳadam bei Damaskus », Orientalistische Literaturzeitung 16, 1913, p. 115-118, ici 117.
[19] Amir-Moezzi, Mohammad Ali, Ali, le secret bien gardé. Figures du premier Maître en spiritualité shi’ite, Paris, CNRS, 2020, surtout le chapitre intitulé « Entre le divin et l’humain », p. 145-248 ; voir la recension de l’ouvrage dans MIDÉO 38, 2023.
[20] Al-Anṭākī, Yaḥyā ibn Saʿīd, Tārīḫ, Louis Cheikho (éd.), Beyrouth, Paris, Imprimerie catholique, 1909, ou l’édition et traduction par Ignace Kratchkovsky & Alexandr Vasiliev, Paris, Firmin Didot, 1932.
[21] Al-Maqrīzī, Aḥmad, Kitāb al-Khiṭaṭ al-Maqrīziyya ; Ittiʿāẓ al-ḥunafāʾ, vol. 1, Ǧamāl al-Dīn al-Šayyāl (éd.), al-Qāhira, Dār al-Maʿārif, 1967 ; vol. 2 et 3, Muḥammad Ḥilmī & Muḥammad Aḥmad (éd.), al-Qāhira, al-Maǧlis al-Aʿlā li-l-Šuʿūn al-Islāmiyya, 1971-1973.
[22] Al-Bakrī, Abū ʿUbayd, al-Masālik wa-l-mamālik, Adrian Van Leeuwen & André Ferré (éd.), Carthage, Bayt al-Ḥikma, 1992, vol. 2, p. 609-610 (n° 1015) ; Taqī al-Dīn al-Fāsī, al-ʿIqd al-ṯamīn fī taʾrīḫ al-balad al-amīn, Fuʾād Sayyid (éd.), Bayrūt, Muʾassasat al-Risāla, 1986, vol. 4, p. 77-78 ; Mīrkhwānd, Rawḍat al-ṣafāʾ, Bombay, 1847, p. 58.
[23] Allusion à sabb al-salaf, voir Ḥamza ibn ʿAlī, al-Naqḍ al-ḫafī, éd. et trad. dans De Smet, Les Epîtres sacrées des Druzes, p. 177-178.
[24] C. al-Māʾida V, 96.
[25] Al-Qāḍī al-Nuʿmān, Taʾwīl daʿāʾim al-islām, § 433, p. 123.
[26] Jamblique, Vie de Pythagore, introd., trad. et notes par Luc Brisson & Alain-Philippe Segonds, Paris, Les Belles Lettres, 1996, p. 63.
[27] Al-Kirmānī, Maṣābīḥ, p. 29-30 (éd.), p. 64 (trad.). Ibn Sabʿīn, le philosophe mystique andalou, va même jusqu’à qualifier les musulmans qui effectuent le ṭawāf autour de la Kaʿba de ḥumur al-madār (des ânes qui tournent autour du puits) : voir p. 154, n. 1 du livre de De Smet.
[28] Petermann, Julius H., Reisen im Orient. Zweite Ausgabe, Leipzig, Veit & Comp., 1856.
[29] Joumblatt, Kemal, Pour le Liban. Propos recueillis par Philippe Lapousterle, Paris, Stock, 1978, p. 72, 75, 77-80.
[30] De Nerval, Gérard, Voyage en Orient, Paris, La Pléiade, 1984, p. 532.
[31] Renan, Ernest, Averroès et l’Averroïsme, 3e éd., Paris, Michel Lévy, 1866, p. 287.