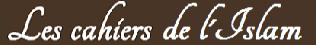- Mollā Ṣadrā :
-
Philosophe majeur de l’islam chiite durant la période safavide (1501–1736), Molla Ṣadrā (Ṣadr al-Dīn Shīrāzī), mort en 1649, élabora une œuvre métaphysique puissante et novatrice qui continue d’inspirer le monde intellectuel islamique. Son système philosophique, rassemblé sous le nom al-ḥikma al-muta‘āliya (“la sagesse transcendante”), repose sur une méthode synthétique unissant quatre sources fondamentales : la philosophie péripatéticienne, le Coran et la Sunna, le kalām (théologie spéculative), et la gnose (ʿirfān) proche du soufisme.
Sa pensée prend racine dans une culture persane en pleine transformation, intégrant l’héritage antique et les enseignements nouvellement institutionnalisés du chiisme et du soufisme. Héritier de la tradition philosophique islamique, influencée dès ses origines par les spéculations néoplatoniciennes grecques, Molla Ṣadrā tente de résoudre le conflit entre raison et révélation. Il y parvient par une approche où la mystique joue un rôle central — considérant que l’intuition intellectuelle, l’inspiration mystique et la révélation procèdent d’une même source divine.
Contrairement aux philosophes précédents, il ne sépare pas vérité religieuse et vérité philosophique. Son usage du Coran et des traditions prophétiques, bien qu’essentiel, est intégré comme appui conceptuel au raisonnement logique.
Sur le plan théorique, sa pensée repose sur deux piliers :
- La primauté de l’être (wujūd) : l’être est la réalité fondamentale, supérieure à l’essence.
- La modulation de l’être : toutes choses participent à l’être selon des degrés d’intensité.
Grâce à cette ontologie fluide, il explicite les rapports entre le Principe premier — le Réel absolu — et les réalités multiples du monde, tout en préservant la singularité de chaque existence. Il développe également des vues originales sur la connaissance, l’âme et les réalités suprasensibles, contribuant à la consolidation intellectuelle de la théologie chiite dans un contexte religieux et politique parfois hostile.
Enfin, l’étendue de son œuvre dépasse celle de ses prédécesseurs : il rédige des commentaires coraniques, des traités mystiques et des réflexions théologiques d’une grande ampleur. Son œuvre principale, en 9 volumes, intitulée Al-Asfār al-arbaʿa (Les quatre voyages de l’intellect) expose sa métaphysique de l’être, sa psychologie, sa cosmologie et sa théologie. Son Kitāb al-Mashāʿir (Le Livre des pénétrations métaphysiques), traité dense sur la nature de l’être a été traduit et commenté par Henry Corbin. Sa philosophie, qualifiée parfois de « prophétique », offre une voie de dépassement des oppositions entre soufisme et rationalisme, proposant une pensée de l’être et du réel où spiritualité, métaphysique et révélation coexistent en profondeur.
Voir aussi : Chî'â (شيعة), Ibn Sînâ (Avicenne)
|
Les Cahiers de l'Islam © 2012-2023. Tous droits réservés.
ISSN 2269-1995 Contact : redaction (at) lescahiersdelislam.fr |