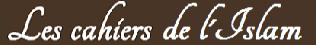- Ghazali [Ġazzālī] (al) :
-
Muḥammad ibn Muḥammad Abū Ḥamid Al-Ghazali (أبو حامد الغزالي) est né en 450 de l’Hégire, soit 1058 de l’ère chrétienne, dans le Khorassan (région située dans le nord-est de l'Iran).
Il aurait commencé, vers l’âge de sept ans, par étudier l’arabe et le persan, le Coran et les principes de religion. Après des études auprès de l’imam Al-Ismayli, à l'age de 23, il se rendit à Nīsābūr (Nīshāpūr), où il étudia le fiqh, la théologie dogmatique (kalām) et la logique, ainsi que, semble t-il, des éléments de philosophie, auprès de l’imam al-Ǧuwaynī, le jurisconsulte de rite chaféite le plus célèbre de l’époque.
La mort d’al-Ǧuwaynī (478 H/1085) voit s’achever la période d’apprentissage d’al-Ghazali et débuter celle de l’immersion dans la politique et de la fréquentation des allées du pouvoir. Il est ensuite nommé professeur à la madrasa Niẓāmiyya de Bagdad, l’un des centres de savoir et d’enseignement (sorte d’université) les plus importants et les plus connus dans l’Orient islamique à l’époque. Durant les quatre années où il occupe ce poste, il publie un certain nombre d’ouvrages sur le fiqh — qu’il enseigne — la logique et le kalām, les plus importants étant le Mustaẓhirī (ouvrage principalement dirigé contre les batinites) et al-Iqtisad fil-I’tiqad [le juste milieu dans la croyance], deux ouvrages de jurisprudence à caractère politique.
Al-Ghazali prend part à trois affrontements politiques et intellectuels majeurs qui secouent le monde islamique à cette époque, à savoir :
- la lutte entre la philosophie et la religion (entre la culture islamique et la culture grecque). Al-Ghazali étudie longuement la philosophie afin de mieux la réfuter. Le Tahāfut al-Falāsifa [Précipitation des philosophes] a eu un retentissement considérable dans le monde arabo-islamique, et jusque dans l’Europe chrétienne. Cependant, même s'il critique la philosophie et en particulier la métaphysique avicennienne il sera l'artisan de l'intégration de la logique au sein du fiqh et du kalām ;
- la lutte entre le sunnisme et le chiisme — il prend position pour le califat abbasside contre les batinites ;
- la lutte entre l’inspiration et la raison. S'il ne rejette pas la raison, la connaissance du divin relève in fine de l'expérience.
Vers 1095/488 H, al-Ghazali, alors âgé trente-huit ans, traverse une crise spirituelle qui dure à peu près six mois et que l’on peut résumer à un affrontement violent entre la raison et l’âme, entre le monde d’ici-bas et celui de l’au-delà. Il quitte Bagdad, et pendant près de deux ans, mène une vie d’ermite entre Damas, Jérusalem et La Mecque. C’est à cette époque qu’il commence à écrire le plus important de ses livres, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Din [Revivification des sciences de la foi]. Divisée en quatre parties, consacrées respectivement aux pratiques du culte, aux coutumes sociales, aux vices causes de perdition et aux vertus conduisant au salut, on trouve dans ses quatre volumes et ses quelques 1.500 pages l’essentiel de la pensée islamique religieuse du Moyen Age, sous une forme à la fois exhaustive, claire et simple qui explique la place unique qu’elle occupe dans l’histoire de la pensée islamique.
En 1104/498 H, al-Ghazali reprend ses fonctions à la madrasa Niẓāmiyya de Nīsābūr, à la demande du ministre seldjoukide Fakhr al-Mulk, après quelque dix années d'absence. En 503 H, il quitte Naysabur et regagne à nouveau Tus, sa ville natale où il meurt en 1111/505 H.
Œuvres traduites en français (par ordre alphabétique)[modifier]
- L'Alchimie du Bonheur, trad. & notes de Muhammad Marcelot, Alif, Lyon, 2010, (EAN 978-2-908087-22-2).
- Le chemin vers le Paradis. Le Minhâj, traduit de l’arabe par Djamel Ibn Fatah, Beyrouth, Albouraq, 2005, 296 pages.
- L'Epître des oiseaux ("Risalat al-Tayr") texte en ligne
- Erreur et délivrance (Al-Munqid min adalâl), trad. F. Jabre, Beyrouth, 1959. (Autobiographique. Récit de sa conversion au soufisme).
- Éthique du musulman, in M. Fateh, Mohammed al Ghazali. L'éthique du Musulman, Paris, Al Qalam, 1993.
- Le licite et l'illicite, éd. al-Bustane, Paris, 2002 (ISBN 978-2-910856-32-8). al-Ghazâlî, Le livre du licite et de l'illicite (Kitâb al-halâl wa-l-harâm), introduction, traduction de l'arabe et notes Régis Morelon, Paris, Vrin, 1981, XVIII
+339 p.Collection "Études musulmanes", XXV) ; seconde édition revue et corrigée, Paris, Vrin, 1991, 208 p.
- Livre de l'Amour, du Désir ardent, de l'intimité et du parfait contentement, introduction, traduction et notes par M.-L. Siauve. Préface de Roger Arnaldez. Librairie J.Vrin, Paris, 1986.
- Épître au disciple, traduction de Soufiane Ben Farhat, éd. Perspectives Éditions, Tunis, 2012 (ISBN 9789938843064).
- Le Livre de la patience, Tayeb Chouiref, Ed. la Ruche, 2002
- Le Livre de la science, Tayeb Chouiref, Ed. la Ruche, 2004
- Le Livre du savoir, Ed. de l'Aire, 2010
- Maladies de l’âme et maîtrise du cœur, Livre XXII de l’hyâ’ ‘Ulûm al-dîn intitulé : «Livre de la discipline de l’âme, de l’éducation des comportements moraux et du traitement des maladies du cœur», Préface par Maurice Borrmans,
Introduction, traduction et notes par Marie-Thérèse Hirsch, Collection "Patrimoines islam", Paris, Cerf, 2007, 192 pages.
- La paix du cœur. L'alchimie du bonheur ici-bas et dans l'au-delà (Kimiya'-yi sa'adat) (1097), trad., La Ruche, 2006, 54 p.
- La Perle précieuse (Al-Durra al-fâkhira), trad. de Lucien Gauthier, Alif, Lyon, 1995 (ISBN 978-2-908087-08-6)
- La perle précieuse (Ad-Doura al-fâkhira), trad. L. Gautier, 1878, rééd. Les Deux Océans, 1986.
- La revivification des sciences religieuses (Ihyâ' ulûm al-dîn), trad. A. Massouli, Alger, Entreprise nationale du livre, 1985.
- Le tabernacle des lumières (Mishkât al-anwâr), trad. R. Ladrière, Seuil, 1981. (Sa dernière œuvre. Sur la véracité du langage).
- Des vertus du mariage, trad. de A. Demazières, Alif, Condrieu, 1997 (EAN 978-2-908087-12-3)
Voir aussi : 'ulamā' (علماء), Ibn Sînâ (Avicenne), Kalâm (كلام), Makkī (al-), Maqâsid (المقاصد), Muḥāsibī (al), Rāzī (al) , Shāfi‘ī (as)
|
Les Cahiers de l'Islam © 2012-2023. Tous droits réservés.
ISSN 2269-1995 Contact : redaction (at) lescahiersdelislam.fr |