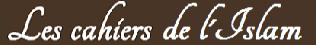- Suhrawardī :
-
Au carrefour de la philosophie post-avicennienne et de la mystique islamique, Shihāb al-Dīn Suhrawardī, dit Shaykh al-Ishrāq, se dresse comme une figure singulière, lumineuse et tragique. Né en 1155 dans la région de Sohraward, héritière lointaine des traditions mazdéennes, il incarne un renouveau de la pensée islamique. Son œuvre, traversée par une quête exigeante, tisse ensemble les fils d’Aristote et d’Avicenne, les éclats des sagesses antiques et les lueurs de la gnose orientale.
Sa philosophie de l’illumination (ḥikmat al-ishrāq) repose sur une vision audacieuse du monde : une hiérarchie d’effusions lumineuses émanant du Réel, venant s’imprimer sur la toile obscure de la matière. Loin de se limiter à une simple interprétation cosmologique, cette doctrine propose une véritable rupture épistémologique, une alternative profonde à l’aristotélisme et à l’avicennisme. Suhrawardī oppose à la connaissance médiée par les concepts abstraits une connaissance présentielle (ʿilm ḥuḍūrī) : celle qui naît d’une union immédiate entre l’être et la conscience, dans l’éclat d’une présence.
Cette pensée radicale s’élabore dans le cadre d’une méthode à la fois rationnelle et visionnaire. Si Suhrawardī adopte certains éléments logiques d’Avicenne, il critique les dérives de la scolastique péripatéticienne postérieure. Pour lui, tout possible — toute contingence — tend vers sa pleine actualisation, dans une ontologie du jaillissement et de la plénitude. Il ne s’agit pas d’abolir la logique, mais de la réorienter à la lumière d’une sagesse intuitive, inspirée par les anciens sages hellènes et les traditions prophétiques de l’Orient.
Son œuvre maîtresse, fondatrice de la philosophie illuminative s'intitule Ḥikmat al-Ishrāq (La Sagesse orientale). Elle propose une cosmologie fondée sur la lumière et critique les limites de l’avicennisme.
Mystique dans l’âme autant que philosophe dans le verbe, Suhrawardī mène une vie d’ascèse intense : solitude, jeûne, retraite, discipline corporelle destinée à libérer l’imagination active. Il recherche non l’effacement de soi, mais la conquête de son essence intime. Il fréquente les soufis, adopte leur mode de vie, et développe une eschatologie et une prophétologie audacieuses, perçues par certains comme un prolongement ésotérique de l’imāmologie ismaélienne.
Cet engagement le mène à Alep, auprès de Malik al-Zāhir, fils de Saladin, où il expose ses thèses avec courage. Face aux suspicions des docteurs de la Loi, qui voient en lui une menace pour l’unité de l’islam, le philosophe ne recule pas. Mal protégé par son ami le prince, il est condamné et exécuté en 1191 dans la citadelle d’Alep, à l’âge de trente-six ans.
Sa mort dramatique lui valut le titre de Shaykh maqtūl – le maître mis à mort. Mais ses disciples préfèrent l’appeler Shaykh al-Ishrāq, ou encore le maître de la sagesse orientale. Suhrawardī demeure l’un des rares penseurs à avoir uni la rigueur de la raison et l’intuition.
|
Les Cahiers de l'Islam © 2012-2023. Tous droits réservés.
ISSN 2269-1995 Contact : redaction (at) lescahiersdelislam.fr |